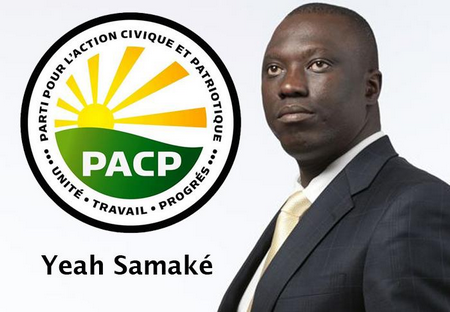Sur la crise malienne, les points de vue se rapprochent pour dire qu’on ne peut parvenir à une paix civile sans action armée, tout en concédant que les négociations restent la grande porte de sortie, donc de mise. De deux choses, l’une : Bamako semble partant pour le dialogue à juger par le discours adressé aux maliens à l’occasion de ce 22 septembre par le président intérimaire. Une fête de l’indépendance dans l’inconfort….

Y aura-t-il une intervention militaire dans le Nord du Mali ? Cette question est de première importance, car de sa réponse dépend la renaissance à l’espoir de mille et un malien las d’attendre, dégoûtés de la cacophonie récurrente qui tourne autour du sujet. Et c’est vrai, au Mali il n’est pas besoin de longues démonstrations pour faire remarquer que les esprits sont dans les brumes, au point que nous sommes amenés à reconnaitre notre impossibilité à formuler la moindre once d’espérance sur l’aboutissement d’une crise qui commence à peine à dire son nom. Mais concédons toutefois qu’il n’est toujours pas interdit d’espérer. La seule ombre au tableau, c’était que le pays s’était heurté au mur d’un blocage que constituait la posture de la CEDEAO qui, à la grande déception de tout le monde, s’était murée dans son obstination à n’intervenir que si Bamako accepte les conditions qu’elle avait posées, entre autres, le déploiement d’une force militaire dans la capitale. Chose que le président intérimaire, le Pr Dioncounda Traoré, dans la lettre qu’il a fait part à ses pairs, avait jugé « sans objet », et qui avait soulevé la colère de certains.
Mais depuis le Samedi dernier, le message transmis par le ministre malien de la défense Yamoussa Camara, au président en exercice de la CEDEAO Alassane Dramane Ouattara, lève toute équivoque à la position de Bamako qui se dit être d’accord pour le déploiement d’une troupe de la CEDEAO, à condition que cela se fasse dans la discrétion. Une bonne nouvelle certainement pour bon nombre de maliens auprès desquels l’institution sous régionale jouit d’une espèce de fétichisme !
Alors qu’au Nord, les fondamentalistes islamiques ont franchi une ligne rouge dans l’application d’une « certaine » charia avec surtout l’entrée dans la danse d’Ançar Eddine d’Iyad Ag Ghali qui garde la main sur Tombouctou, et qui jusqu’ici, ne s’était pas hasardé dans cette entreprise d’une idiotie indescriptible. Aussi, dans ces derniers temps, des nouvelles affirmaient la volonté d’Iyad Ag Ghali de quitter sans combat le Nord si l’Etat malien consent à lui donner une somme dont la seule évocation brouille la vue. Du Jihad, l’homme aurait voulu basculer dans le chantage ! Et le grand absent de ce tableau demeure les « les oublieux des bienfaits » du MNLA, avec lesquels même l’institution sous régionale entend privilégier le dialogue. Erreur de calcul ?
Une médiation plus médiatique qu’optique :
La crise malienne a offert à mille et un quidams l’occasion de cracher le peu de bien qu’ils pensent du malien. Et nul n’est besoin de dire que le pays n’a pas attendu les Blaise Compaoré et consorts pour faire son autocritique. De fait, lorsque le président du Faso, médiateur dans la crise malienne, laisse entendre qu’
« Il y a des maliens qui demandent l’indépendance, il y a des maliens qui veulent la charia. Comme ailleurs, on discute d’abord pour voir si on peut les intégrer dans la république, si on peut limiter les revendications extrêmes, parfois extrémistes », il jette la honte sur tous ceux qui, maliens de loin comme de près, ne se sont aucunement sentis dans le droit de prendre les armes contre un pays dont ils se réclament, pour faire aboutir une quelconque revendication. En clair, Blaise n’a fait là que servir sur un plateau doré le caviar et le champagne dont il a l’habitude de régaler les parties en conflit dans les médiations qu’il a eu à mener, et dans lesquelles il a toujours joué trouble jeu. La méthode qui est en honneur dans ces négociations revient à réconforter les voyous du MNLA qui n’ont de cesse de dire urbi et orbi qu’ils veulent un Etat où ils pourront instaurer leur voyoucratie ! Pourquoi ménager le MNLA ? Hors propagande, de quoi le MNLA peut-il se prévaloir ? Moussa Ag Assarid, Moussa Ag Ataher, Bilal Ag Cherif, Zakiatou…..héros de la rébellion touareg ? Quel est le but poursuivit par ce combat de démagogie identitaire ? S’il en a un, peut être mieux vaut-il faire partie du MNLA pour apporter sa pierre à la lapidation d’un monde de vérité et de justice. C’est là une idée que je ne cesse de défendre : on imagine sans mal que le MNLA n’a rien à envier à du terrorisme, eu égard seulement au massacre d’Haguel Hock sur lequel les experts s’accordent à reconnaitre que les techniques de tuerie sont propres à des terroristes. Et cerise sur le gâteau, les accointances du mouvement avec les terroristes d’AQMI. En ce cas, la politique que les autorités maliennes veulent entreprendre avec les irrédentistes a son lot de risques. Sauf s’il y aura une démarcation avec les anciennes méthodes en honneur qui nous ont conduit dans cette incertitude. « L’Etat devait éviter des promesses fantaisistes, les propositions de postes, les nominations à des hautes responsabilités de certains cadres peu fiables de la rébellion. Il fallait faire appel aux compétences des vrais cadres sans exclusive. (…)La continuité de la nation n’était pas à négocier et les engagements du gouvernement vis-à-vis de certains leaders de la rébellion était de nature à renforcer les jalousies individuelles et de groupes », fait remarquer Noumou Ben Diakité dans son roman « Mourir pour l’Azalaï », chronique d’une rébellion. C'est-à-dire aussi que la rébellion label MNLA pose un problème de vacuité politique.
Aujourd’hui, les analyses de bonne foi sont unanimes à reconnaitre qu’on ne peut parvenir à la paix civile sans action armée, tout en précisant que la guerre est une partie de la solution et non la solution elle-même. Parce que qui dit qu’en chassant les groupes armés hors du Nord qu’ils ne vont pas revenir en profitant d’une nouvelle faiblesse de l’Etat malien ? Donc en mettant en priorité la négociation, les autorités de Bamako donnent la bonne impression qu’ils ont mesuré l’ampleur du problème. La guerre, rappelons-le, ne se nourrit que d’hommes !
Les possibilités d’une intervention militaire étrangère au Mali sont désormais hors de doute, comme elle l’était il y a belle lurette. Ce n’est toujours qu’une question de temps. Encore faudrait-il que, dans les deux camps, l’objectivité prédomine ; et surtout du coté de l’institution sous régionale. Car, les maliens déjà en gros hostiles au déploiement supporteront mal la cohabitation avec des soldats qui débarqueront avec un calendrier qui leur est propre comme ce fut le cas dans beaucoup de crises. Mais en attendant, le Mali continue à tracer son chemin dans la crise. Angoisse : pour aller où ?
Boubacar SANGARE
 Y aura-t-il une intervention militaire dans le Nord du Mali ? Cette question est de première importance, car de sa réponse dépend la renaissance à l’espoir de mille et un malien las d’attendre, dégoûtés de la cacophonie récurrente qui tourne autour du sujet. Et c’est vrai, au Mali il n’est pas besoin de longues démonstrations pour faire remarquer que les esprits sont dans les brumes, au point que nous sommes amenés à reconnaitre notre impossibilité à formuler la moindre once d’espérance sur l’aboutissement d’une crise qui commence à peine à dire son nom. Mais concédons toutefois qu’il n’est toujours pas interdit d’espérer. La seule ombre au tableau, c’était que le pays s’était heurté au mur d’un blocage que constituait la posture de la CEDEAO qui, à la grande déception de tout le monde, s’était murée dans son obstination à n’intervenir que si Bamako accepte les conditions qu’elle avait posées, entre autres, le déploiement d’une force militaire dans la capitale. Chose que le président intérimaire, le Pr Dioncounda Traoré, dans la lettre qu’il a fait part à ses pairs, avait jugé « sans objet », et qui avait soulevé la colère de certains.
Mais depuis le Samedi dernier, le message transmis par le ministre malien de la défense Yamoussa Camara, au président en exercice de la CEDEAO Alassane Dramane Ouattara, lève toute équivoque à la position de Bamako qui se dit être d’accord pour le déploiement d’une troupe de la CEDEAO, à condition que cela se fasse dans la discrétion. Une bonne nouvelle certainement pour bon nombre de maliens auprès desquels l’institution sous régionale jouit d’une espèce de fétichisme !
Alors qu’au Nord, les fondamentalistes islamiques ont franchi une ligne rouge dans l’application d’une « certaine » charia avec surtout l’entrée dans la danse d’Ançar Eddine d’Iyad Ag Ghali qui garde la main sur Tombouctou, et qui jusqu’ici, ne s’était pas hasardé dans cette entreprise d’une idiotie indescriptible. Aussi, dans ces derniers temps, des nouvelles affirmaient la volonté d’Iyad Ag Ghali de quitter sans combat le Nord si l’Etat malien consent à lui donner une somme dont la seule évocation brouille la vue. Du Jihad, l’homme aurait voulu basculer dans le chantage ! Et le grand absent de ce tableau demeure les « les oublieux des bienfaits » du MNLA, avec lesquels même l’institution sous régionale entend privilégier le dialogue. Erreur de calcul ?
Une médiation plus médiatique qu’optique :
La crise malienne a offert à mille et un quidams l’occasion de cracher le peu de bien qu’ils pensent du malien. Et nul n’est besoin de dire que le pays n’a pas attendu les Blaise Compaoré et consorts pour faire son autocritique. De fait, lorsque le président du Faso, médiateur dans la crise malienne, laisse entendre qu’ « Il y a des maliens qui demandent l’indépendance, il y a des maliens qui veulent la charia. Comme ailleurs, on discute d’abord pour voir si on peut les intégrer dans la république, si on peut limiter les revendications extrêmes, parfois extrémistes », il jette la honte sur tous ceux qui, maliens de loin comme de près, ne se sont aucunement sentis dans le droit de prendre les armes contre un pays dont ils se réclament, pour faire aboutir une quelconque revendication. En clair, Blaise n’a fait là que servir sur un plateau doré le caviar et le champagne dont il a l’habitude de régaler les parties en conflit dans les médiations qu’il a eu à mener, et dans lesquelles il a toujours joué trouble jeu. La méthode qui est en honneur dans ces négociations revient à réconforter les voyous du MNLA qui n’ont de cesse de dire urbi et orbi qu’ils veulent un Etat où ils pourront instaurer leur voyoucratie ! Pourquoi ménager le MNLA ? Hors propagande, de quoi le MNLA peut-il se prévaloir ? Moussa Ag Assarid, Moussa Ag Ataher, Bilal Ag Cherif, Zakiatou…..héros de la rébellion touareg ? Quel est le but poursuivit par ce combat de démagogie identitaire ? S’il en a un, peut être mieux vaut-il faire partie du MNLA pour apporter sa pierre à la lapidation d’un monde de vérité et de justice. C’est là une idée que je ne cesse de défendre : on imagine sans mal que le MNLA n’a rien à envier à du terrorisme, eu égard seulement au massacre d’Haguel Hock sur lequel les experts s’accordent à reconnaitre que les techniques de tuerie sont propres à des terroristes. Et cerise sur le gâteau, les accointances du mouvement avec les terroristes d’AQMI. En ce cas, la politique que les autorités maliennes veulent entreprendre avec les irrédentistes a son lot de risques. Sauf s’il y aura une démarcation avec les anciennes méthodes en honneur qui nous ont conduit dans cette incertitude. « L’Etat devait éviter des promesses fantaisistes, les propositions de postes, les nominations à des hautes responsabilités de certains cadres peu fiables de la rébellion. Il fallait faire appel aux compétences des vrais cadres sans exclusive. (…)La continuité de la nation n’était pas à négocier et les engagements du gouvernement vis-à-vis de certains leaders de la rébellion était de nature à renforcer les jalousies individuelles et de groupes », fait remarquer Noumou Ben Diakité dans son roman « Mourir pour l’Azalaï », chronique d’une rébellion. C'est-à-dire aussi que la rébellion label MNLA pose un problème de vacuité politique.
Aujourd’hui, les analyses de bonne foi sont unanimes à reconnaitre qu’on ne peut parvenir à la paix civile sans action armée, tout en précisant que la guerre est une partie de la solution et non la solution elle-même. Parce que qui dit qu’en chassant les groupes armés hors du Nord qu’ils ne vont pas revenir en profitant d’une nouvelle faiblesse de l’Etat malien ? Donc en mettant en priorité la négociation, les autorités de Bamako donnent la bonne impression qu’ils ont mesuré l’ampleur du problème. La guerre, rappelons-le, ne se nourrit que d’hommes !
Les possibilités d’une intervention militaire étrangère au Mali sont désormais hors de doute, comme elle l’était il y a belle lurette. Ce n’est toujours qu’une question de temps. Encore faudrait-il que, dans les deux camps, l’objectivité prédomine ; et surtout du coté de l’institution sous régionale. Car, les maliens déjà en gros hostiles au déploiement supporteront mal la cohabitation avec des soldats qui débarqueront avec un calendrier qui leur est propre comme ce fut le cas dans beaucoup de crises. Mais en attendant, le Mali continue à tracer son chemin dans la crise. Angoisse : pour aller où ?
Boubacar SANGARE
Y aura-t-il une intervention militaire dans le Nord du Mali ? Cette question est de première importance, car de sa réponse dépend la renaissance à l’espoir de mille et un malien las d’attendre, dégoûtés de la cacophonie récurrente qui tourne autour du sujet. Et c’est vrai, au Mali il n’est pas besoin de longues démonstrations pour faire remarquer que les esprits sont dans les brumes, au point que nous sommes amenés à reconnaitre notre impossibilité à formuler la moindre once d’espérance sur l’aboutissement d’une crise qui commence à peine à dire son nom. Mais concédons toutefois qu’il n’est toujours pas interdit d’espérer. La seule ombre au tableau, c’était que le pays s’était heurté au mur d’un blocage que constituait la posture de la CEDEAO qui, à la grande déception de tout le monde, s’était murée dans son obstination à n’intervenir que si Bamako accepte les conditions qu’elle avait posées, entre autres, le déploiement d’une force militaire dans la capitale. Chose que le président intérimaire, le Pr Dioncounda Traoré, dans la lettre qu’il a fait part à ses pairs, avait jugé « sans objet », et qui avait soulevé la colère de certains.
Mais depuis le Samedi dernier, le message transmis par le ministre malien de la défense Yamoussa Camara, au président en exercice de la CEDEAO Alassane Dramane Ouattara, lève toute équivoque à la position de Bamako qui se dit être d’accord pour le déploiement d’une troupe de la CEDEAO, à condition que cela se fasse dans la discrétion. Une bonne nouvelle certainement pour bon nombre de maliens auprès desquels l’institution sous régionale jouit d’une espèce de fétichisme !
Alors qu’au Nord, les fondamentalistes islamiques ont franchi une ligne rouge dans l’application d’une « certaine » charia avec surtout l’entrée dans la danse d’Ançar Eddine d’Iyad Ag Ghali qui garde la main sur Tombouctou, et qui jusqu’ici, ne s’était pas hasardé dans cette entreprise d’une idiotie indescriptible. Aussi, dans ces derniers temps, des nouvelles affirmaient la volonté d’Iyad Ag Ghali de quitter sans combat le Nord si l’Etat malien consent à lui donner une somme dont la seule évocation brouille la vue. Du Jihad, l’homme aurait voulu basculer dans le chantage ! Et le grand absent de ce tableau demeure les « les oublieux des bienfaits » du MNLA, avec lesquels même l’institution sous régionale entend privilégier le dialogue. Erreur de calcul ?
Une médiation plus médiatique qu’optique :
La crise malienne a offert à mille et un quidams l’occasion de cracher le peu de bien qu’ils pensent du malien. Et nul n’est besoin de dire que le pays n’a pas attendu les Blaise Compaoré et consorts pour faire son autocritique. De fait, lorsque le président du Faso, médiateur dans la crise malienne, laisse entendre qu’ « Il y a des maliens qui demandent l’indépendance, il y a des maliens qui veulent la charia. Comme ailleurs, on discute d’abord pour voir si on peut les intégrer dans la république, si on peut limiter les revendications extrêmes, parfois extrémistes », il jette la honte sur tous ceux qui, maliens de loin comme de près, ne se sont aucunement sentis dans le droit de prendre les armes contre un pays dont ils se réclament, pour faire aboutir une quelconque revendication. En clair, Blaise n’a fait là que servir sur un plateau doré le caviar et le champagne dont il a l’habitude de régaler les parties en conflit dans les médiations qu’il a eu à mener, et dans lesquelles il a toujours joué trouble jeu. La méthode qui est en honneur dans ces négociations revient à réconforter les voyous du MNLA qui n’ont de cesse de dire urbi et orbi qu’ils veulent un Etat où ils pourront instaurer leur voyoucratie ! Pourquoi ménager le MNLA ? Hors propagande, de quoi le MNLA peut-il se prévaloir ? Moussa Ag Assarid, Moussa Ag Ataher, Bilal Ag Cherif, Zakiatou…..héros de la rébellion touareg ? Quel est le but poursuivit par ce combat de démagogie identitaire ? S’il en a un, peut être mieux vaut-il faire partie du MNLA pour apporter sa pierre à la lapidation d’un monde de vérité et de justice. C’est là une idée que je ne cesse de défendre : on imagine sans mal que le MNLA n’a rien à envier à du terrorisme, eu égard seulement au massacre d’Haguel Hock sur lequel les experts s’accordent à reconnaitre que les techniques de tuerie sont propres à des terroristes. Et cerise sur le gâteau, les accointances du mouvement avec les terroristes d’AQMI. En ce cas, la politique que les autorités maliennes veulent entreprendre avec les irrédentistes a son lot de risques. Sauf s’il y aura une démarcation avec les anciennes méthodes en honneur qui nous ont conduit dans cette incertitude. « L’Etat devait éviter des promesses fantaisistes, les propositions de postes, les nominations à des hautes responsabilités de certains cadres peu fiables de la rébellion. Il fallait faire appel aux compétences des vrais cadres sans exclusive. (…)La continuité de la nation n’était pas à négocier et les engagements du gouvernement vis-à-vis de certains leaders de la rébellion était de nature à renforcer les jalousies individuelles et de groupes », fait remarquer Noumou Ben Diakité dans son roman « Mourir pour l’Azalaï », chronique d’une rébellion. C'est-à-dire aussi que la rébellion label MNLA pose un problème de vacuité politique.
Aujourd’hui, les analyses de bonne foi sont unanimes à reconnaitre qu’on ne peut parvenir à la paix civile sans action armée, tout en précisant que la guerre est une partie de la solution et non la solution elle-même. Parce que qui dit qu’en chassant les groupes armés hors du Nord qu’ils ne vont pas revenir en profitant d’une nouvelle faiblesse de l’Etat malien ? Donc en mettant en priorité la négociation, les autorités de Bamako donnent la bonne impression qu’ils ont mesuré l’ampleur du problème. La guerre, rappelons-le, ne se nourrit que d’hommes !
Les possibilités d’une intervention militaire étrangère au Mali sont désormais hors de doute, comme elle l’était il y a belle lurette. Ce n’est toujours qu’une question de temps. Encore faudrait-il que, dans les deux camps, l’objectivité prédomine ; et surtout du coté de l’institution sous régionale. Car, les maliens déjà en gros hostiles au déploiement supporteront mal la cohabitation avec des soldats qui débarqueront avec un calendrier qui leur est propre comme ce fut le cas dans beaucoup de crises. Mais en attendant, le Mali continue à tracer son chemin dans la crise. Angoisse : pour aller où ?
Boubacar SANGARE  Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0