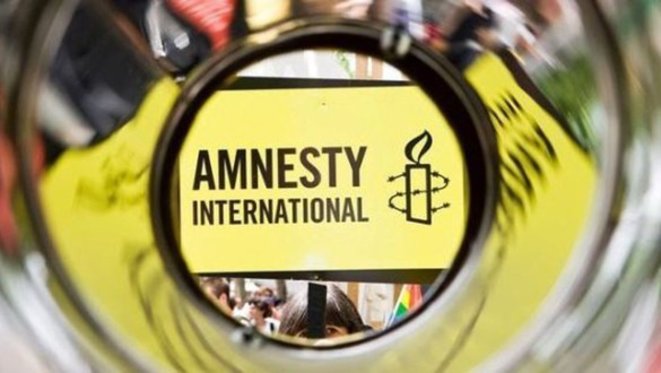Dire la vérité ou la déformer : l’enjeu de la communication
Sur tout le continent, trop de gouvernements confondent propagande et communication stratégique. Et le prix à payer est de plus en plus élevé.

La propagande vise à contrôler. La communication stratégique vise à crédibiliser. L’une déforme la réalité pour protéger le pouvoir. L’autre gagne la confiance pour le maintenir. Pourtant, des palais présidentiels aux ministères, ces termes sont encore utilisés de manière interchangeable. Cette confusion n’est pas seulement le fruit de la négligence. Elle est dangereuse.
Ce continent possède une force culturelle, un capital intellectuel et une dynamique économique. Pourtant, trop souvent, la voix de l’Afrique sur la scène internationale est absente ou défensive.
Dans tous les pays, ce qui est décrit comme une « stratégie de communication » n’est guère plus qu’une mise en scène orchestrée. Des conférences de presse sans questions. Des pages sur les réseaux sociaux conçues comme des affiches de campagne. Des briefings destinés à distraire plutôt qu’à informer. Et lorsque la confiance s’effondre, les dirigeants rejettent la faute sur la presse, les agents étrangers ou l’opposition. Ils prennent rarement le temps d’examiner le message lui-même.
Mais l’ancien modèle a fait son temps. On ne peut pas contrôler le discours dans un monde où chaque citoyen dispose d’un appareil photo, d’une voix et d’un réseau. On ne peut pas mentir dans une langue et s’attendre à ce que la vérité ne soit pas révélée dans une autre. On ne peut pas simuler la confiance. Soit on l’a, soit on ne l’a pas.
Les jeunes Africains, en particulier, ne sont pas des destinataires passifs. Ils n’attendent pas les informations. Ils les produisent. Ils les remettent en question. Ils dénoncent l’hypocrisie en temps réel. Ils savent faire la différence entre un dirigeant qui se montre et un dirigeant qui se cache derrière des déclarations. Ils ne s’intéressent pas aux performances. Ils recherchent la cohérence.
Alors pourquoi l’instinct de propagande persiste-t-il ?
Une partie de la réponse réside dans la mémoire institutionnelle. Les ministères de l’Information n’ont jamais été conçus pour favoriser le dialogue. Ils ont été créés pour gérer la perception. Leur rôle était de réprimer la dissidence, pas de l’étudier. De nombreux gouvernements fonctionnent encore avec cet état d’esprit. La communication est considérée comme un outil d’urgence plutôt que comme un élément central de la gouvernance.
Un outil de leadership
Le problème plus profond, cependant, est la peur. La transparence expose la fragilité. Elle exige de l’honnêteté lorsque les choses tournent mal. Elle nécessite d’écouter, surtout lorsque les commentaires sont désagréables. Et trop de dirigeants préfèrent paraître confiants plutôt que d’admettre leur incertitude.
La communication stratégique n’est pas une question d’apparence. C’est une question de clarté. Ce n’est pas une approche douce. C’est de la gouvernance. C’est un outil de leadership. C’est ainsi que les institutions construisent et maintiennent leur légitimité auprès du public. Cela nécessite une préparation, une discipline interne et la capacité de rester cohérent dans le temps, sur tous les canaux et dans toutes les crises. Cela signifie aligner les discours et les actes, car le public d’aujourd’hui ne fait plus la distinction entre les deux.
Le Kenya offre un exemple utile. Pendant une partie de la pandémie de Covid-19, le ministère de la Santé a tenu des points presse quotidiens calmes, factuels et cohérents. Le message n’était pas parfait, mais il était constant. Et cette constance, dans un moment de peur mondiale, a contribué à renforcer la confiance. Lorsque l’information circule de manière prévisible, les gens se sentent protégés.
En revanche, le coût d’une communication défaillante est omniprésent. Le taux de participation électorale baisse lorsque les citoyens ne croient plus que leur vote compte. Des manifestations éclatent non seulement en réaction aux politiques, mais aussi à la manière dont les dirigeants en parlent. Lorsque les gouvernements se taisent, les théories du complot comblent le vide. La confiance ne se perd pas toujours en un instant. Elle s’effrite parfois lentement, à cause de l’évitement, de l’arrogance et de l’absence.
Il ne s’agit pas seulement d’un échec national. Le réflexe de contrôler plutôt que de clarifier nuit à la position mondiale de l’Afrique. Ce continent possède une force culturelle, un capital intellectuel et une dynamique économique. Pourtant, trop souvent, la voix de l’Afrique sur la scène internationale est absente ou défensive. Nous sommes encore représentés par des slogans vagues ou des messages flous. Et lorsque nous ne parvenons pas à raconter notre histoire, quelqu’un d’autre s’en charge à notre place.
Certains pays commencent à repenser leur approche. Le Kenya a montré des signes de lucidité. D’autres commencent à poser les bonnes questions, mais n’ont pas encore mis en place les changements structurels nécessaires pour considérer la communication comme un outil de leadership à part entière.
C’est là que se trouve le point de décision. Continuer à gérer la perception. Ou commencer à gagner la confiance.
Car la propagande peut faire les gros titres, mais seule la stratégie construit une nation.
Gina Din est une stratège en communication africaine de renom et fondatrice du Gina Din Group, la principale agence de communication stratégique du Kenya. Elle a publié une autobiographie remarquée, Daughter of Africa. Elle a redéfini les relations publiques en Afrique et amplifié la voix du continent sur la scène internationale.
@NA
magazinedelafrique.com
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0