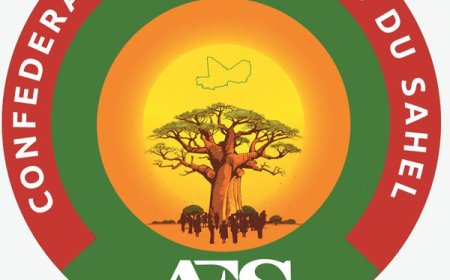Si le Pacte national du 12 avril 1992 avait prévu de façon «temporaire » les unités spéciales comme des forces de sécurité «supplétives », l’Accord d’Alger du 4 juillet 2006 consacre de manière «pérenne » lesdites unités comme des forces «parallèles » à celles de la République pour le compte «exclusif » d’une partie de la communauté nomade ou touarègue vivant dans la seule région de Kidal. Comme cela peut s’analyser aisément, l’Accord d’Alger se sert du Pacte national pour mieux s’en écarter et même le violer dans son esprit et sa lettre. Le double caractère régionaliste et tribaliste dudit accord sautant vite aux yeux même des myopes d’observateurs que nous sommes, sans compter la mise en cause implicite de la forme républicaine de l’Etat qui consacre la primauté impersonnelle et inaltérable de la loi fondamentale dont le principe intangible d’égalité et de traitement des citoyens en droits et en devoirs.
Le 12 avril 1992, le Pacte national est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le bureau de coordination des Mouvements et fronts unifiés de l’Azawad visant à mettre fin au conflit à caractère militaire, déclenché deux ans plus tôt, sous la forme d’une rébellion armée qui avait ensanglanté tout le Nord du Mali et déstabilisé toute la bande saharienne et sahélienne des pays limitrophes. Aussi, comme le qualificatif du pacte le fait ressortir, il s’agit d’un document «national » qui engage par conséquent toute la nation malienne sans exclusive aucune, mais dont le souci majeur était «l’intégration » des fils du pays qui se sentaient jadis marginalisés à travers les rouages de l’appareil d’Etat faisant, à leurs yeux, la part belle aux autres communautés du «Sud ». D’où l’article 78 dudit document qui dispose ce qui suit : «De leur côté, les Mouvements et Fronts Unifiés ont réitéré leur volonté et celle des populations qu'ils représentent de reprendre leur place dans la Nation malienne, dans leurs droits recouvrés dans une paix définitive fondée sur l'application du présent Pacte ».
Double urgence
Mais la double urgence était le cessez-le-feu entre les belligérants (rebelles contre soldats républicains) et la restauration de la sécurité dans les zones conflictuelles et dans toutes les régions du Nord dont les deux baromètres étaient le retour et la vie en paix des populations déplacées et des agents civils de l’administration publique qui avaient déserté les lieux parce que pris entre les deux feux militaires et rebelles. Aussi, les modalités du cessez-le-feu sont-elles définies à l’article 5 du Pacte national : «Un cessez-le-feu définitif entrera en vigueur à zéro heure le lendemain de la signature solennelle du Pacte National ». Et l’article 6 de préciser à cette époque : «En attendant la mise en oeuvre des dispositions prévues au paragraphe 7. A ci-dessous, et sous le contrôle de la Commission de Suivi du Cessez-le-feu, les forces des deux Parties s'interdisent toute action ou mouvement de nature à faire resurgir la tension ou à conduire des incidents ». Dans le court terme, au titre des mesures provisoires, c’est l’article 7 qui projette ainsi pour l’arrêt définitif des hostilités et du règlement des questions découlant de la situation de conflit armé : «Dans les soixante jours suivant la signature du Pacte, il sera mis en exécution un programme portant sur les mesures concomitantes ci-après :
A - Dans le cadre des mesures de restauration de la confiance, de l'élimination de facteurs d'insécurité et d'instauration d'une sécurité définitive, il sera :
- procédé à l'intégration totale, sur une base individuelle et volontaire et selon les critères de compétence, des combattants des Mouvements et Fronts Unifiés de l'Azawad (MFUA) dans les différents corps en uniformes de l’État,
- mis sur pied, pour une année, des unités spéciales des forces armées composées majoritairement des combattants intégrés des Mouvements et Fronts Unifiés de l'Azawad,
- institué un corps de sécurité intérieure (Gendarmerie Nationale, Garde-Goum, Police) comprenant toutes les composantes des populations locales, y compris des combattants des Mouvements et Fronts Unifiés de l'Azawad, mis à la disposition des Autorités locales dans le cadre de leurs pouvoirs de police,
- créé des unités spéciales de l'Armée largement ouvertes à toutes les composantes des populations locales, dont la mission se limitera à la préservation de l'intégrité et de la sécurité extérieures du territoire national ».
Triple confirmation
En application du Pacte national et suite aux difficultés de parcours jalonné de conflits armés et d’actes de banditisme exacerbé, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec la médiation de l’Algérie dont, notamment, celles de Tamanrasset (du 16 au 20 avril 1994), d’Alger (du 10 au 15 mai 1994), de Tamanrasset II (du 27 au 30 juin 1994). Les MFUA était représentés à Tamanrasset I par M. Abdrahamane GALLA, coordinateur ; la partie gouvernementale par le lieutenant-colonel Sada SAMAKE, ministre de l’Administration territoriale et de la sécurité ; le pay médiateur par Smail ALLAOUA, le chef de la délégarion. A Alger, c’était les mêmes protagonistes de part et d’autre. Quant à Tamanrasser II, le personnel des négiciateurs était renouvelé à l’exception du sieur GALLA qui était en face de M. Dioncounda TRAORE, ministre d'Etat et ministre malien de la Défense natioanle, et de M. SALAOUANDJI Tédjini, directeur des Relations bilatérales au ministère algérien des Affaires étrangères. Ce qui est sûr, c’est que toutes ces rencontres ont plutôt confirmé les dispostions pertinentes du Pacte national en ce qui concerne les principes et les modalités de fonctionnement des fameuses unités spéciales.
Le procès-verbal de la réunion de Tamanrasset I est sans équivoque sur le sujet comme l’atteste le point n°18 dudit document : «Au titre du point relatif au corps de sécurité intérieure, les deux parties sont d'avis que des éléments intégrés serviront d'embryon à la constitution de ce corps prévu par le Pacte National ». La rencontre d’Alger est allée plus loin à travers le point n°15 du procès-verbal qui traite du fonctionnement des unités en question : «Sur le plan fonctionnel, les deux parties sont convenues de créer une structure paritaire consultative au niveau du ministère de la Défense nationale et à laquelle incombera la tâche d'orienter les actions des unités spéciales pour la mission temporaire qui leur est confiée ». La nature de l’intervention du médiateur étant définie au point n°16 du même procès-verbal : «A la demande des deux parties, le Gouvernement algérien a accepté de contribuer à la fourniture d'une partie des moyens nécessaires au bon fonctionnement des unités (carburant, habillement, vivres et munitions) ». Tamanrasset II ayant préféré se limiter à ce qui a été convenu au cours de la rencontre d’Alger ci-dessus référée comme cela est indiqué dans le point n°3 du PV relatif aux unités spéciales : «Les deux parties décident de s'en tenir aux conclusions de la rencontre tenue à Alger du 10 au 15 mai 1994 et insistent sur la nécessite de mettre ces unités en place dans les meilleurs délais ».
Unités spéciales pour situation spéciale
La Pacte national et le PV des trois rencontres d’Algérie ci-dessus mentionnées repètent ainsi les mêmes choses au sujet des unités spéciales. La première, c’est la composition de ces unités de l’armée nationale devant être «largement » ouvertes à toutes les composantes des populations locales, y compris les combattants des MFUA qui devraient en constituer «l’embryon » pour un départ. Le secrutement pour les uns et les autres, d’autre part, devant se faire sur une base «individuelle et volontaire » et selon des critères «de compétence » intellectuelle et «d’aptitude » physique. La troisième, c’est le caractère «temporaire » de la mission confiée aux unités spéciales «post conflit » pour une durée déterminée «d’une année » au plus. Car il s’agissait de confier «la sécurisation » de ces zones à ceux-là même qui étaient les fauteurs de trouble : «Ka den kalifa shu muso Nyaalen yèrè la ». Une fois la paix revenue et la sécurité assurée après l’intégartion de ces combattants dans les corps en unifoprme de l’Etat (l’armée de terre, la gendarmerie nationale, la garde républicaine, la police nationale, la douane malienne et la garde forestière), lesdits éléments devraient être automatiquement gérés et traités comme tous les autres sans brimade ni favoristisme de quelque nature que ce soit ni pour quelque motif que ce soit : le Règlement intérieur et les textes de ces corps appliqués dans toute leur rigueur, de façon impersonnelle, sur tout le monde au même degré. Cela a-t-il été le cas en amont comme en aval ? Les événements du 23 mai dernier à Kidal et à Ménaka ne sont-ils pas la conséquence logique et prévisible d’une gestion laxiste et complaisante de cette intégartion mal conduite par les autorités politiques (diplomatie des valises remplies d’argent) et militaires (galons distribués à la tête du client) qui ont fini par réparer une injustice (faible représentativité de la communauté touarègue dans les rouages de l’administration et les corps en uniforme de l’Etat) par une autre injustice (super citoyens avec des privilèges indus au bout du fusil) à l’endroit de l’écrasante majorité des populations maliennes ?
Sectarisme et pérennité
Mais les accords d’Alger du 4 juillet dernier prennent le contre-pied de tous ces garde-fous en ce qui concerne les unités spéciales, mis à part le niveau de représentatvité et la qualité des négociateurs en présence : le général Kafougouna KONE (ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales), Ahmada Ag BIBI (chauffeur de M. Iyad Ag GHALI) et M. Abdelkrim GHERAIEB (ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire) comme pour dire que ledit document n’engage en rien le gouvernement algérien qui, pour ce faire, n’a pas la double caution de l’assemblée nationale et du président de la République d’Algérie. Jugez-en par vous-mêmes à la lumière du point n°4 du document qui traite des unités spéciales : «Création en dehors des zones urbaines de Kidal d'unités spéciales de sécurité, rattachées au commandement de la zone militaire et composées essentiellement d'éléments issus des régions nomades, dans les proportions assurant l'exécution efficace des missions des Unités Spéciales de Sécurité ». Dans les faits, elles vont concurrencer sinon se substituer aux forces armées républicaines comme l’indiquent clairement les rôles et missions à elles confiés par le même article cité ci-dessus : «Elles seront chargées notamment des missions suivantes : protection et gardiennage des édifices publics, protection des personnalités, reconnaissance et patrouilles, assistance à la police judiciaire, intervention et toutes autres missions qui seront définies dans l'acte de création ». Pour montrer que c’est une armée parallèle à double caractère tribal et régional sur laquelle la force républicaine n’a aucune prise, le commandement des ces unités est confié aux combattants insurgés du 23 mai dernier suivant les détails du même article : «Elles sont commandées par un commandement opérationnel des unités spéciales dont le commandant sera issu des personnels visés aux Chapitre III, Point 5z et dont le second proviendra des autres corps des forces armées et de sécurité nationales. Les chapitre III et point 5 précisant ceci : «Gestion avec discernement des officiers, sous officiers et hommes de rang, qui ont quitté leurs unités d'origine pendant les événements du 23 mai 2006z, en les intégrant si besoin dans les unités spéciales de sécurité en mettant à contribution la structure spécialisée visée plus haut pour faciliter la régularisation de leurs situations administratives, financières et de carrière, ainsi que leur participation aux opérations de maintien de la paix ». Une seule concession mineure est faite à la hiérarchie militaire : «Toutefois, lorsque l'unité est commandée par un officier issu des personnels visés dans le chapitre III, point 5, son second proviendra des autres corps des forces armées ou de sécurité nationale et vice-versa ». Pour parer à toute éventualité, les insurgés se sont mêmes dotés d’un état-major militaire à part que commende le colonel déserteur Hassane FAGAGA qui est secondé par d’autres officiers rebelles…Deux armées à Kidal, quoi !
Embryon de l’armée Azawad
En clair, les soldats sont recrutés dans l’armée nationale sur une base régionale et tribale ou clanique pour rester et servir dans leur propre pays (Azawad) d’origine. Ce qui viole l’esprit et la lettre de la Constitution à son article 2 qui stipule clairement, comme l’eau de roche, ceci : «Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l’opinion politique est prohibée ». D’autre part, le Pacte national est violé sur le point n°52 relatif aux mesures favorisant l’unité nationale et la cohésion sociale au Mali : «Tout en tenant compte des qualifications minimales nécessaires, le Gouvernement fera un effort particulier pour assurer l'intégration à titre spécial de cadres des Mouvements et de personnes des populations du Nord du Mali dans les instances centrales de l’État-major de la défense nationale et des autres corps de sécurité. Cette mesure qui sera exécutée dans les deux mois suivant la signature du Pacte est de nature à consolider la confiance et à associer une partie importante du peuple malien à la tâche de défense nationale ». Car, manifestement, il s’agit pour ces unités spéciales de la défense régionale de Kidal, à moins que «nationale » rime avec «Azawad » dans l’entendement des «Héros du 23 mai 2006 ». Sans compter que le Règlement militaire prend un sacré coup : c’est l’état-major général des forces armées et de sécurité qui décide librement de l’affectation des éléments (soldats, gendarmes, gardes républicains, policiers, douaniers et gardes forestiers) sur toute l’étendue du territoire national en fonction des besoins spécifiques dont l’appréciation lui appartient en toute responsabilité. Nous passons sous silence les autres aspects qui ont été arrêtés par les rencontres évoquées ci-dessus : ouverture des unités spéciales à toutes les communautés locales du Nord pour une durée limitée à une année d’existence.
Par Seydina Oumar DIARRA-SOD
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0