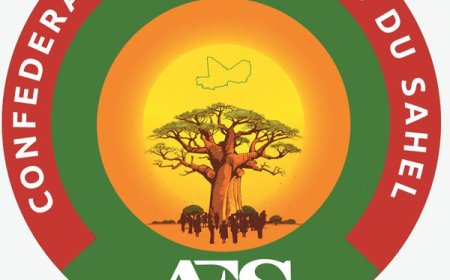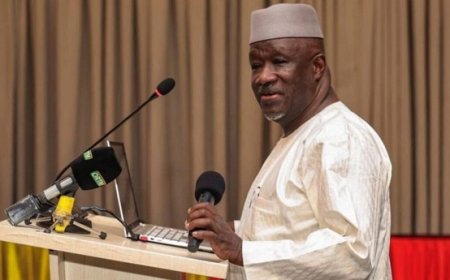Bokar Sangaré doctorant en sciences politiques : ‘’En Afrique de l’Ouest, cachez cette démocratie qu’on ne saurait voir’’
Chaque mois, des chercheur•ses spécialistes du Sahel livrent leurs réflexions, leurs éclairages, leurs amusements, leurs colères ou leurs opinions sur la région.
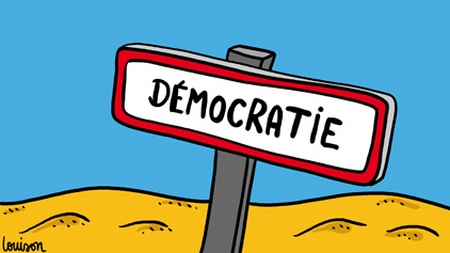
Aujourd’hui, le point de vue de Bokar Sangaré, doctorant en sciences politiques à l’Université libre de Bruxelles. Selon ce chercheur, l’essai courageux du journaliste Ousmane Ndiaye, «l’Afrique contre la démocratie. Mythes, déni et péril», vient percuter le discours en vogue sur le continent du «relativisme démocratique», qui profite surtout aux juntes militaires.
Mali, 1994. Deux ans après avoir remis les clefs de l’Etat aux civils après les premières élections pluralistes de l’histoire du pays, le lieutenant-colonel putschiste Amadou Toumani Touré décrit la démocratie comme un concept «importé». En verve dans l’hebdomadaire Jeune Afrique, le parachutiste surnommé le «soldat de la démocratie» – sa légende fleurit toujours – en parle comme d’un «phénomène de mode, un modèle occidental, prêt à emporter», auquel il dit préférer «des systèmes politiques qui ont fait leurs preuves jadis chez nous tels ceux des grands empires».
Ce discours – et ses nombreux avatars – est à la pointe de la mode sur le continent trente ans plus tard. Son talon d’Achille : il est peu soucieux d’appréhender l’histoire de la démocratie en Afrique sur la longue durée et pèche par «l’oubli que [ses] formes sont universelles et plurielles». C’est la thèse forte – non moins polémique – de l’Afrique contre la démocratie.
Mythes, déni et péril, ouvrage du journaliste Ousmane Ndiaye, passé par TV5 Monde et Courrier international, qui a tout d’un bélier lancé contre les idées reçues sur la démocratie sur le continent.
Dictature éclairée
En Afrique de l’Ouest, en tout cas, il ne fait pas de doute que la démocratie a mauvaise presse et est devenue le bouc émissaire de tous les échecs en matière de gouvernance, ouvrant ainsi un boulevard au «relativisme démocratique». Les régimes à direction militaire, qui ont confisqué le pouvoir et pris un virage liberticide au nom du souverainisme et de la lutte anti-impérialiste, font leur miel de cette perspective.
Jouant sur du velours, les militaires ont alimenté la défiance vis-à-vis des civils, relève Ousmane Ndiaye en décortiquant l’avancée du pouvoir kaki en Afrique. Les putschistes ont réussi à faire oublier une longue histoire d’interventionnisme militaire dans la sphère politique de ces pays, voire l’interpénétration des champs politiques et militaires – une constante. A la tête du Mali depuis 2021, le général Assimi Goïta vient ainsi de s’offrir le 10 juillet un mandat de cinq ans sans élection, «renouvelable autant que nécessaire» et «jusqu’à la pacification du pays», au mépris des règles démocratiques.
Au Togo, Faure Gnassingbé, président depuis vingt ans, vient de contourner la limitation du mandat dans la Constitution en organisant sans élection une «alternance fictive» (en faisant du poste du président de la République un poste honorifique, et en occupant à la place le poste de président du Conseil des ministres, qui concentre tous les pouvoirs). Un tour de passe-passe que résume très bien une formule en usage dans la région : «L’art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon.»
La force de l’Afrique contre la démocratie, essai politique courageux, repose notamment sur les jalons personnels que place Ousmane Ndiaye, à travers des événements qu’il a vécus en tant que journaliste (le printemps tunisien, avant que le pays ne bascule entre les mains de l’autocrate Kaïs Saïed, fossoyeur des rêves démocratiques ; la descente aux enfers du Mali à partir de 2012).
Son parcours professionnel a accompagné la montée du populisme aux relents militaristes, et l’enracinement de cette théorie de la dictature éclairée.
L’un des défenseurs de ce relativisme démocratique est par exemple Alain Foka, ancienne vedette de RFI qui fait aujourd’hui «l’apologie de l’inutilité des élections».
Le panafricanisme dévoyé
En invitant à historiciser la démocratie, Ndiaye renverse ce récit en vogue de son adaptation aux «valeurs africaines», dont les tenants reprennent malgré eux cette idée immuable d’une Afrique éternelle «qui n’est pas entrée dans l’histoire» – le discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, en 2007.
L’Afrique contre la démocratie offre l’avantage de retrouver la nuance et la complexité qui manquent aux débats sur ces questions. Sans faire de quartier, il met le doigt sur un nœud crucial : les déceptions des conférences nationales, qui ont consacré l’ouverture au multipartisme des années 1990 en Afrique de l’Ouest, et leurs promesses non tenues ; les coups d’Etat constitutionnels ; la réduction de la démocratie au seul processus électoral ; l’échec des opposants historiques ; les «fictions démocratiques» (comme au Togo) sont autant d’éléments absolument décisifs dans la désaffection actuelle pour la démocratie.
Selon l’auteur, ces causes internes sont en réalité bien plus structurantes que les ingérences extérieures, qui ont imposé «au bazooka» de nouveaux régimes «au nom de valeurs à géométrie variable», comme en Côte-d’Ivoire ou en Libye (des exemples souvent brandis par les contempteurs de la «démocratie importée»).
Ce «renoncement à l’idéal démocratique», selon les mots d’Ousmane Ndiaye, est aujourd’hui porté par des figures numériques dont certaines – à l’image des influenceurs Kemi Seba ou Nathalie Yamb – se réclament du panafricanisme. Ce projet originellement destiné à lutter contre l’asservissement des peuples est aujourd’hui dévoyé au service d’«entreprises liberticides» par les néo-panafricanistes, qui opèrent sur le registre de «l’affect et du complotisme».
Le procès de la démocratie
Ce prisme a comme corollaire une forme d’occidentalo-centrisme à rebours, investi par des intellectuels qu’Ousmane Ndiaye considère comme le «paravent intellectuel du déni démocratique». Il classe dans cette catégorie le romancier Boubacar Boris Diop, grand admirateur de l’autocrate rwandais Paul Kagame, ou l’altermondialiste malienne Aminata Dramane Traoré, en cheville avec le régime militaire d’Assimi Goïta, qui a dissous le conseil élu d’une commune bamakoise pour la nommer à sa tête.
En 2023, le général-président Mamadi Doumbouya, chef de la junte guinéenne, est allé jusqu’à instruire le procès de la démocratie à la tribune des Nations unies, évoquant un modèle de gouvernance «qui a du mal à s’adapter à nos réalités, à nos coutumes». En réalité, les expériences politiques africaines sont très souvent parties de la contestation, et de la critique de la «tradition», comme le démontre l’historien malien Doulaye Konaté avec l’exemple de l’empereur du Mali médiéval Soundiata Keïta, qui a émergé en rupture avec certaines «traditions», comme celle de l’esclavage.
En 2013, dans un article (1) renversant de lucidité, l’anthropologue malien Moussa Sow (1953- 2021) dressait un constat effroyable qui sonne aujourd’hui comme une prophétie : «On ne s’étonnera donc pas qu’on oppose des priorités […] : faire de la reconquête des régions une priorité signifie pour certains écarter les “politiciens” et ménager un tête à tête “efficace et salvateur” entre la figure du patriarche tout-puissant et l’armée, étant posé que la politique – autrement dit la démocratie – est une occupation “féminine” ou un jeu puéril qu’on peut tolérer en temps de paix, mais qu’on doit suspendre par temps de guerre. On oppose à la démocratie la maturité d’une gouvernance endogène africaine incarnée par la figure paternelle d’un superpuissant dictateur.»
(1). Moussa Sow, «Du coq à l’âne. Variations sur le thème de la démocratie par temps de crise politique», dans le Mali entre doutes et espoirs. Réflexions sur la Nation à l’épreuve de la crise du Nord, Bamako, Éditions Tombouctou.
Bokar Sangaré, Chroniques du Sahel, Libération
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0