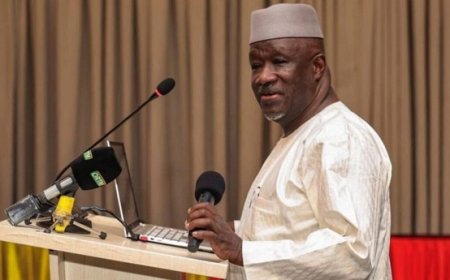Entrepreneuriat en Afrique : poser les bases du succès
L’Afrique est le continent où l’option entrepreneuriale est la plus forte au monde : 22 % des adultes en âge de travailler s’y engagent, tandis que plus de 75 % des jeunes déclarent vouloir créer leur entreprise dans les cinq prochaines années.

Les femmes africaines sont deux fois plus susceptibles de devenir entrepreneures que leurs homologues ailleurs dans le monde. Cependant, plus de 85 % des emplois se situent dans l’informel. Cette dynamique traduit à la fois une vitalité entrepreneuriale et un piège structurel qui freine l’émergence d’entreprises capables de transformer durablement les économies africaines.
Trois contraintes majeures limitent le potentiel de l’entrepreneuriat africain :
1. Accès limité au crédit : moins d’un tiers des PME accèdent à un financement bancaire, et moins de 10 % des crédits vont à l’agriculture. Le ratio prêt/collatéral de 1,7 est prohibitif.
2. Faible incitation à la formalisation : coûts et lenteurs administratives, fiscalité lourde et bénéfices incertains. L’informel demeure un choix rationnel.
3. Méfiance envers les institutions : héritée d’une gouvernance faible, elle pousse les entrepreneurs vers des mécanismes informels de financement (tontines, épargne familiale), coûteux et peu extensibles.
Conséquences économiques
Ces contraintes entraînent des conséquences systémiques :
- Retard dans la création et la croissance des entreprises.
- Pauvreté et inégalités accrues, vulnérabilité aux crises (pandémies, chocs extérieurs).
- Faible densité d’entreprises innovantes, réduisant les opportunités d’emplois stables et freinant la transformation structurelle des économies.
Formation et culture entrepreneuriale : un héritage à revisiter
Un facteur souvent négligé dans l’analyse des contraintes de l’entrepreneuriat africain est l’héritage du système éducatif. La formation héritée de la colonisation n’a pas été conçue pour produire des citoyens entrepreneurs, mais pour former une main-d’œuvre destinée à exécuter des fonctions administratives. Ce modèle a façonné des générations d’Africains avec un esprit marqué par la « culture fonctionnaire » : l’idée que l’État est le principal pourvoyeur d’emplois et de solutions.
Cette orientation a eu plusieurs conséquences :
- Faible valorisation de l’esprit d’initiative et de l’innovation.
- Marginalisation de la formation technique et professionnelle.
- Préférence pour l’emploi public et dépendance vis-à-vis de l’État.
Or, dans des sociétés jeunes et dynamiques, l’éducation devrait former des citoyens capables de transformer leur environnement par leurs propres initiatives, en apportant des solutions concrètes aux problèmes locaux. L’esprit entrepreneurial ne doit plus être un choix par défaut, mais une compétence intégrée dès la formation de base.
Rôle de l’État dans la transition éducative et entrepreneuriale
Si l’éducation doit préparer des citoyens entreprenants et créatifs, l’État doit accompagner cette dynamique en :
1. Créant un environnement favorable (financement adapté, infrastructures, allègement administratif et fiscal).
2. Identifiant et soutenant les talents émergents, en particulier ceux qui ont déjà démontré leur capacité d’innovation avec leurs propres moyens.
3. Revalorisant la formation professionnelle et technique, afin de connecter l’apprentissage aux besoins réels du marché.
4. Intégrant l’entrepreneuriat dans les programmes scolaires et universitaires comme une compétence citoyenne essentielle.
Expériences internationales et données comparatives
Des expériences dans d’autres régions du monde montrent que l’éducation entrepreneuriale et des environnements favorables peuvent transformer la dynamique économique :
- Aux États-Unis, près de 29 % des licornes créées depuis 1997 ont au moins un fondateur diplômé d’un MBA issu d’écoles comme Stanford, Harvard ou MIT.
- En Europe, les Junior Enterprises démontrent que 21 % de leurs membres créent une entreprise dans les 3 ans suivant leur diplôme, contre seulement 4–8 % des autres étudiants. De plus, 60 % trouvent un emploi avant la fin de leurs études.
- En Finlande, le programme « Yrityskylä » initie les élèves dès le collège à des simulations d’entreprise, développant leurs compétences financières et leur esprit d’initiative.
- En Australie, l’Université de New South Wales engage 10 000 étudiants par an via des ateliers, du mentorat et des concours de pitch, et finance environ 50 projets chaque année.
- Au Royaume-Uni, des initiatives introduisent l’entrepreneuriat dès le lycée, combinées à des exemples d’entrepreneurs emblématiques comme Gymshark, pour cultiver une culture entrepreneuriale nationale.
Ces expériences démontrent que :
- L’éducation entrepreneuriale améliore la confiance et l’intention d’entreprendre.
- Le mentorat et les réseaux facilitent la réussite et la pérennité des projets.
- L’introduction de compétences entrepreneuriales dès l’école modifie les trajectoires de carrière en orientant davantage vers la création d’entreprise.
Recommandations politiques
Pour transformer le potentiel entrepreneurial africain en levier de croissance inclusive, les actions prioritaires sont :
1. Faciliter l’accès au financement adapté : scoring alternatif, fintech et mobile banking, fonds de garantie publique, blended finance.
2. Réformer la formalisation : réduire coûts et délais, associer des bénéfices tangibles (accès marchés publics, protection sociale), introduire des stades progressifs de formalisation, mieux organiser les centres de gestion agréés
3. Reconstruire la confiance institutionnelle : transparence administrative, partenariats public-privé, ancrage dans les normes locales.
4. Stimuler l’innovation et l’intégration dans les chaînes de valeur : pôles technologiques, incubateurs sectoriels, formation en gestion et digitalisation.
5. Réformer les curricula éducatifs : intégrer l’entrepreneuriat, valoriser les filières techniques, et encourager l’esprit d’innovation dès l’école.
Conclusion stratégique
L’entrepreneuriat est au cœur du devenir économique de l’Afrique. Mais il doit passer d’une économie de survie à une économie de croissance inclusive. Cela suppose un nouveau contrat social avec les entrepreneurs : un accès élargi au financement, des institutions crédibles, des incitations réelles à la formalisation et une refonte du système éducatif. L’expérience internationale montre qu’une telle stratégie est possible et fructueuse. C’est à ce prix que l’Afrique pourra transformer l’énergie de ses entrepreneurs en un moteur de prospérité durable et partagée.
H. Niang
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0