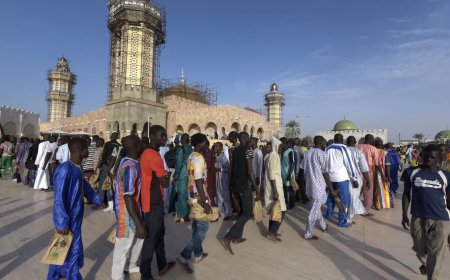Choguel : Quand le silence dit plus que les tribunes ?
Le 19 août 2025 restera dans les mémoires comme le jour où Choguel Kokalla Maïga, ancien Premier ministre, est passé de la lumière des tribunes à l’ombre d’une cellule.

Sa première nuit en prison fut, à coup sûr, le contraste absolu : loin des micros et des foules, il découvre l’éloquence d’un silence que je lui réclamais, loin des clameurs politiques.
Il n’y avait aucune rancune dans mes propos, seulement la sagesse d’un homme « apolitique » et, de surcroît, son aîné de cinq ans, si l’on en croit son âge officiel. Car certaines tribunes de Choguel, souvent incisives, ont servi de ring pour solder des comptes mémoriels, notamment contre la figure de Modibo Keïta. Mais l’histoire, à mes yeux, est un champ qui éclaire. Elle rassemble, elle guide, elle n’écrase pas.
Aujourd’hui, Choguel paie aussi le prix de certaines contradictions, en plus, peut-être, des reproches formulés par les enquêteurs du Végal, que je n’ai pas qualité à contester. Mais sa chute ne doit pas nous faire oublier deux principes fondamentaux : le respect dû à un homme qui a servi l’État, malgré ses excès possibles, et la présomption d’innocence, qui exige qu’il puisse se défendre dignement, hors des murs de la prison. À son âge et dans son état de santé, l’acharnement ne ressemble plus à de la justice.
Le silence de Choguel, désormais imposé, rétrécit le champ de ses adversaires, mais aussi celui de ses thuriféraires, peu visibles sur le terrain de sa défense. Cependant, il nous interpelle : à quoi sert d’humilier un homme si l’on n’est pas capable de proposer un idéal rassembleur ? À quoi bon démolir des mythes si l’on ne construit pas de projet ?
Le Mali a besoin de pardon pour avancer, pas de rancunes recyclées. Laissons la justice faire son travail, mais donnons à Choguel la possibilité de répondre debout, dans la dignité. Car en politique comme dans l’histoire, ce ne sont pas les cris qui construisent les nations, mais la force tranquille du silence et la grandeur de l'écoute.
L’histoire n’est pas un ring. Elle n’a pas vocation à servir de champ clos où s’échangent coups et contrecoups, mais plutôt à éclairer, apaiser et instruire. À peine avais-je appelé Choguel Kokalla Maïga à choisir le silence plutôt que la polémique que les événements sont venus rappeler avec force l’urgence de cette posture. Je ne m’en glorifierai jamais. Je le dis avec force : je le déplore !!!
Dans sa cellule anonyme, loin des caméras et des foules électrisées par ses discours, Choguel découvre la nudité du pouvoir déchu et, peut-être, ses véritables « amis ». Là où ses tribunes servaient autrefois à régler des comptes mémoriels, qu’il s’agisse de déconstruire la figure de Modibo Keïta ou de s’ériger en gardien d’une vérité historique, il se retrouve désormais face à une autre vérité, plus implacable : celle de la condition humaine qui décrète que la gloire est éphémère et que nul n’échappe au rendez-vous avec ses actes, devant les hommes ou devant Dieu. C’est de cela que je parlais dans mon éditorial destiné à lui suggérer le silence, non pas un mutisme politique.
Pourtant, dans ce silence forcé que je lui décrivais réside une éloquence à expérimenter. Elle interroge moins l’histoire du Mali que son présent. Effectivement, que vaut l’acharnement à revisiter des fractures idéologiques quand le pays lutte pour son unité, sa sécurité et sa survie ? Que gagne-t-on à opposer les mémoires quand la nation réclame cohésion et réconciliation ? L’histoire doit servir d’inspiration, non de champ de bataille.
Aujourd’hui, mon conseil à Choguel vaut pour ceux qui détiennent les clés de sa prison. Sachons, en effet, que l’heure n’est plus à la polémique, mais au pardon. Non pas un pardon qui absout tout, mais un pardon politique, qui reconnaît les services rendus par un homme ayant atteint un âge avancé, fragilisé par la maladie, et qui mérite au minimum de se défendre librement, debout et digne, devant ses juges.
Par ailleurs, la présomption d’innocence n’est pas un luxe : elle est un droit fondamental. Refuser à Choguel la possibilité de s’expliquer hors des murs de la prison, c’est risquer de réduire le débat en une vengeance.
Enfin, je me console en me disant que le silence, que j'espère momentané, de Choguel en prison, vaut peut-être mieux que ses tribunes rageuses. Il rétrécit le champ de ses adversaires, il coupe l’herbe sous les pieds de ceux qui se nourrissaient de ses excès de langage. Mais ce silence ne doit pas être synonyme d’effacement ni d’humiliation. Il devrait être l’occasion d’une introspection collective : comment transformer nos désaccords en dialogue plutôt qu’en fracture ? Comment élever le débat au-dessus des ressentiments et des règlements de comptes ?
Le Mali, aujourd’hui, a besoin d’hommes capables d’unir plus que de diviser. Choguel a, comme tout homme, ses contradictions, ses responsabilités et ses erreurs. Mais il a aussi, dans son parcours, des engagements et des combats qui ont contribué à porter haut l’idée de souveraineté nationale. Cela mérite le respect d’une justice mesurée, à l’aune de la reconnaissance que CKM appartient à l’histoire vivante du pays.
Plutôt que d’accabler un homme déjà affaibli, il serait plus utile d’ouvrir un espace, afin que la justice tranche sereinement et que la nation avance. L'écoute, le pardon, comme le silence, est une arme plus puissante que la polémique : il apaise les passions, réduit le champ des invectives et rappelle que l’essentiel est à venir. Car l’histoire du Mali ne se décrète pas dans les tribunes ni dans les cellules : elle s’écrit dans l’action présente et dans la volonté de construire ensemble.
Dicko Seidina Oumar
Journaliste - Historien - Ecrivain
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0