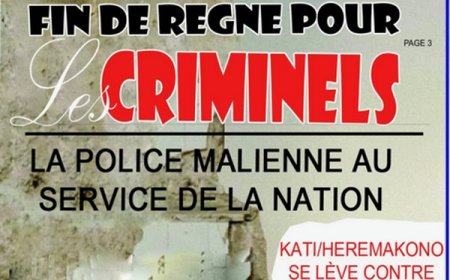Décryptage : L’éloge du droit
Je n’évoquerai ni le déploiement des unités sénégalaises à la frontière sénégalo-malienne ni la future élection présidentielle ivoirienne, mais l’éloge du droit au Mali.

Sariya en Bambara, Alhaku en Songhay, le droit s’inspire des normes pour en faire des règles communes de conduite. Science normative, il s’enracine dans la connaissance des règles morales et juridiques pour réfléchir sur ces règles et leurs origines. Le but, c’est rendre la justice, ce qui est juste et conforme au droit. C’est l’exemple des droits à l’alimentation, à la libre circulation, à la critique, au développement, à l’éducation, à l’emploi, à l’expression, à l’héritage, au logement, à l’opinion, à la paix, à la propriété, au respect, à la santé, à la sécurité, à la vie, au vote, etc. Au Mali, penser le droit, c’est tenter d’incarner l’impartialité et la liberté. Mais remontons le temps.
Dans l’Afrique moyenâgeuse, les règles de droit portaient déjà sur la réglementation de la vie quotidienne. En 1236, la charte du Mandé prônait "la protection et la défense des pauvres et des faibles contre l’arbitraire et la tyrannie (…)". L’hégémonie des sociétés d’hier s’est construite sur le respect des règles juridiques, obtenues grâce aux luttes politiques. Car toute lutte pour le droit est une lutte politique, ancrée dans une vision démocratique de la société.
Réformer les lois
Deux siècles plus tard, Mahmoud Kati, dans Chronique du chercheur, montre la réglementation des liens de mariage dans l’empire songhay. Par exemple, "les gens de Mori-koïra épouseraient qui ils voudraient et les enfants de ces unions seraient de même condition que leurs pères…". On pourrait multiplier les exemples aussi bien dans le royaume bambara de Ségou que dans l’État peul du Macina. Le champ juridique est aussi soumis aux évolutions de la société comme le montrent les sociologues du droit. Ces derniers analysent la façon dont l’appareil juridique d’une société varie en s’adaptant aux changements sociaux en cours. Dans la mesure où les normes sociales sont codifiées dans le droit, le sociologue regarde les faits pour en tirer une grille d’analyse pour réformer les lois en fonction du contexte.
L’impersonnalité de la loi
1934, le philosophe du droit, Hans Kelsen, pose les jalons d’une « théorie pure du droit » comme socle d’un système judiciaire doctrinaire et réglementaire positif, libre des pressions sociales. Cela dit, les sociologues ont une autre conception du droit.
Déjà, en 1844, dans Manifeste du parti communiste, Marx et Engels conçoivent le droit comme l’expression des rapports de force. Ils dénoncent un droit au service des dominants. 1900, dans Les deux lois de l’évolution pénale, Emile Durkheim explique que le droit tire sa source des mœurs, conformément aux normes sociales.
Le droit joue une fonction régulatrice dans la société. Le rapport au droit dans la société évolue. 1921, dans Economie et société, Max Weber vante les mérites d’un droit purement rationnel. Il insiste sur l’autonomie du champ juridique dont la base reste l’impersonnalité de la loi. Ni législation oppressive, ni législation aux ordres, l’application juste du droit permet d’avoir une justice, qui "distribue à chacun son dû (justitia suun cuique distribuit)", déclamait Cicéron, élogieux du droit positif. Lequel droit positif régit nos sociétés.
Construction du lien juridique du citoyen
Pour dire le droit, la raison se substitue à l’émotion et à la mystique. Une décision judiciaire ne doit souffrir d’aucune subjectivité.
C’est le fondement légal et légitime d’un acte juridique. Dans le champ judiciaire, les normes sont institutionnalisées : conseil de discipline, procédure d’exclusion d’une association, procédure de divorce, etc. C’est le cadre dans lequel s’opère la construction du lien juridique du citoyen à l’appareil judiciaire. Plus une décision judiciaire est irréprochable, plus le sentiment d’acceptation de l’appareil judiciaire chez le justiciable croît. C’est une des caractéristiques de l’État de droit, incarné par la séparation des pouvoirs et la soumission de la puissance publique aux règles du droit. Par exemple, l’application stricte de la constitution au Mali peut être un facteur de cohésion. Elle participe à la construction de l’État. Ni la vengeance, ni le règlement de compte n’incarnent une règle de droit.
Panthéon d’une justice impartiale et libre
Toujours est-il que l’avenir du Mali se joue en grande partie sur le respect du droit, panthéon d’une justice impartiale et libre de tout pouvoir : exécutif, législatif, etc. En droit, tout doit être fait selon le droit. Cadre par excellence de recherche de la vérité, le droit évolue grâce à la formation littéraire et cohérente des théoriciens et des praticiens. Aux antipodes d’un patria potesta, la force du droit, c’est de dire le droit dans le respect des textes au Mali comme ailleurs. Car toute mauvaise décision juridique débouche sur une tragédie du droit. La tragédie du droit, c’est l’étouffement du justiciable.
La tragédie du droit, c’est la fabrique de l’injustice, petite soit-elle. La tragédie du droit, c’est son instrumentalisation. La tragédie du droit, c’est la guerre de tous contre tous. La tragédie du droit, c’est l’incubation de la colère. La tragédie du droit, c’est le règne de la loi du talion. Certes, l’amour du Mali nous tient tous. Mais, l’espace judiciaire doit résister aux influences sociales et politiques. Un effort intellectuel, dans le cadre d’un raisonnement juridique, s’impose pour redonner du sens aux décisions juridiques.
Le juriste, un canard colvert
Comme un canard colvert qui dort un œil ouvert pour surveiller les prédateurs, le juriste malien doit aussi trouver le vertueux équilibre pour rendre la justice dans les limites infranchissables du droit, socle de tout mieux vivre-ensemble. Voilà le mot, le mieux-vivre ensemble, une valeur qui doit se traduire par la libération de Mme la vie chère, de Ras Bath, de Clément Dembélé, de Ben le cerveau, d’Issa Kaou Djim, de Moussa Mara, etc., pour apaiser le climat social. Terminons cet éloge du droit par la chanson, Respect, de l’avant-gardiste Aretha Franklin.
Mohamed Amara
(sociologue)
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0