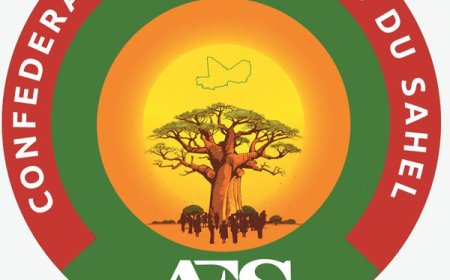Goonga Tan : Tebboune, face à la peur du vide sahélien, tire sur une ombre au Mali
Vendredi 18 juillet 2025, Abdelmadjid Tebboune est sorti de son silence. Sur les antennes de la télévision nationale algérienne, le président s’est livré à une sortie musclée, dénonçant « la présence de mercenaires aux frontières ». Il visait bien sûr les forces russes opérant au Mali, désormais regroupées sous la bannière de l’Africa Corps.

Un prétexte lui donnant l’occasion de lancer une pique à peine voilée en direction de Bamako et de ses partenaires, une attitude qui trahit moins une posture offensive qu’un malaise profond face à la recomposition géopolitique du Sahel. Car derrière les mots, transparaît l’angoisse d’un régime en perte d’influence régionale. L’Algérie, longtemps autoproclamée médiatrice incontournable du Sahel, voit son rôle s’éroder. Tandis que Moscou, Ankara, et dans une moindre mesure Pékin, s’imposent comme de nouveaux acteurs sécuritaires, Alger observe, impuissante, le glissement stratégique de ses anciens "frères".
Tebboune, rappelons-le, a cru bon, à plusieurs reprises, d’agrémenter sa charge de commentaires moralisateurs. Ainsi, selon lui, « l’argent investi dans Wagner serait plus utile au développement du Sahel ». Une déclaration paradoxale, venant d’un État qui n’a jamais su, ou voulu, transformer sa proximité géographique avec la bande sahélo-saharienne en levier de développement partagé.
L’Algérie semble, en effet, plus à l’aise dans la rhétorique que dans l’engagement concret. Elle s’accroche à un rôle de grand frère diplomatique que plus personne ne lui reconnaît.
C’est dans ce contexte que le chef de l’État algérien a proposé, une fois encore, une médiation entre Bamako et les ex-rebelles du nord. Une offre aussitôt rejetée par les autorités maliennes. Le président de la Transition, Assimi Goïta, a opposé un niet catégorique, rappelant l’échec répété des accords négociés sous l’égide d’Alger : Tamanrasset (1991), Pacte national (1992), Accord d’Alger (2006), et celui de 2015. À ses yeux, ces textes, bien qu’ambitieux sur le papier, n’ont jamais apporté la paix sur le terrain.
Goïta entend donc tourner la page d’une diplomatie de dépendance. Il appelle à une solution strictement malienne, née d’un dialogue entre Maliens, sans ingérence extérieure.
L’appel lancé aux groupes armés pour déposer les armes s’inscrit dans cette volonté assumée de replacer la souveraineté nationale au cœur du processus de réconciliation. Pour lui, il ne peut y avoir de paix durable sans refondation du lien républicain, sans dépassement des schémas imposés par des médiations usées.
Au fond, ce à quoi l’on assiste aujourd’hui n’est plus seulement un contentieux diplomatique entre deux pays : c’est une divergence de vision. D’un côté, une Algérie figée dans l’héritage de l’Accord d’Alger de 2015, qu’elle refuse de voir dépasser ; de l’autre, un Mali qui, fort de nouvelles alliances, entend sécuriser son territoire selon ses propres priorités.
La fracture s’est encore creusée après les récentes frappes de drones maliens, notamment les Bayraktar TB2 et Akinci fournis par la Turquie, aux abords de Tinzaouatène, à la frontière sud de l’Algérie.
À Alger, ces opérations sont perçues comme une provocation. Mais plutôt que de reconnaître l’évolution des rapports de force, le pouvoir algérien campe sur une position victimaire, dénonçant « l’usage de mercenaires » et appelant à une condamnation internationale.
Ce discours trahit une nouvelle fébrilité : celle d’un État marginalisé dans un Sahel qui se redéfinit sans lui. Car ce que Tebboune présente comme une « ingérence étrangère » est en réalité le signe d’une dynamique sahélienne qui échappe désormais à son contrôle. Bamako, Niamey et Ouagadougou parlent un autre langage. La Russie, la Turquie et d’autres puissances répondent dorénavant à des demandes de sécurité et de coopération que l’Algérie n’a pas su, ou voulu, satisfaire.
Le monopole algérien sur la diplomatie sahélienne s’effondre. Le vide laissé par l’échec de l’Accord d’Alger n’est pas comblé par des initiatives régionales algériennes, mais par des solutions alternatives, souverainement choisies. Il est temps que Tebboune l’admette : le Sahel ne veut plus de tuteurs. Il aspire à des partenariats d’égal à égal, libérés des oripeaux d’une influence postcoloniale à présent obsolète.
Dicko Seidina Oumar
Journaliste – Historien – Écrivain
Quelle est votre réaction ?
 Like
4
Like
4
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
1
Je kiff
1
 Drôle
1
Drôle
1
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0