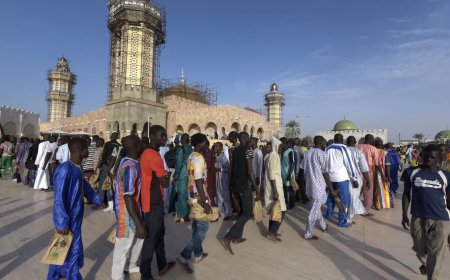Décryptage : Tempête de sable sur les rives du Djoliba
Les récentes arrestations militaires le confirment : notre modèle de gouvernance est usé, entre perte de confiance de l’exécutif et désamour des populations.

Pour commencer, il y a eu la cohabitation théâtrale entre le militaire Assimi Goïta, président de la transition, et le civil Choguel K Maïga, Premier ministre de la transition. Cette lune de miel n’aura duré que trois ans et demi. Puis, il y a eu les Assises nationales de la refondation, le dialogue inter malien, mais aussi le divorce avec la Cedeao et la France, la fin de l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger. Mais, rien de tout cela n’a contribué à ancrer le bateau de la transition.
Le 14 août dernier marque désormais d’une pierre blanche ce qui finit par ressembler à une crise de confiance au sein de l’État-major des Forces armées maliennes. Officiellement, près d’une dizaine de militaires, dont deux généraux et un ressortissant français, sont arrêtés et accusés de « déstabiliser les institutions de la République ». La diffusion de leurs photographies tranche avec notre Hadamaden en Bambara ou Ibunaadama en Songhay. Rien ne doit nous faire oublier notre caractère humain. Bien entendu, on me retorquera que ce sont des prisonniers et qu’ils seraient des traîtres.
Mais cela n’efface pas notre capacité à préserver leur dignité. Ces images risquent de susciter chez une partie de la population un sentiment de rejet de l’exécutif.
Désir de changement
Et puis, nous le savons bien, l’image de l’exécutif, quel que soit le régime, s’écorne plus facilement dans un contexte de tensions permanentes. Il y a quelques années en arrière, l’image de certains élus, syndicalistes et militants associatifs était dépréciée. Au point que de moins en moins d’élus trouvaient grâce aux yeux des Maliens.
Le nombre d’électeurs faiblissait, en raison du sentiment que les dirigeants sont indifférents à leur sort. Un des effets est que le citoyen se détourne de la gestion des affaires publiques. Voilà le contexte où est intervenu le coup d’état militaire du 18 août 2020 d’Assimi Goïta au nom du comité national pour le salut du peuple contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le but de ce putsch militaire était de satisfaire le désir de changement des Maliens, incarné par les manifestations du M5-RFP. Ça, c’était il y a cinq ans. Aujourd’hui, l’insatisfaction des Maliens est réelle. L’exécutif affronte des tempêtes de sable difficiles, rendant illisibles toute perspective de progrès.
Un univers politique informel
On voit bien que les crises essaiment. Elles se développent sur les réseaux sociaux, devenus une source d’information pour les citoyens. Les groupes narcoterroristes s’en servent pour propager leur scène de violence au Mali, au Niger ou au Burkina-Faso. Leur idéologie se diffuse dans les territoires conquis. Conséquence, on aperçoit une réalité politique classique qui dépérit au profit des spadassins de la violence.
On constate également la naissance et la structuration d’un univers politique informel qui va de Facebook à X en passant par WhatsApp. Grâce à la révolution numérique, un nouveau contexte apparaît. D’un côté, un univers décrié. De l’autre, un univers prisé, si tant est qu’on sache faire le distinguo entre la mésinformation, la désinformation et la vraie information. C’est la nouvelle voie qui s’ouvre pour réinventer une démocratie aux valeurs affirmées, qui ne craint ni contradiction ni pluralisme. Ne craignons pas la démocratie. Chérissons-là comme l’avaient fait nos ancêtres dans le Kurukanfuga ou dans le Songhay.
Un projet d’alliance républicaine
D’autant que la stratégie, je te tiens, tu me tiens, ne fonctionne plus. Les conflictualités ne cessent de croître. Dans l’optique du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation, un scénario de sortie de crise doit être esquissé pour concevoir un projet d’alliance républicaine, impliquant les tenants du pouvoir et les oppositions.
Ce projet n’aura de sens que s’il est inclusif. C’est-à-dire qu’il doit œuvrer à l’arrêt des privations de liberté, conduire à la libération des détenus d’opinion, à la réhabilitation du politique et le retour à l’ordre constitutionnel. Une meilleure manière de parier sur la paix et de résoudre les problèmes communs de sécurité, de paix et de développement.
Terminons par cette question : comment utiliser la force du pouvoir pour changer le Mali ?
- Travailler l’unité entre les Maliens pour transformer notre société ;
- Renforcer la gouvernance des territoires au-delà de Bamako pour visibiliser les actions de l’État ;
- Créer des espaces de dialogue permanents pour mieux se comprendre ;
- Utiliser de manière rationnelle les savoirs locaux pour parfaire le système démocratique ;
- Et vous, qu’en dites-vous ?
Mohamed Amara
Quelle est votre réaction ?
 Like
2
Like
2
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
1
Drôle
1
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0