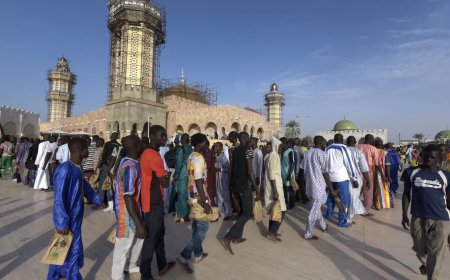Inégalités dans l’accès numérique en santé : Pourquoi le Mali avance à plusieurs vitesses
Alors que Sikasso affiche un recours massif aux outils numériques de santé (94,4 %), Koulikoro plafonne à 77,3 %.
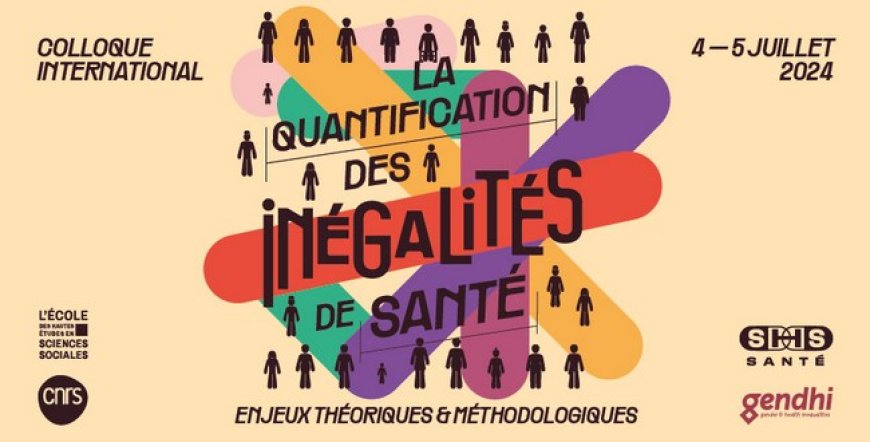
Derrière ces écarts se mêlent qualité des réseaux, fragilités du système d’information sanitaire, géographie de l’insécurité, moyens financiers… et disponibilité des personnels qualifiés. Des inégalités que décortique le "Rapport global sur le développement humain 2025 - une affaire de choix : individus et perspectives à l’ère de l'intelligence artificielle" que vient de publier le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) sur le Mali.
Au Mali, l’accès au haut débit passe quasi exclusivement par le mobile ; le fixe reste marginal. Les diagnostics récents rappellent un "usage gap" : des zones couvertes par le réseau où les ménages n’utilisent pas Internet, freinés par le coût des données, du smartphone d’entrée de gamme, et des compétences numériques limitées, des facteurs qui se cumulent en milieu rural.
"Conséquence pour la e-santé : dans une région où l’Internet mobile est cher, lent ou mal maîtrisé, la télé supervision, la téléformation, la saisie DHIS2 en temps voulu, ou l’envoi d’alertes épidémiologiques se heurtent à des retards et à des trous dans la raquette", souligne un rapport Banque mondiale. La saisie DHIS2 désigne l’opération consistant à entrer, dans le système informatique DHIS2 (District Health Information Software, version 2), les données sanitaires collectées sur le terrain.
"Le Mali a déployé DHIS2 sur l’ensemble du territoire (régions, districts, hôpitaux, grande majorité des Cscom). C’est un atout majeur… à condition que les données soient complètes, promptes et analysées", précise le rapport. Or les évaluations officielles pointent encore une insuffisance de ressources humaines dédiées, des moyens financiers limités et une faible culture d’utilisation des données pour décider.
Le Plan stratégique SNISS prévoit de consolider l’interopérabilité (intégrer SIAF, SI-GRH, etc.), d’opérationnaliser la santé numérique, et souligne l’appui des partenaires techniques et financiers (dont l’Unicef) à l’élaboration et au financement des activités.
"Dans le Centre et le Nord, l’accès humanitaire et les services de santé sont régulièrement perturbés : incidents de sécurité en hausse en 2025, blocages routiers et déplacements forcés réduisent l’ouverture des structures, perturbent l’alimentation électrique et la connectivité - donc l’usage effectif des outils numériques. Certaines localités de Ménaka et Kidal n’ont même aucun centre de santé formel à portée, rendant caducs les services en ligne", souligne de son côté Ocha, l’organisme humanitaire des Nations-Unies, en soutien au rapport. (unocha.org, Insecurity Insight -, Impact Initiatives)
La disponibilité des professionnels conditionne l’usage des outils (collecte, contrôle, analyse, télémédecine). En 2022, le ratio cumulé (médecins, sage-femmes, infirmiers, etc.) n’atteignait que 6 pour 10 000 habitants au niveau national (norme OMS : 23). Par région : Koulikoro : 5, Sikasso : 4, Ségou : 3, Mopti : 3 ; Bamako culmine à 14 grâce à la concentration des effectifs. Ces écarts de dotation pèsent directement sur l’appropriation et la qualité des usages numériques.
Les Comptes de la santé offrent une photographie utile des dépenses courantes (toutes sources) par région : Kayes 14,3 % (~50,5 Mds F CFA), Koulikoro 12,5 % (~44,1 Mds), Sikasso 10,2 % (~35,8 Mds), Ségou 7,3 % (~25,7 Mds), Mopti 6,9 % (~24,1 Mds), Tombouctou 2,7 % (~9,4 Mds), Gao 1,9 % (~6,8 Mds), Kidal 0,7 % (~2,5 Mds), Taoudénit 0,09 % (~0,31 Mds), Ménaka 0,13 % (~0,46 Mds), District de Bamako 20,0 % (~70,3 Mds) ; les structures centrales représentent 23,4 % (~82,5 Mds). Cette cartographie montre un poids relatif plus fort de Kayes et Bamako, mais n’isole pas les lignes "santé numérique" : la transparence budgétaire fine par poste TIC reste à outiller.
"Dans des cercles ruraux éloignés, un coût du gigaoctet et des équipements encore élevés brident l’usage régulier d’Internet par les agents et les patients. Les compétences numériques varient aussi selon les districts", souligne de son côté la Banque mondiale. (thedocs.worldbank.org) : Ainsi, on a : Koulikoro (ratio 5/10 000) et Sikasso (4/10 000) disposent de cadres limités pour alimenter et exploiter les plateformes - un frein à l’"usage utile". En plus, "des incidents touchent aussi des localités de Koulikoro et Sikasso, désorganisant ponctuellement services et réseaux". (Insecurity Insight -)
Le "Rapport global sur le développement humain 2025 - une affaire de choix : individus et perspectives à l’ère de l'intelligence artificielle", du Pnud propose, pour résorber les difficultés et harmoniser les services digitaux au Mali ; d’introduire "un sous-poste Tic obligatoire dans les plans d’actions régionaux (connectivité, terminaux, maintenance, cybersécurité, formation), et publier un suivi trimestriel ; de s’appuyer sur le SIAF/SNISS pour tracer ces dépenses et lier crédits et indicateurs d’usage (complétude/promptitude/exploitation)" et surtout de mettre en place "un compteur unique des financements e-santé (qui finance quoi, où, pour combien de temps ?) et une matrice d’interopérabilité validée par la CPS, afin d’éviter les ‘îlots’ applicatifs".
Aminata Agaly Yattara
Ce reportage est publié avec le soutien de Journalistes pour les droits humains (JDH) au Mali et NED
Quelle est votre réaction ?
 Like
1
Like
1
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0