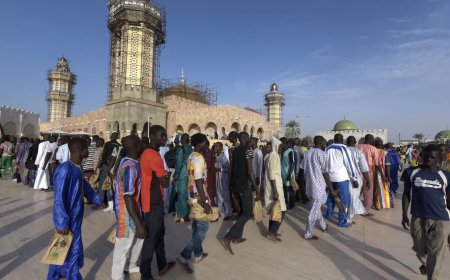Goonga Tan : Mali : souveraineté minière, bras de fer et contagion régionale
Depuis que le Mali a décidé de revoir en profondeur les contrats d’exploitation de ses ressources stratégiques (or, lithium, uranium, (demain potentiellement le pétrole), un vent de rupture souffle sur Bamako.

Rupture avec un ordre économique hérité de décennies de passivité politique et de dépendance juridique. Rupture aussi avec cette diplomatie de compromission qui faisait du Mali un « pays ressource » sans souveraineté réelle sur son sous-sol. La question n’est plus de savoir si cette stratégie est audacieuse, mais si elle est tenable, durable et surtout rentable.
Je tiens à rappeler une lapalissade : le Mali est l’un des principaux producteurs d’or du continent africain. Son sous-sol regorge aussi de lithium, ressource devenue cruciale dans la transition énergétique mondiale, notamment pour les batteries électriques. On soupçonne également des gisements d’uranium inexploités dans le nord malien, convoités par plusieurs puissances. Et depuis quelques années, des indices pétroliers crédibles, particulièrement à Taoudéni, nourrissent des espoirs de diversification énergétique. Ce potentiel fait du Mali une pièce maîtresse sur l’échiquier des matières premières. Mais jusqu’ici, le pays a été plus spectateur que joueur, s’exposant aux interactions trophiques.
Les autorités maliennes de transition, en rupture avec la tradition postcoloniale de signature discrète et d’allégeance tacite, ont opté pour une stratégie de renégociation systématique des contrats miniers et énergétiques. L’objectif est clair : récupérer une part plus équitable de la rente extractive, imposer des clauses de souveraineté économique et obliger les opérateurs étrangers à respecter des normes environnementales et sociales strictes.
Dans un contexte global où le Sud réclame davantage de justice économique, le Mali tente de redéfinir les règles du jeu. Il ne s’agit pas seulement d’augmenter les recettes de l’État, mais de sortir du cycle de la prédation légalisée. Les nouvelles conventions minières, les révisions fiscales et les exigences de transformation locale traduisent, en effet, cette volonté de rupture avec les schémas néocoloniaux.
Les premiers effets sont visibles : plusieurs multinationales ont accepté de revoir leurs engagements. D’autres tergiversent ou menacent de se retirer. Mais le signal est envoyé : au Mali, l’ère du pillage légal touche à sa fin.
Cependant, ne nous y trompons pas : à court terme, la renégociation des contrats peut provoquer des turbulences, ralentissement de certains projets, contentieux juridiques, crispations diplomatiques. Mais, à moyen et long terme, les retombées peuvent être structurantes si la stratégie est bien conduite.
Il faut d’abord évaluer l’impact financier, car un rééquilibrage des redevances minières et des parts de production permettra à l’État malien d’augmenter ses recettes fiscales, d’élargir sa marge budgétaire et de financer des projets structurants (infrastructures, santé, éducation).
Ces gains potentiels exigent cependant rigueur, transparence et stabilité réglementaire. Une stratégie de souveraineté ne se décrète pas seulement dans les discours : elle se construit dans la durée, par une gouvernance à la hauteur des ambitions. Le Mali, après avoir réaffirmé sa souveraineté, est désormais interpellé sur sa capacité à exercer une souveraineté économique cohérente.
Cette posture affirmée n’est pas sans conséquence sur le plan diplomatique. En choisissant de dénoncer certains contrats jugés léonins, le Mali se heurte aux intérêts de puissances installées depuis des décennies dans ses filières minières. Il s’expose à des représailles économiques déguisées : pressions sur les opérateurs logistiques, ralentissements douaniers, campagnes médiatiques ou entraves à l’accès aux infrastructures régionales, notamment les ports.
Il nous revient que certaines lenteurs « administratives » constatées depuis quelques mois chez nos voisins immédiats interrogent sur une stratégie régionale d’étouffement du Mali. À l’exception notable de la Mauritanie, qui a su maintenir une relation apaisée avec Bamako, ainsi que de la Guinée et du Togo, qui jouent la carte de la neutralité bienveillante, les voisins du Mali semblent prendre leurs distances. Derrière l’écran des discours feutrés, l’étau se resserre.
Le choix d’accéder à la mer via des corridors alternatifs (Nouakchott, Lomé, Conakry) est révélateur d’un changement de cap stratégique. Mais ces alternatives ont un coût logistique important, et la question se pose : jusqu’à quand le Mali pourra-t-il supporter un isolement partiel sans impact majeur sur ses importations, ses exportations et le quotidien de sa population ?
Pour autant, le Mali pourrait ne pas rester seul longtemps : un effet domino se dessine. Des signaux faibles, mais visibles, montrent que d’autres pays du Sahel et d’Afrique de l’Ouest observent de près cette stratégie. Le Burkina Faso et le Niger, dans leur dynamique commune au sein de l’AÉS, partagent désormais cette doctrine économique fondée sur la reconquête des leviers de souveraineté. Même au-delà du Sahel, certains pays comme la Guinée commencent à envisager des révisions contractuelles plus fermes dans le secteur minier.
Le Mali pourrait donc, malgré son isolement recherché, inaugurer une nouvelle ère. Celle où les États producteurs ne se contentent plus de céder leur sous-sol à vil prix, mais imposent leurs termes.
L’histoire dira si cette volonté s’est traduite en résultats. Mais une chose est certaine : le Mali a changé de posture. Il ne courbe plus l’échine. Il pose ses conditions. Il accepte le bras de fer.
Dicko Seidina Oumar
Journaliste – Historien – Écrivain
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0