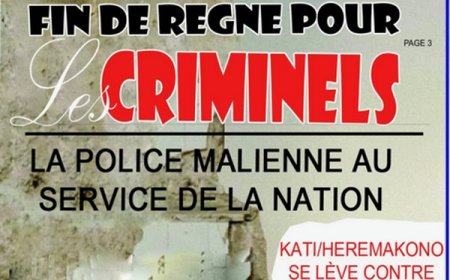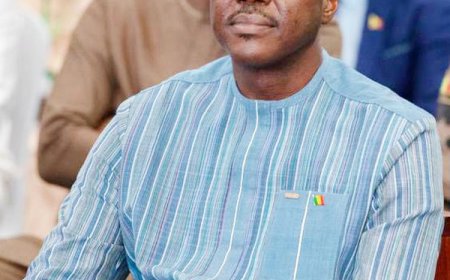Libération des otages marocains : Bamako et Rabat réussissent un grand coup
Le 3 août 2025, une opération de coopération antiterroriste exemplaire a permis la libération de quatre chauffeurs routiers marocains, enlevés le 18 janvier dans le nord-est du Burkina Faso.

Cette mission, menée conjointement par l’Agence Nationale de la Sécurité d’État (ANSE) du Mali et la Direction Générale d’Études et de Documentation (DGED) du Maroc, a ciblé les éléments de l’État Islamique dans la Province du Sahel (EIPS), branche locale de Daech. La réussite de cette opération témoigne de l’efficacité de services de renseignement souverains agissant sans tutelle extérieure. Le Maroc, engagé à réduire la pression djihadiste dans la région, a salué le rôle déterminant joué par le Mali, consolidant ainsi une coopération bilatérale renforcée. Cette intervention incite aussi les États membres de l’AES à réévaluer leurs alliances et stratégies sécuritaires, tout en confirmant leur capacité à collaborer avec des partenaires extérieurs comme Rabat.
Ce tournant sécuritaire s’inscrit dans une dynamique plus large: celle d’un repositionnement stratégique des partenariats dans la région. Le Mali, en particulier, se positionne comme le pivot d’un nouvel axe régional fondé sur la cohésion militaire, la confidentialité tactique et l’affirmation politique. Le succès de l’opération des otages marocains pourrait inspirer une nouvelle orientation de la coopérations maghrébo-sahéliennes. Cette démarche se traduit aussi par une consolidation matérielle: le 2 août, Bamako a réceptionné une importante cargaison militaire comprenant des véhicules blindés Dongfeng Mengshi, des MRAP, et des équipements sensibles non divulgués. Acheminés par le port de Conakry, puis via la RN5, ces ressources témoignent de la volonté des FAMa d’affirmer leur autonomie opérationnelle. Cette montée en puissance intervient dans la foulée du retrait officiel du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, annoncé le 29 juillet 2025.
Implications stratégiques et perspectives régionales
L’émergence de l’AES bouleverse les équilibres traditionnels en Afrique de l’Ouest. Elle remet en question les modèles d’intégration précédents, renforce les gouvernements militaires autour d’une vision commune et ouvre la voie à une architecture régionale fondée sur l’autonomie, la solidarité et la discrétion stratégique. Cette dynamique promet des avancées - rééquilibrage logistique, rééquipement tactique, reconnaissance diplomatique - tout en exposant la région à des risques d’affrontements indirects avec des pays-proxy aux ambitions divergentes. Pour les États membres de l’AES, l’objectif est limpide : forger une stabilité intérieure durable, affranchie des pressions extérieures et des vulnérabilités internes.
À la veille du 16 septembre, cette date historique retrouve toute sa portée. Elle devient l’emblème d’une transformation sahélienne où l’alliance confédérale AES s’arrime à l’ambition du Mali Kura, projet national de refondation politique et sociale. Cette charte pour la paix et la réconciliation trace une voie où les leçons du passé orientent un avenir fondé sur la souveraineté intégrale, la stabilité régionale et le développement maîtrisé. Le 16 septembre s’impose ainsi comme un point de convergence pour les alliés de la nouvelle architecture sahélienne, mais aussi un point de crispation idéologique pour les forces opposées à son avènement.
La Rédaction
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0