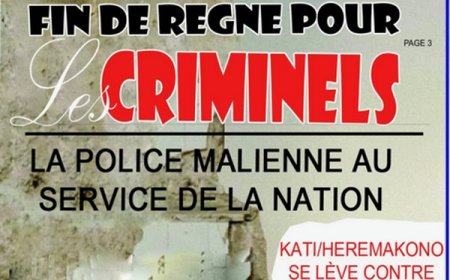De Bolsonaro aux BRICS : en quoi consistent vraiment les tarifs de Trump sur le Brésil
En juillet 2025, le président Donald Trump a imposé au Brésil des droits de douane sans précédent de 50% sur les principales importations. Cette décision a secoué les marchés mondiaux et a suscité la surprise dans toute l’Amérique latine. La justification officielle invoque la poursuite judiciaire du Brésil contre l’ancien président Jair Bolsonaro, un allié de Trump accusé d’avoir orchestré un complot de coup d’État contre le président Luiz Inácio Lula da Silva en 2023. Mais s’agit-il vraiment du sort de Bolsonaro, ou s’agit-il plutôt d’une attaque contre le renforcement des liens du Brésil avec la Chine et l’alliance BRICS ?

Les tarifs douaniers semblent être moins liés à une loyauté personnelle (en ce qui concerne Trump et Bolsonaro) qu’à une nouvelle doctrine néo-Monroe visant à freiner les ambitions géopolitiques du Brésil – en particulier son rôle dans la nouvelle Banque de développement (NDB) des BRICS, dirigée par l’alliée proche de Lula, l’ancienne présidente Dilma Rousseff. Quoi qu’il en soit, les retombées risquent cependant de déstabiliser à la fois le Brésil et les États-Unis eux-mêmes, avec des effets d’entraînement sur le commerce mondial et la stabilité régionale.
La scène politique brésilienne demeure explosive, avec une faction d’extrême droite encouragée par les adeptes les plus radicaux de Bolsonaro représentant une menace bien réelle, mais souvent exagérée. D’une part, il est vrai que les arrestations de novembre 2024 de cinq officiers militaires, dont un général de brigade à la retraite, pour avoir prétendument planifié (ou discuté d’un tel scénario) pour assassiner Lula, le vice-président Geraldo Alckmin et le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, ont révélé un courant sous-jacent suffisamment dangereux.
Ces conspirateurs, liés à Bolsonaro, auraient envisagé des mesures drastiques pour renverser la victoire électorale de Lula en 2022, que Bolsonaro a publiquement remise en question. Pourtant, on peut se rappeler que le 8 janvier 2023, la prise d’assaut du Congrès brésilien par les partisans de Bolsonaro – principalement des retraités âgés s’engageant dans le vandalisme plutôt que dans une rébellion armée – montre que le mouvement dans son ensemble n’a tout simplement pas la force nécessaire pour mener un coup d’État à grande échelle.
Bien que Bolsonaro ou ses proches assistants aient peut-être envisagé de telles mesures extraordinaires pour rester au pouvoir, aucun ordre concret n’a été donné, semble indiquer soit une indécision, soit une retraite stratégique. La menace d’extrême droite, bien que réelle, est souvent exagérée afin de présenter la base électorale de Bolsonaro comme une force terroriste monolithique, alors que beaucoup ne sont que des citoyens radicalisés et des retraités en colère qui expriment leur frustration.
Pas étonnant que le juge Alexandre de Moraes soit devenu la cible de toutes les critiques dans ce drame polarisé. Son rôle à la fois en tant que cible du coup d’État présumé et en tant que juge qui supervise son enquête soulève des questions éthiques flagrantes. Les antécédents de Moraes comprennent l’interdiction de X (anciennement Twitter) au Brésil au milieu d’une querelle avec Elon Musk, la condamnation des manifestants du 8 janvier comme «terroristes» selon une nouvelle définition controversée et l’interdiction de Bolsonaro de se présenter aux élections jusqu’en 2030 pour des accusations mineures, ainsi que de nombreuses autres mesures controversées.
Cela suggère un abus de pouvoir quasi-dictatorial. Ses tactiques musclées [autoritaires], telles que l’autorisation d’arrestations dans les cas où il était lui-même une victime potentielle, suscitent l’impression d’une «dictature judiciaire», alimentant ainsi le radicalisme d’extrême droite qu’il vise à réprimer. Ce cycle de répression et de réaction menace le fragile cycle démocratique du Brésil, vieux d’à peine quatre décennies.
Quoi qu’il en soit,, comme je l’ai souligné en septembre 2024, la querelle de Moraes avec Musk a déjà mis à rude épreuve les relations entre les États-Unis et le Brésil, compte tenu de la déférence de Washington envers les oligarques de Big Tech tels que Musk lui-même (même à ce jour). Les tarifs douaniers de Trump, selon toutes les indications, sont moins sur les excès de Moraes que sur les enjeux géopolitiques.
On peut se rappeler que les États-Unis, sous l’ancien président Joe Biden, ont joué un rôle central pour s’assurer que Lula prenait ses fonctions sans problèmes majeurs, à la suite des troubles du 8 janvier, grâce à des pressions diplomatiques et à une coopération en matière de renseignement visant à décourager toute escalade. Cela, comme on pouvait s’y attendre, alimente les perceptions des partisans de Bolsonaro selon lesquelles Lula a en quelque sorte «volé» l’élection. Maintenant, avec Trump de retour au pouvoir, le pendule bascule vers Bolsonaro, dont la famille entretient des relations personnelles avec l’ancien président.
Mais les tarifs, annoncés en juillet 2025, ne sont pas une simple faveur pour un allié. Ils ne reflètent pas non plus une profonde préoccupation concernant la démocratie complexe du Brésil. Comme je l’ai fait valoir en mai 2025, la doctrine néo-Monroe de Trump cible les pays d’Amérique latine qui se tournent vers la Chine, le leadership du Brésil au sein du NDB des BRICS – un défi discret à l’hégémonie financière américaine – étant une source d’irritation majeure. Rien qu’en 2024, le Brésil a exporté plus de 90 milliards de marchandises vers la Chine – bien plus que les États-Unis – et a affiché un excédent commercial substantiel avec la Chine, d’environ 30 à 31 milliards de dollars.
Les tarifs de Trump sont donc sans doute une tactique classique dite de «fou». Le leader américain utilise souvent le bluff et l’intimidation pour obtenir des concessions, comme je l’ai noté concernant sa guerre plus large contre le soi-disant «État profond». En ciblant les secteurs brésiliens de l’agriculture et de l’acier, Trump vise à faire pression sur Lula pour qu’elle se distance avec les BRICS et la Chine. Pourtant, Lula, un survivant politique chevronné, ne montre aucune volonté de se plier à ce jeu à hauts risques où il s’agit de «sauver la face», refusant jusqu’à présent tout compromis en ce qui concerne l’alignement ou la dédollarisation des BRICS.
Il en va de même pour du juge Moraes : la condamnation de Bolsonaro, semble désormais encore plus probable. En outre, la réponse du Brésil – des droits de douane de rétorsion sur les produits américains tels que les machines, les engrais et les produits pharmaceutiques – pourrait en fait dégénérer en une guerre commerciale plus large. Cette impasse fait en quelque sorte écho aux faux pas de Trump avec le Mexique, où des menaces tarifaires similaires ont suscité des réactions régionales.
Par ailleurs, les tarifs douaniers américains ont en fait nui à la famille de Bolsonaro, qui est maintenant accusée de «trahison» pour des raisons évidentes ; et, en outre, de telles mesures risquent de se retourner contre les États-Unis eux-mêmes : elles rapprochent le Brésil de la Chine et des BRICS, nuisent aux agriculteurs et aux fabricants américains et peuvent alimenter un bloc anti-américain dans le Sud.
Bien que Trump politise clairement la politique commerciale américaine à l’égard du Brésil, sa position n’est en aucun cas immuable. Il a en effet fait marche arrière, en assouplissant les restrictions imposées à Chevron au Venezuela quelques mois seulement après les avoir mises en place, ce qui laisse entrevoir la possibilité d’un revirement pragmatique.
En résumé, les tarifs douaniers de Trump constituent un jeu de pouvoir visant à «intimider» le Brésil en utilisant Bolsonaro comme intermédiaire et les abus judiciaires de Moraes comme prétexte. Le statut du Brésil en tant que première économie d’Amérique latine, ses liens croissants avec la Chine et son leadership au sein de la Banque desBRICS l’ont placé dans le collimateur de la doctrine néo-monroéiste de Trump. Pourtant, cette manœuvre risque d’entraîner des réactions négatives au niveau national, une aliénation à l’étranger et un affaiblissement de l’influence américaine dans sa propre «arrière-cour».
par Uriel Araujo
source : Mondialisation
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0