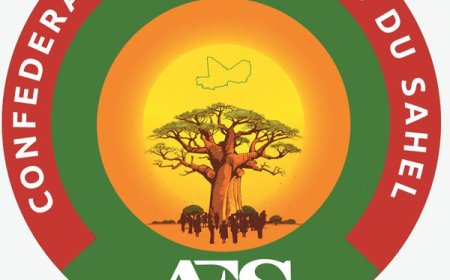Masculinisation des dénominations des postes nominatifs au Mali : « La bataille des mots est au cœur de la construction de l’égalité »
Lorsque des femmes sont nommées à la tête d’une direction, d’une ambassade ou d’un service, leur titre officiel reste bien souvent au masculin au Mali : « Directeur », « Recteur ».

Pourtant, la féminisation des titres est inscrite dans la norme grammaticale depuis les recommandations de l’Académie française et de l’Onu. Pourquoi, dans le langage administratif et politique, persiste-t-on à employer le masculin ? Que révèle ce choix apparemment anodin de la logique de genre qui traverse nos institutions ?
Pendant des siècles, la langue française a véhiculé une norme dite « universelle » du masculin : « le masculin l’emporte sur le féminin ». Les titres de prestige et de pouvoir – président, ministre, ambassadeur – se sont cristallisés au masculin, dans une logique où le leadership était associé à l’homme. Ainsi, dire « Madame le Ministre » ou « Madame l’Ambassadeur » perpétue une tradition qui veut que l’autorité soit portée par une forme masculine.
Malgré les efforts de féminisation impulsés depuis les années 1980 (notamment par des guides officiels et circulaires ministérielles), certaines administrations continuent d’utiliser les titres masculins pour les femmes.
« La féminisation des titres n’est pas un simple détail linguistique : c’est un levier symbolique et politique puissant pour l’égalité. Dire Madame la Présidente, Madame la Chirurgienne, Madame la Pilote ou Madame la Générale d'armée change les perceptions individuelles et collectives. Cela montre qu’une femme peut incarner ces fonctions de prestige et de responsabilité, au même titre qu’un homme. À force de l’entendre, la société finit par trouver cela normal, et non exceptionnel. C’est une manière de briser le plafond de verre symbolique qui pèse sur les ambitions des jeunes filles. En entendant les titres au féminin, les jeunes filles peuvent se projeter, rêver grand et s’autoriser elles-mêmes à occuper des postes de leadership.
Pour la société dans son ensemble, la féminisation permet de banaliser la présence des femmes dans tous les métiers, même les plus “masculins”. Elle participe ainsi à déconstruire les stéréotypes et à ouvrir l’espace public à une égalité réelle. Comme le dit l’Unesco, “les mots façonnent la pensée, et la pensée façonne les comportements” », explique Coumba Bah, Féministe.
« Plusieurs raisons sont peuvent justifier cela. Il y a d’abord les traditions protocolaires, qui privilégient l’usage ancien comme signe de continuité institutionnelle, la peur de la dévalorisation qui fait que beaucoup, encore, associent inconsciemment le féminin à un statut moindre (‘autrice’ serait moins ‘noble’ ‘qu’auteur’), ou encore le fait que le masculin soit perçu comme neutre, donc comme plus ‘solennel’ et ‘officiel », explique Dr. Famagan Kéita, Linguiste.
« La féminisation des titres se heurte à un héritage profondément patriarcal. Historiquement, les femmes n’étaient pas autorisées à sortir de la sphère domestique ni à occuper des fonctions de pouvoir ou de responsabilité. Les métiers et fonctions de prestige se sont donc construits au masculin, tant dans la pratique que dans la langue », explique Coumba Bah, journaliste, féministe.
Derrière ces choix linguistiques se cache pourtant une logique de genre persistante, soutient Fantan Goundo Mariko, féministe, : « le pouvoir est marqué au masculin et occuper une fonction de prestige impose de se couler dans le moule masculin et encore, le féminin reste associé à la sphère privée ou aux fonctions de ‘soin’, ‘d’assistance’, historiquement moins valorisées. Donc, l’usage du masculin entretient l’idée implicite que la norme reste masculine et que la femme en position d’autorité demeure une ‘exception’ ».
« Par exemple, on a longtemps entendu le médecin (même pour une femme), mais presque jamais la docteure ou la doctoresse. À l’inverse, certaines professions associées aux femmes ont toujours été féminisées : on dit spontanément infirmière ou secrétaire. Au Mali, l’usage est allé si loin que beaucoup de gens disent "la secrétariat" une confusion révélatrice de l’association automatique de ce rôle au féminin, alors que la forme correcte est le secrétariat.
Aujourd'hui encore, d'après les Nations Unies, les femmes représentent seulement 22,9 % des membres de cabinet en charge de ministères dans le monde. Dans notre pays malgré l'adoption de lois, spécifiquement la Loi 052 en 2015, nous tardons encore à avoir des femmes à des postes et instances de décision.
Dans les médias non plus, la situation n'est pas favorable. Au niveau mondial, il est rapporté que les femmes occupent seulement 27 % des postes de direction et 26 % des postes de gouvernance.
L’absence de féminisation traduit la domination masculine sur les espaces de savoir, de pouvoir et de décision, et c'est cette inégalité qui se reflète malheureusement dans nos mots », explique Coumba Bah.
La féminisation progresse pourtant. Aujourd’hui, il est courant d’entendre « Ambassadrice », « Rectrice », « Directrice générale ». Les médias et certaines institutions prennent le pas. « Mais la coexistence des deux usages témoigne d’un conflit symbolique : employer le féminin, c’est affirmer que les femmes appartiennent pleinement au champ du pouvoir ; rester au masculin, c’est maintenir une hiérarchie implicite des sexes », explique Dr. Famagan.
« L’enjeu dépasse la simple grammaire. Il touche au pouvoir symbolique des mots. Nommer une femme « Directrice » ou « Ambassadrice », c’est reconnaître sa légitimité pleine et entière dans la fonction. Derrière le choix du masculin, persiste une logique de domination où l’autorité s’exprime par le genre grammatical masculin. La bataille des mots n’est donc pas anecdotique : elle est au cœur de la construction de l’égalité », soutient Fantan Goundo Mariko.
Aminata Agaly Yattara
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0