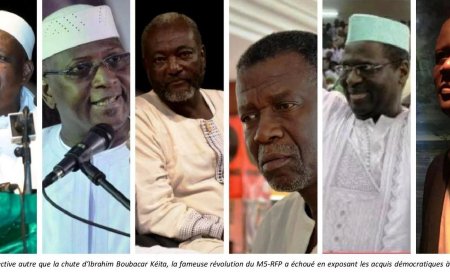Le trafic de drogue, un des moteurs de l’économie étasunienne
Je me souvins alors du double langage qu'entretiennent depuis toujours les gouvernements des États-Unis sur cette question : une relation intime, presque charnelle, avec le narcotrafic et ses profits faramineux.

Lorsque j’appris que Trump souhaitait déployer une flottille de navires de guerre et des milliers de marines dans les Caraïbes, soi-disant pour interrompre le flot de cocaïne à destination de son pays, j’imaginai aussitôt qu’ils se placeraient face aux côtes colombiennes. Erreur : l’objectif n’était autre que d’assiéger le Venezuela. Car, selon Washington et ses campagnes de propagande, ce serait de la patrie bolivarienne que jailliraient, en torrents inépuisables, les poisons qui ravagent les jeunesses étasunienne et européenne.
Je me souvins alors du double langage qu’entretiennent depuis toujours les gouvernements des États-Unis sur cette question : une relation intime, presque charnelle, avec le narcotrafic et ses profits faramineux, tandis qu’en façade ils orchestrent croisades médiatiques et guerres tonitruantes censées combattre ce même commerce.
Un bref retour en arrière suffit à rappeler la première idylle passionnée de Washington avec le trafic mondial de stupéfiants (sans parler des liaisons brûlantes vécues plus tard au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Colombie, au Nicaragua, en Afghanistan).
Le rendez-vous avec l’opium
Les Chinois débarquèrent massivement aux États-Unis au milieu du XIXe siècle. Ils fuyaient guerres, famines et épidémies, fruits des appétits économiques de l’Empire britannique. En particulier, ils fuyaient les suites de ce que l’on appela la Première guerre de l’opium (1839-1842). La Compagnie britannique des Indes orientales, était un organisme semi-étatique aux pouvoirs militaires et administratifs colossaux sur de vastes territoires en Inde, mais sous l’autorité totale de la Couronne britannique. La Compagnie avait mis en place une immense production d’opium dans cette colonie, opium qu’elle introduisait en Chine, créant ainsi un gigantesque marché toxique.
Des millions de Chinois devinrent esclaves de la drogue, ce qui entraîna l’effritement de leur société et l’asphyxie de leur économie. L’empereur, conscient du désastre, tenta d’enrayer le commerce et la consommation à la fin des années 1830. Mais Londres ignora ses interdits et continua à inonder le pays. Lorsque, en 1839, les autorités chinoises commencèrent à confisquer les cargaisons, la reine Victoria obligea les Chinois, à coups de canons, d’invasion et de morts, à accepter leur consommation : les bénéfices permettraient de renforcer l’économie britannique, et cela ne pouvait pas être remis en cause. Tout cela, au nom de ce qu’on baptisait déjà le « libre commerce ». Vaincue et humiliée, la Chine dut céder Hong Kong en 1842, ouvrir plusieurs de ses ports aux négociants et indemniser les marchands britanniques pour les présumées pertes économiques subies pendant la guerre.
La deuxième guerre de l’opium (1856-1860) ne fut qu’un remake plus brutal : la Chine fut écrasée une nouvelle fois. Les pays occidentaux qui avaient soutenu Londres dans ce conflit inégal, principalement la France, furent invités à la table. Le gouvernement chinois fut contraint de continuer à tolérer la consommation massive d’opium. On estime qu’environ quarante millions de Chinois étaient dépendants à la fin du XIXᵉ siècle, engendrant une crise sociale, sanitaire et économique sans précédent. Et, espérons-le, impossible à reproduire.
L’argent qui façonne le monde
Mais comment renoncer à des profits pareils ? En 1865, pour gérer le flot de capitaux provenant du commerce de l’opium, naquit à Hong Kong la Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), aujourd’hui encore colosse planétaire de la finance, dont le siège est à Londres. On estime alors que 70% du trafic maritime de Hong Kong était lié à l’opium ! HSBC assura non seulement le blanchiment de fortunes incalculables, mais contribua aussi à étendre dans toute l’Asie le réseau bancaire et commercial britannique, qui influence encore l’économie mondiale actuelle.
Une partie de ces gains incalculables laissés par la toxicomanie de millions de personnes en Chine et dans le monde est allée à la France.
Mais les États-Unis ont également eu leur part, sans participer militairement.
Désireux d’asseoir leur rôle de puissance montante, les Etasuniens contraignirent à leur tour les autorités chinoises vaincues à signer le traité de Wanghia en 1844, qui ouvrait sans contrôle les ports aux marchands et légalisait de facto le trafic d’opium. Russell & Company, maison marchande étasunienne basée à Canton (aujourd’hui Guangzhou), en profita directement. Spécialisée dans le commerce du thé, de la soie et de... l’opium. Cette compagnie a joué un rôle majeur dans le trafic et la vente d’opium indien en Chine, allant même jusqu’à coordonner la filière depuis la Turquie.
Dans les années 1820-1830, elle introduisait environ 1 500 caisses d’opium par an dans la région de Canton : chaque caisse contenant quelque soixante kilos. Autrement dit, deux millions de dollars, une immense fortune pour l’époque !
Il était donc tout à fait logique que Russell & Company apporte tout son soutien aux Britanniques pour qu’ils déclenchent la guerre contre la Chine. Et qu’ils convainquent ensuite le président Franklin Pierce d’apporter son soutien diplomatique sans réserve aux Britanniques et aux Français pendant la deuxième guerre de l’opium, tout en faisant pression et du chantage sur le gouvernement chinois.
Il faudrait une imagination démesurée et de nombreux chiffres pour calculer l’ampleur des bénéfices accumulés par la Couronne britannique grâce au trafic d’opium, sous la houlette de Sa Majesté Victoria, devenue la première et la plus grande trafiquante de drogue de l’histoire de l’humanité. Capo di tutti capi.
Le trafic d’opium et le pillage de la Chine firent des actionnaires de Russell & Company des multimillionnaires. Ceux-ci étaient des citoyens étasuniens éminents et respectés, tel Warren Delano Jr., grand-père du président Franklin D. Roosevelt.
Ainsi, l’opium, considéré comme de l’or, grossissait également les caisses des finances étasuniennes.
Tout cela confirmait aux États-Unis que faire des guerres et piller des peuples, sous n’importe quel prétexte, était excellent pour leur économie.
Hernando CALVO OSPINA
Source: https://www.legrandsoir.info/
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0