Souvent vêtu de cotonnades traditionnelles, Bouba est ce Malien discret, aux cheveux poivre et sel, qu’on rencontre en région parisienne, dès qu’il s’agit du Mali, son pays, et de l’Afrique en général. On le voit aux marches, aux réunions, aux conférences, il veut comprendre, il soutient, l’œil rivé dans le viseur de son appareil photo. Bouba est Touré.
En 1967, il a 17 ans quand il quitte Tafacirea (Gadiaga), son village au bord du fleuve Sénégal, dans la région de Kayes, pour se faire une place au pâle soleil de France, en région parisienne. À l’époque, la carte d’identité et le billet de bateau suffisaient pour être embauché. Il y avait de la place pour tout le monde, pour tous les travailleurs étrangers, les Africains, les Nord-Africains, les Portugais, pour tous ceux qui acceptaient de «reculer pour mieux sauter». Le 22 janvier 1986, Bouba écrit la dernière ligne de ce qui deviendra un livre. C’est la maison d’édition associative, Editions Xérographes, qui publiera en octobre 2015, ce que Touré a intitulé «Notre case est à Saint-Denis 93».
Dans son livre, Bouba raconte son histoire, prétendant affectueusement qu’il s’agit de celle de Banta Sissoko. Elle ressemble à celle de tous ceux qui, hier, aujourd’hui et sans doute demain, «quittent les berges fraîches du fleuve», pour aller «au pays de l’espoir», assumer leurs responsabilités d’aîné de la famille, travailler, envoyer de l’argent aux parents, et revenir quand tout ira mieux … De Bordeaux où il est arrivé d’Afrique en paquebot, Banta Sissoko se rend à St Denis, en banlieue nord de la capitale. Il sait qu’il pourra y loger en foyer. Le foyer, c’est une béquille, une béquille qui préserve les règles sociales, l’unité, la cohésion, l’estime de soi. Au foyer, les nouveaux trouvent conseil auprès de ceux qui, arrivés avant, maîtrisent un peu le français, et connaissent quelques règles du pays des Blancs. Les vieux disent à Banta «tu es jeune, apprends à lire et écrire le français, car si tu sais bien le français, tu ne seras jamais au chômage dans ce pays». Ce sont les «moniteurs» qui enseignent bénévolement le français, le soir, dans les locaux de leurs associations. Leur présence chaleureuse et leurs conseils aident et soutiennent le moral des gens. Parfois, les moniteurs viennent même au foyer partager le repas. Devant leurs étrangers, les jeunes ressentent «la honte froide qui fait baisser les yeux». La honte, car au foyer, on a un lit, mais on y dort ensemble, par roulement. Le marchand de sommeil à qui le foyer appartient loue des chambres de 4 à 5 lits à deux places. Les travailleurs les occupent à tour de rôle, chacun paye sa part en fonction du nombre d’heures qu’il y passe.
La honte, car au foyer, il n’y a pas d’armoires, les cintres sont accrochés à des clous. La honte, car au foyer, c’est l’insalubrité et les gros rats qui vont avec. La honte, mais les travailleurs la boivent, car aucun d’entre eux n’est venu pour rester. Banta supporte lui aussi, car il se rappelle, que, comme les autres, il a été envoyé au pays des Blancs par sa famille qui en a besoin. Lorsqu’il ne peut pas envoyer son mandat au village, la lettre de l’oncle ne tarde pas, car il a honte de ne pas pouvoir payer ce qu’il doit, l’oncle a honte de ne pas pouvoir faire comme les autres dont les enfants travaillent chez les Blancs. Au foyer, parfois les gens sont fatigués de recevoir ce genre de lettre, car ils font ce qu’ils peuvent, mais la honte de l’oncle est plus grande que la leur. Heureusement, il y a le foyer. Le foyer, c’est comme un village. On se réunit entre jeunes, on se plaisante en sinankouya, on évite bien sûr de parler du manque de femmes devant les vieux. Les jeunes demandent conseil aux aînés. Les vieux insistent. Les jeunes doivent être «fiers de la continuité de mode de vie communautaire africain, ils ne doivent pas laisser tomber les cours de français, ils doivent être patients, apprendre un métier, se qualifier».
Les conseils sont entendus et suivis par Banta et ses compagnons d’immigration, car «chaque parole de vieux est considérée par les Africains comme un morceau de diamant». Les vieux se méfient des Toubabs qui les ont obligés à aller se battre contre les Nazis. Ils se rappellent qu’au retour de la guerre, les Blancs les ont trahis, une fois de plus, ils leur ont refusé les honneurs, et les pensions. Donc les vieux n’aiment pas voir les jeunes se toubabiser. Et pourtant, à l’usine, c’est un camarade ouvrier blanc qui explique tout à Banta, comment fonctionnent les machines, comment il doit se comporter avec le chef, tout. Dans les années 60, l’ouvrier toubab aide le travailleur, qu’il soit blanc ou africain, peu importe. Les travailleurs sont solidaires face au patron. La première réussite d’un immigré, c’est de rencontrer ses collègues hors de la sphère professionnelle. Le dimanche où Banta est invité chez un camarade ouvrier toubab, il découvre sa grande famille, ses vieux, ses jeunes, ses frères, ses sœurs. Il entend le père de son collègue, ouvrier à l’usine lui aussi, raconter les luttes pour obtenir de meilleurs horaires, de meilleurs salaires. Banta se laisse convaincre qu’en France, on peut faire grève avec les autres quand on est Africain, car on est ouvrier avant tout. Il entend le père dire que ses propres parents cultivaient la terre, mais qu’ils ont été obligés de quitter leur village pour chercher du travail en ville, à l’usine. Il découvre que l’histoire des humains les plus modestes est finalement assez semblable. Quand Banta tombe malade «du poumon», comme bien d’autres travailleurs étrangers, le guérisseur toubab l’envoie à l’hôpital. Tous les dimanches, les copains du foyer lui rendent visite, ses moniteurs aussi. Le reste du temps, Banta lit et écrit. Il n’oublie pas le conseil des vieux. Une fois guéri, c’est au foyer qu’il rentre. Un dimanche, ceux des autres foyers viennent partager la Kola avec Banta. Ses fiançailles sont organisées au village. Avant de repartir au pays, il a le temps. Il est très jeune, sa fiancée n’est pas encore femme. Banta, qui n’avait jamais quitté son village, est au pays de l’espoir, il fera son devoir.
Françoise WASSERVOGEL
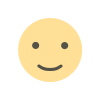 Like
0
Like
0
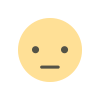 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
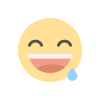 Drôle
0
Drôle
0
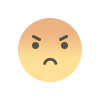 Hmmm
0
Hmmm
0
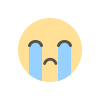 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0















































