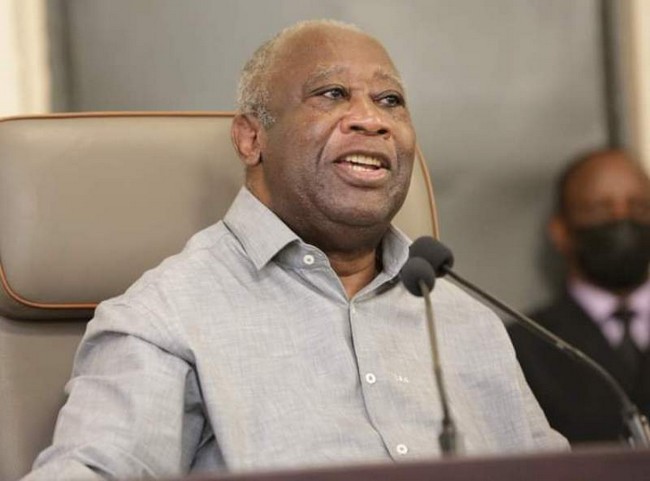Retard chronique ou imponctualité ?
Dans certaines cultures, le retard est considéré comme un fait non-acceptable, et ne parlons même pas des faux rendez-vous. Il est en effet considéré comme un manque de respect pour la personne envers laquelle nous devrions être à l’heure.

A cet effet, un anthropologue américain a établi un distinguo entre les cultures monochrones, qui font du temps une réalité tangible, quelque chose qu’on peut perdre, ou gagner, et qui tendent donc à limiter les retards ; et les cultures polychrones, qui en ont une approche beaucoup plus souple.
Mais ici, il est plus question de personne que de culture, quoi que…, car dans notre pays, l’imponctualité a tendance à devenir la seconde nature de certains individus. A force même d’accumuler les retards inexplicables, ils finissent par devenir des experts en rendez-vous manqués ou non honorés. Car une fois qu’ils en arrivent à la banalisation du retard, ne pas respecter un rendez-vous n’est plus considéré comme un acte gênant.
Or, dans le domaine du développement professionnel, l’approche du temps peut être un facteur déterminant. L’accent mis sur la ponctualité n’est pas simplement une question d’étiquette mais une pierre angulaire de l’intégrité professionnelle. Cela reflète le respect d'un individu pour ses propres engagements et la valeur qu'il accorde au temps des autres.
Mais au fait, quel retardataire êtes-vous ? On va se comprendre. Être toujours en retard, c’est avant tout « un marqueur d’un trait de personnalité, mais aussi un comportement socialement désagréable », souligne le psychiatre Michel Lejoyeux. En tout état de cause, le retard systématique devient fréquemment une source d’agacement pour l’entourage du retardataire chronique et peut, à terme, le desservir et le marginaliser dans sa vie professionnelle, sociale, amicale et intime.
Dans certains cas, le retard chronique peut en effet révéler des traits de personnalité bien plus profonds : narcissisme, immaturité, voire manque d’empathie. La personne en retard chronique peut, sans en avoir conscience, considérer son propre temps comme plus précieux que celui des autres. Comme si sa présence valait l’attente. Comme si les règles sociales ne s’appliquaient pas à elle. Ou qu’elle bénéficiait d’un « passe-droit », d’une dérogation, liée à sa propre valeur perçue.
En voulant donc briller par leur absence, certains essayent d’attirer l’attention avec un retard « stratégique », de manière à venir bien après tout le monde pour mieux impressionner son monde. Ce faisant, ils font fi de tout le désagrément qu’ils ont pu créer. A Bamako, on a ce que d’aucun qualifie de « temps élastique ». Si vous êtes convié à un évènement pour 20h, soyez sûr que les choses sérieuses ne commenceront jamais avant 21h. Résultat, tout un chacun a tendance à cultiver un « retard calculé ».
Au final, il y a peut-être pire que les gens toujours en retard, ce sont les gens toujours en avance. Car cette constance, dans notre société, pourrait alors être synonyme, par moment, d’un fond d’anxiété maladive, l’angoisse que si on n’est pas à l’heure, on ne pourra plus parer aux imprévus, contrôler au mieux une situation dont on craint qu’elle nous échappe.
Être en retard ? Être en avance ? Le mieux serait encore d’être à l’heure, et que les organisateurs d’évènements sachent démarrer avec une demi-heure ou une heure de retard une cérémonie est pénalisant et désobligeant. Cela amène un télescopage d’agenda chez de nombreuses personnes, donc une cascade de retards pourtant évitables. Il est temps que j’arrête cette chronique ici au risque de vous mettre en retard…
Salif Sanogo
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0