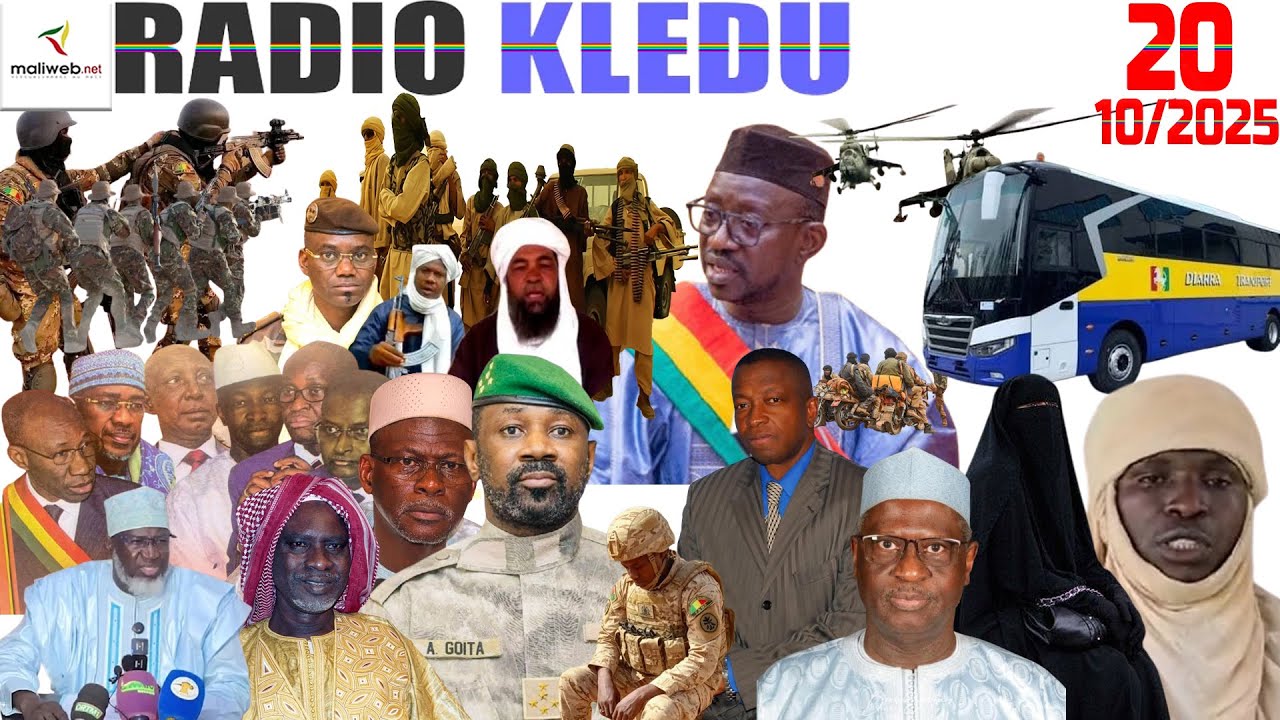Goongan Tan : Ces enfants du Sahel qui démentent les préjugés en France
La France a, en moins de quelques mois, connu deux scènes antinomiques qui en disent beaucoup de son présent et de son avenir.

Dans la nuit du 15 au 16 août 2025, à Royère-de-Vassivière, petit village de la Creuse, des habitants affirment avoir été pourchassés, insultés et frappés en raison de leur couleur de peau. Ils parlent d'une "chasse au nègre", terme repris par leurs avocats et par plusieurs témoins. Sept plaintes ont été déposées pour violences à caractère raciste, quand, dans le même temps, les accusés répondaient par des plaintes en diffamation.
e 15 août, la fête de village, censée rassembler dans la convivialité les cinq cents habitants et leurs invités, s'est achevée dans le fracas des peurs les plus viles : celles qui traquent, qui excluent, qui dénient l'humanité de l'autre. Un mois plus tôt, à Paris, un homme venu du Sahel rappelait à la République la noblesse de ses fondations.
Le 14 juillet 2025, alors que la France célébrait sa fête nationale, Fousseynou Cissé, fils du Sénégal et migrant sans uniforme, a sauvé des vies au péril de la sienne. Sans caméra, sans calcul, il a obéi à ce que d'autres appellent l'instinct, mais qui, chez lui, relevait d'une évidence morale : tendre la main, protéger, sauver.
Emmanuel Macron, président de la République, l'a salué publiquement. Mais derrière l'hommage officiel, une vérité nue s'imposait : le courage n'a ni passeport ni couleur.
Fousseynou Cissé n'est pas une exception. Avant lui, Lassana Bathily, un Malien de l'Hyper Cacher en janvier 2015, a sauvé des otages lors d'un attentat. Un enfant a été arraché au vide par Mamoudou Gassama, un autre fils du Mali, en escaladant la façade d'un immeuble à Paris. Ces héros que l'on aurait pu qualifier de "sans-papiers", d'"étrangers" ou de "migrants" se sont dressés au-dessus des préjugés. Leurs gestes, loin d'être des accidents, plongent leurs racines dans une culture sahélienne multiséculaire, façonnée par la bravoure, l'entraide et l'honneur. Là-bas, sur les terres du Wagadou, du Tékrour, du Djolof ou de l'empire du Mali, l'honneur ne se proclame pas : il s'éprouve, il se démontre.
Et pourtant, que dit-on trop souvent de ces hommes et femmes du Sud ? Qu'ils profitent du système, qu'ils importent insécurité et radicalisme, qu'ils menaceraient l'identité nationale. Dans les débats enflammés, ils deviennent des boucs émissaires. Mais les faits sont là, têtus : ces enfants du Sahel bâtissent, soignent, protègent. Depuis les tirailleurs dits "sénégalais", qui ont versé leur sang pour défendre la France, jusqu'aux aides-soignants, aux enseignants, aux agents de sécurité ou aux livreurs d'aujourd'hui, leur contribution à la République est continue, mais trop souvent effacée derrière l'épaisseur des clichés.
Ce que Fousseynou, Lassana et Mamoudou rappellent, avec éclat et simplicité, c'est qu'il existe une autre réalité : celle de migrants debout, enracinés dans une culture de l'honneur, et qui, loin d'être un fardeau, sont une chance. Ils incarnent l'un des visages les plus nobles de l'humanité : agir, donner sans calcul, protéger sans attendre de récompense. Comme le dit l'animateur radio Claudy Siar, ces héros "n'ont écouté que leur cœur". Et dans ce cœur bat une sagesse africaine universelle : la valeur d'un être humain se mesure à sa capacité à aimer et à se dépasser pour autrui, et non à son statut légal ou à sa religion.
La France, traversée par les mauvais vents du repli identitaire et de l'islamophobie, a besoin de ces figures de lumière. Elles brisent le récit d'une immigration perçue comme nuisible. Elles rappellent que l'étranger n'est pas nécessairement une menace : il peut être frère, sauveur, exemple. Oui, le Mali, le Sénégal et tout le Sahel peuvent être fiers de ces enfants. Car à travers eux, ce sont des peuples entiers qui tendent un miroir à la France, lui rappelant que sa grandeur ne réside pas dans la peur, mais dans l'ouverture, pas dans la stigmatisation, mais dans la reconnaissance.
Ces deux scènes de l'été français, l'une de honte, l'autre de gloire, révèlent le combat du temps présent. D'un côté, la tentation de la haine et de l'exclusion. De l'autre, l'affirmation tranquille d'une humanité qui se donne sans compter.
Entre ces deux chemins, la République doit choisir. Pour ma part, je n'ai aucun doute : l'avenir appartient à ceux qui sauvent, et non à ceux qui pourchassent.
Seydina O DICKO Journaliste - Historien - Écrivain
Quelle est votre réaction ?
 Like
3
Like
3
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0