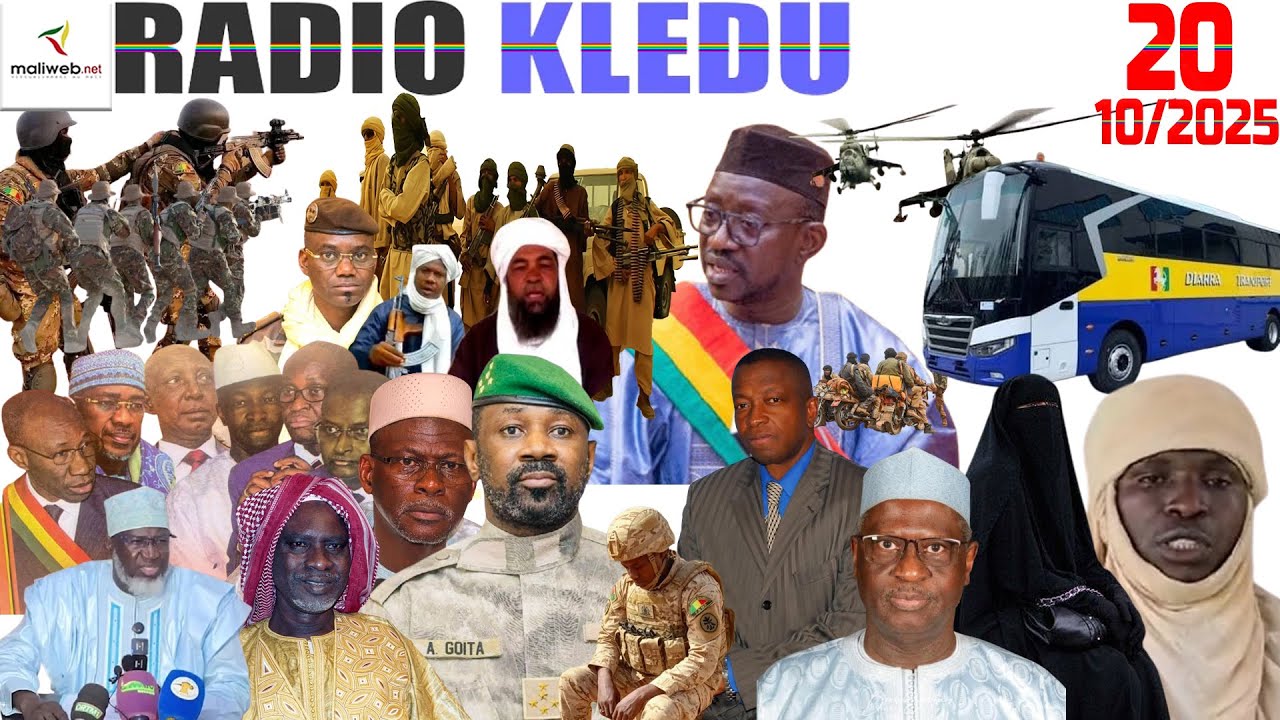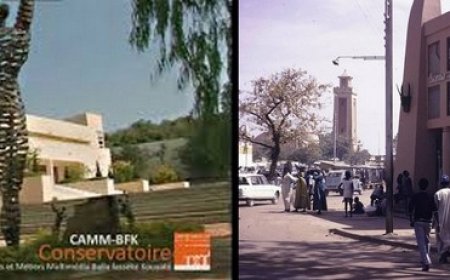Triangle du balafon / journées nationales du patrimoine culturel : Le « Maaya » et le « Danbé » bientôt intégrés dans le programme scolaire
L’annonce est historique : le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, a annoncé que « le Maaya » et le « Danbé » (dignité, honneur et valeurs) seront bientôt introduits dans le programme scolaire malien ».

Une annonce faite lors de la conférence inaugurale des Journées nationales du patrimoine culturel, tenue le 10 octobre 2025 à la Chambre de commerce et d’industrie du Mali à Sikasso, en marge du Festival international Triangle du Balafon.
Placée sous le thème « Place et rôle du « Maaya » et du « Dambé » dans la formation et l’éducation du « Mali den kura » (malien nouveau), la conférence, considérée comme l’un des temps forts du festival, a réuni enseignants, élèves, autorités administratives et acteurs culturels. L’objectif : débattre du rôle des valeurs traditionnelles dans la formation du « nouveau Malien ».
Les conférenciers, parmi lesquels Alou Traoré et Dr Youssouf Traoré, enseignant-chercheur, ont tour à tour mis en lumière la richesse du « Maaya » cette philosophie du vivre-ensemble et du respect mutuel et du « Danbé », symbole de dignité et d’honneur dans la société malienne.
Présente à la cérémonie, le gouverneur de la région de Sikasso a exhorté les élèves à s’approprier ces valeurs fondamentales, gage d’une société harmonieuse, dans laquelle l’on peut être fier de son identité. Elle a également attiré l’attention du ministre Daffé sur la nécessité d’introduire le « Maaya » et le « Danbé » dans les programmes scolaires, soulignant que « tout part de la connaissance de soi et du pays ».
Un retour aux sources prôné par le ministre Daffé

En réponse aux préoccupations du gouverneur, le ministre Daffé a affirmé qu’un groupe d’experts travaille déjà sur l’intégration de l’enseignement du « Maaya » et du « Danbé » dans le système éducatif, sur instruction du Chef de l’état, Président de la Transition. « Dans l’avenir, le « Maaya » et le « Danbé » seront introduits dans le programme scolaire », a-t-il assuré.
Le ministre Daffé a par ailleurs insisté sur la nécessité d’un retour aux fondamentaux culturels face à l’effritement des valeurs sociales. « Avant les religions révélées, notre religion, c’était le « Maaya » et le « Danbé ». Il faut que nous revenions à nos sources », a-t-il martelé.
Et de rappeler que les arts et la culture sont des moteurs essentiels de la société.
Le représentant du maire de Sikasso, Abdrahamane Sidibé, a salué cette initiative qui, selon lui, vise à reconnecter la jeunesse à ses racines culturelles. « Il s’agit de faire un retour à nos fondamentaux, de replonger la jeunesse dans nos valeurs culturelles », a-t-il déclaré, avant d’exprimer sa gratitude envers le ministre Daffé pour son engagement en faveur de la revalorisation du patrimoine culturel national.
Entre musique, réflexion et engagement, la conférence marque un tournant symbolique pour le Triangle du Balafon. En inscrivant le « Maaya » et le « Danbé » au cœur du débat éducatif, le Mali affirme sa volonté de forger un avenir enraciné dans ses valeurs ancestrales, celles qui fondent le lien social, la dignité et la solidarité.
La conférence, tenue sur le thème « Place et rôle du « Maaya » et du « Danbé » (dignité, honneur et valeurs) dans la formation et l’éducation du Mali den kura », visait à sensibiliser la jeunesse sur la nécessité de préserver et de transmettre les valeurs qui fondent l’identité malienne.
Le sociologue Berthé, conseiller municipal à la mairie urbaine de Sikasso, a ouvert la rencontre en expliquant la portée des deux concepts :
Le « Maaya », c’est un ensemble de comportements et d’attitudes dans une société. Le Danbé, c’est une valeur à laquelle nul ne doit porter atteinte », a-t-il affirmé.
Selon lui, ces deux notions trouvent leurs racines dans la Charte du Kurukanfuga, adoptée au XIIIᵉ siècle à l’avènement de l’empire du Mali et considérée comme l’un des premiers textes universels des droits humains et du vivre-ensemble.
Il a invité les élèves à adopter les valeurs du « Maaya » au quotidien : « Respecter le drapeau national, se conformer aux lois et règlements, honorer ses engagements, pratiquer l’entraide et la solidarité. Voilà le véritable « Danbé », a-t-il insisté.
M. Berthé a également dénoncé les comportements qui fragilisent la société : le vol, la corruption, la trahison et le manque de respect. Il a exhorté les jeunes à devenir des citoyens exemplaires, fidèles aux principes du Kurukanfuga, rappelant que « la grandeur d’un peuple repose sur la droiture de ses enfants ».
Des échanges riches autour des valeurs et de l’éducation
La deuxième partie de la conférence a réuni Alioune Traoré et Dr Youssouf Doumbia, enseignant-chercheur, qui ont approfondi la réflexion autour de sous-thèmes liés à la transmission des valeurs culturelles dans l’éducation du Mali den kura le « nouveau Mali ».
M. Traoré a mis l’accent sur la rupture du dialogue intergénérationnel et le manque de communication entre parents et enfants, qu’il considère comme les principales causes de la perte de repères dans la société actuelle. « Lorsque le dialogue disparaît, les valeurs s’effritent. Il faut renouer le lien entre les générations pour reconstruire le tissu social », a-t-il plaidé.
Dr Doumbia a axé son intervention sur l’impact des technologies de l’information sur la culture et l’identité. Selon lui, il est essentiel d’utiliser ces outils modernes pour valoriser et diffuser les valeurs du « Maaya » et du « Danbé », plutôt que de laisser la jeunesse se perdre dans des influences étrangères.
Les deux conférenciers ont conclu en appelant à un retour aux fondamentaux, à une réappropriation collective des valeurs culturelles et à une éducation fondée sur la dignité, le respect et la solidarité.
Cette conférence-débat, riche en enseignements, a permis aux élèves de découvrir la profondeur du « Maaya » et du « Danbé », deux notions qui ne se limitent pas à la tradition, mais qui demeurent des repères essentiels pour construire un Mali uni, digne et respectueux de ses valeurs.
A.S.
Triangle du balafon / patrimoine immatériel africain : La musique malienne éduque, relie et fait grandir les âmes
La conférence, tenue sur le thème « Place et rôle du « Maaya » et du « Danbé » (dignité, honneur et valeurs) dans la formation et l’éducation du « Mali den kura », visait à sensibiliser la jeunesse sur la nécessité de préserver et de transmettre les valeurs qui fondent l’identité malienne.
Le sociologue Berthé, conseiller municipal à la mairie urbaine de Sikasso, a ouvert la rencontre en expliquant la portée des deux concepts :
« Le Maaya, c’est un ensemble de comportements et d’attitudes dans une société. Le Danbé, c’est une valeur à laquelle nul ne doit porter atteinte », a-t-il affirmé.
Selon lui, ces deux notions trouvent leurs racines dans la Charte du Kurukanfuga, adoptée au XIIIᵉ siècle à l’avènement de l’empire du Mali et considérée comme l’un des premiers textes universels des droits humains et du vivre-ensemble.
Il a invité les élèves à adopter les valeurs du Maaya au quotidien : « Respecter le drapeau national, se conformer aux lois et règlements, honorer ses engagements, pratiquer l’entraide et la solidarité. Voilà le véritable Danbé », a-t-il insisté.
M. Berthé a également dénoncé les comportements qui fragilisent la société : le vol, la corruption, la trahison et le manque de respect. Il a exhorté les jeunes à devenir des citoyens exemplaires, fidèles aux principes du Kurukanfuga, rappelant que « la grandeur d’un peuple repose sur la droiture de ses enfants ».
Des échanges riches autour des valeurs et de l’éducation
La deuxième partie de la conférence a réuni Alioune Traoré et Dr Youssouf Doumbia, enseignant-chercheur, qui ont approfondi la réflexion autour de sous-thèmes liés à la transmission des valeurs culturelles dans l’éducation du Mali den kura le « nouveau Mali ».
M. Traoré a mis l’accent sur la rupture du dialogue intergénérationnel et le manque de communication entre parents et enfants, qu’il considère comme les principales causes de la perte de repères dans la société actuelle :
« Lorsque le dialogue disparaît, les valeurs s’effritent. Il faut renouer le lien entre les générations pour reconstruire le tissu social », a-t-il plaidé.
Dr Doumbia a axé son intervention sur l’impact des technologies de l’information sur la culture et l’identité. Selon lui, il est essentiel d’utiliser ces outils modernes pour valoriser et diffuser les valeurs du Maaya et du Danbé, plutôt que de laisser la jeunesse se perdre dans des influences étrangères.
Les deux conférenciers ont conclu en appelant à un retour aux fondamentaux, à une réappropriation collective des valeurs culturelles et à une éducation fondée sur la dignité, le respect et la solidarité.
Cette conférence-débat, riche en enseignements, a permis aux élèves de découvrir la profondeur du Maaya et du Danbé, deux notions qui ne se limitent pas à la tradition, mais qui demeurent des repères essentiels pour construire un Mali uni, digne et respectueux de ses valeurs.
En alliant culture, éducation et réflexion citoyenne, le Triangle du Balafon poursuit ainsi sa mission : éveiller les consciences et transmettre l’héritage du Manding aux nouvelles générations.
A.S.
Triangle du balafon / forum de Sikasso 2025 : Le balafon exploré dans toutes ses dimensions
Le balafon, instrument millénaire et symbole identitaire de l’Afrique de l’Ouest, a été célébré dans toutes ses dimensions au Forum de Sikasso 2025. De la salle Lamissa Bengaly aux espaces de réflexion, la 3ᵉ journée du Festival international du Triangle du Balafon a été marquée par des conférences-débats denses et passionnées autour d’un thème majeur : « Le Balafon, symbole de transmission sociale dans un nouvel espace souverain. ».
Avant les panels proprement dits, Dr Fodé Moussa Sidibé, enseignant-chercheur, a livré une communication inaugurale en retraçant l’histoire du balafon, ses origines, son expansion et son rôle à travers les continents. Selon lui, « le balafon constitue l’âme sonore de l’Afrique de l’Ouest », un instrument qui relie les peuples et traverse les générations.
Il a rappelé les fonctions multiples du balafon : sacrée, économique, récréative, éducative, culturelle et même environnementale. « Le balafon, a-t-il expliqué, n’est pas qu’un instrument de musique. Il est un outil de réconciliation, un facteur de cohésion sociale et un objet de brassage entre les populations ».
Fodé Moussa a également revisité l’histoire du Festival international du Triangle du Balafon, rendant hommage aux pionniers, notamment à l’ancien ministre Pascal Baba Coulibaly, pour les efforts politiques ayant conduit à la création de ce rendez-vous majeur.
Parmi les acquis, il a cité l’inscription du balafon au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO, ainsi que l’érection d’une statue symbolique entre les trois pays fondateurs : le Mali, le Burkina Faso et la Cote d’Ivoire. « Ce festival n’est pas qu’un événement festif, a-t-il conclu. C’est la célébration d’un avenir prospère et radieux pour notre continent ».
Quatre panels, quatre regards sur le balafon
« Balafon et mémoire sociale », cette sous thématique a été animé par Klessiké Sanogo, ancien directeur national du Patrimoine culturel (DNPC). Ce premier panel a exploré la dimension historique et symbolique de l’instrument.
Pour lui, « le balafon porte l’histoire des peuples et demeure le symbole vivant de l’identité culturelle transmise de génération en génération ». Son exposé a abordé la mythologie du balafon, son architecture sonore, et sa fonction de gardien de la mémoire collective.
« Fabrication, numérisation et transcription du répertoire »
Le deuxième panel, conduit par Ousmane Kouyaté, conseiller culturel au ministère de la Culture de Guinée, a porté sur la « fabrication et la transmission numérique du répertoire du balafon ».
M. Kouyaté a évoqué le légendaire « Sosso Bala », considéré comme le plus ancien balafon connu de l’humanité, conservé à Niagassola, en Guinée.
Il a détaillé le processus de fabrication et le rôle central du « Sosso Bala » dans l’histoire du Mandé : « Plus qu’un instrument, c’est un témoin du génie africain et de la continuité de nos valeurs ».
Le troisième panel, animé par M. Bengaly, a mis en lumière le rôle du balafon dans l’éducation des jeunes Sénoufos. Sa présentation, illustrée par une prestation musicale entre lui et une jeune élève, a permis de découvrir les sonorités du balafon pentatonique et heptatonique.
Il a plaidé pour une meilleure intégration de cet instrument dans le système éducatif :
« Le balafon est un formidable vecteur d’éducation, de cohésion et de vivre-ensemble. Pourquoi ne pas en faire un outil pédagogique à part entière ? ».
Il a proposé, entre autres, l’introduction de cours d’instruments traditionnels dans les écoles, la création de concours scolaires de balafon, et la révision des programmes d’enseignement artistique pour y inclure davantage les instruments du patrimoine.
« Balafon et diplomatie culturelle »
Enfin, le quatrième panel a réuni Issa Kanté du Mali et Alassane Rouamba du Burkina autour du thème « Balafon et diplomatie culturelle ».
Pour ces deux conférenciers, le balafon dépasse sa fonction musicale pour devenir un outil de diplomatie et d’intégration régionale.
M. Rouamba a insisté sur sa dimension économique et créative, tandis qu’Issa Kanté a évoqué sa portée symbolique. « Le balafon a toujours été un langage universel de paix. Il accompagnait les messagers, apaisait les tensions et célébrait les alliances entre royaumes. Aujourd’hui encore, il reste un instrument de coopération entre les peuples africains », ont-ils résumé dans leurs interventions.
Entre tradition et modernité, le Forum de Sikasso 2025 aura ainsi réaffirmé la place centrale du balafon dans la mémoire collective africaine.
A travers ses dimensions historique, sociologique, éducative et diplomatique, le balafon s’impose non seulement comme un patrimoine à préserver, mais aussi comme un levier de développement culturel et identitaire pour l’Afrique d’aujourd’hui et de demain.
A.S.
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0