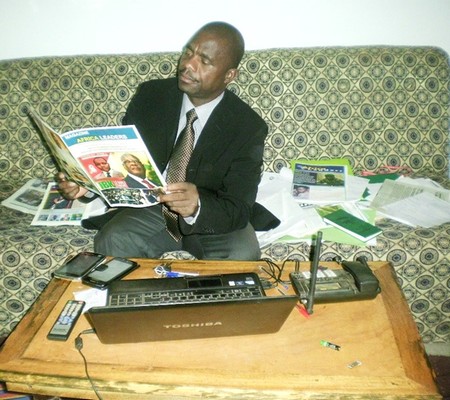Mali / questions de droit : recours en justice, entre espoir et désillusion.
Pour beaucoup de citoyens, saisir la justice est un acte porteur d’espoir. C’est l’expression d’une confiance dans l’État de droit, dans l’idée que les lois protègent et que les institutions arbitrent de manière équitable.

Pourtant, derrière cet idéal, la réalité se révèle souvent plus complexe, voire frustrante. Entre procédures longues, coûts élevés et lenteurs administratives, le recours en justice oscille souvent entre promesse de réparation et parcours du combattant.
Un outil de protection des droits, le recours en justice permet à toute personne ou organisation de contester une décision, de réclamer réparation ou de faire reconnaître ses droits. Qu’il s’agisse de litiges familiaux, administratifs, fonciers ou économiques, il reste une voie essentielle pour rétablir l’équilibre face à des abus ou des injustices. Pour certains, c’est la seule arme pacifique dont ils disposent face à des institutions puissantes ou à des acteurs économiques influents.
« Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes. »Des procédures souvent longues et coûteuses
Mais cet espoir se heurte rapidement à une réalité moins encourageante pour certains, les tribunaux sont engorgés, les dossiers s’accumulent et les audiences sont reportées à plusieurs reprises. Les justiciables doivent parfois attendre des mois, voire des années, avant d’obtenir une décision. À cela s’ajoutent des frais de justice et d’avocats souvent inaccessibles pour les citoyens aux revenus modestes. Résultat, beaucoup renoncent avant même d’avoir commencé.
Entre méfiance et lassitude
Face à ces obstacles, certains citoyens développent une méfiance grandissante envers le système judiciaire. Les cas de pauvreté, réels ou perçus, renforcent cette perte de confiance. D’autres finissent par se décourager, considérant la justice comme un privilège réservé à ceux qui ont les moyens ou les connexions nécessaires.
Un enjeu démocratique majeur
Pourtant, rendre le recours en justice réellement accessible est une condition essentielle de toute démocratie solide. Il s’agit non seulement de garantir l’égalité devant la loi, mais aussi de renforcer la confiance des citoyens envers les institutions. Des réformes sont régulièrement annoncées pour simplifier les procédures, renforcer la transparence et réduire les délais. Mais leur mise en œuvre reste souvent lente.
Entre espoir et désillusion
Le recours en justice symbolise à la fois l’espoir d’une société plus juste et la désillusion d’un système parfois dépassé. Pour qu’il retrouve toute sa force, il ne suffit pas d’énoncer des droits, il faut garantir leur effectivité, en rendant la justice plus rapide, moins coûteuse et véritablement indépendante.
Les réalités du terrain
Le recours en justice reste un droit théorique pour une partie des citoyens. Plusieurs obstacles persistent,
Lenteur des procédures, certaines affaires s’éternisent des années, décourageant les plaignants.
Coûts élevés, honoraires d’avocats, frais de justice ou consignations, déplacements, souvent inaccessibles aux plus modestes.
Pressions et pauvreté, renoncent à saisir la justice par peur de représailles, surtout dans des affaires impliquant des personnes influentes ajoute-il un justiciable.
Par exemple, de nombreux dossiers liés aux litiges fonciers débouchent sur des recours devant les tribunaux. Mais les citoyens dénoncent fréquemment la lenteur du traitement et la complexité administrative.
En principe des recours en justice doivent permettre d’annuler des décisions arbitraires prises par l’administration, illustrant la force de ce droit lorsqu’il est respecté
Les appels constituent une voie supplémentaire pour les citoyens lorsque la justice nationale est défaillante.
En somme, le recours en justice doit rester un outil de protection des droits, et non un privilège réservé à une élite. Cela suppose, des réformes pour accélérer les procédures, un meilleur accès à l’assistance judiciaire, et une volonté politique ferme de garantir l’indépendance des magistrats.
Car, comme le rappelle un juriste malien, « une justice qui n’est pas accessible perd son sens, et une justice qui n’est pas indépendante cesse d’être la justice ».
Mohamed SOGODOGO
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0