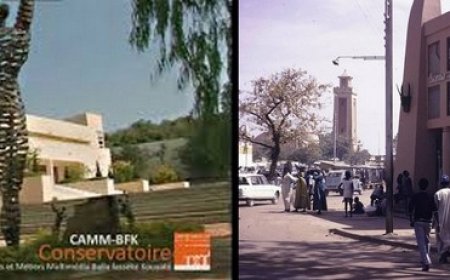Banalisation de la violence chez les artistes au Mali : Responsabiliser les artistes et le public
Dans certains sketches, clips, chansons et pièces théâtrales, sont distillés des actes et des messages de violence.
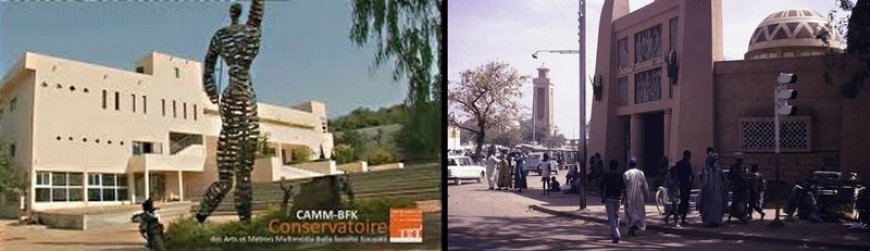
Caché sous le coup de la dérision ou de l’humour, ce phénomène peut être perçu comme une banalisation de la violence. Pour de nombreux observateurs, cela n’est pas sans danger, car conduit à une normalisation et à une acceptation de la violence, qui peut avoir des conséquences néfastes pour la société et le vivre-ensemble.

Des « sketches avec des insultes grossières, des enfants qui parlent des relations entre leurs parents ou manquent de respect à leurs géniteurs, ont envahi notre espace. Tout ce qui est contraire à nos us et coutumes. Pire, à d’autres niveaux, on assiste à une vulgarisation de la violence par des artistes dans leur art. Si ces faits peuvent paraître anodins, soit parce qu’on n’y prête pas grande attention, soit qu’ils passent sous le coup de l’humour, il n’en demeure pas moins que ces messages impactent plus qu’il n’y paraît, les jeunes fans qui s’identifient à leurs stars, ont tendance à intégrer dans leur quotidien cette attitude. Pour certains observateurs et analystes, si l’on n’y prend garde, cette conduite peut amener une acceptation ou une banalisation de la violence, notamment celle basée sur le genre, car elle est portée par des acteurs culturels souvent considérés comme des modèles à suivre ».
Pour Mamadou Diarra, Directeur régional de la Culture du district de Bamako, le phénomène est bien réel dans notre société et prend de l’ampleur. Cependant, il souligne qu’il est plus perceptible aussi bien chez les artistes chanteurs que dans les pièces de théâtre, qui sont généralement conçues pour transmettre des leçons de morale et sensibiliser le spectateur aux agressions et aux injustices.
Il note qu’avec l'émergence de la musique urbaine, notamment le hip-hop et le rap, originaires des États-Unis et repris par nos artistes, ces genres musicaux, exprimant les révoltes d’une jeunesse face à ses conditions de vie et peuvent contenir des paroles violentes. Au Mali, faute de structures d’encadrement professionnel des managers, d’absence de programmes éducatifs sur ces genres dans les écoles d’art (Institut national des arts de Bamako et Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasseké Kouyaté), et de mécanismes de contrôle et de censure, surtout avec la montée d’Internet, qui laisse à chacun la latitude de publier librement son contenu, ces genres musicaux, souvent mal assimilés et exploités par des jeunes artistes maliens, donnent lieu à des messages et à des actes de violence par mimétisme.
Précisant que ces styles sont lucratifs et contribuent à l’économie culturelle, M. Diarra souligne qu’en quête d’une plus grande audience et popularité, d’autres artistes, particulièrement des griottes, adoptent ces nouveaux styles. « Ces artistes se tournent vers ces jeunes qui semblent plus écoutés, car elles voient qu’en traitant des sujets violents et en se lançant dans des clashes, elles peuvent accroître leur popularité. Cela pousse certaines griottes à adopter des styles qui n’ont rien à voir avec leur art d’origine », a-t-il déclaré.
Cet avis est largement partagé par Sory Doumbia, alias Fakoly Lezy, jeune artiste rappeur. Selon lui, la jeunesse malienne, dans sa majorité, consomme la musique et elle est influencée par les comportements et la culture de l’Occident, notamment celle des États-Unis. Pour lui, cela entraîne un mimétisme chez les jeunes artistes, en particulier les rappeurs, qui cherchent à se faire une audience et à se hisser en haut des hit-parades.
« À force d’écouter en boucle à la radio et à la télévision des chansons telles que « j’ai la machette » ou « j’ai le couteau », nos jeunes finissent par s’identifier à ces messages et à commettre des actes répréhensibles dans la vraie vie. La violence devient alors une normalité pour eux », a-t-il également déploré.
En revanche, il ajoute que les créations basées sur la réalité locale sont peu vendeuses sur le marché. En effet, les promoteurs culturels, au lieu de soutenir des contenus de qualité et des textes de conscientisation, s’alignent sur ces modèles qui leur semblent plus rentables, a-t-il expliqué.
Le Mali ne pourra véritablement lutter contre les violences basées sur le genre (VBG) tant que sa culture populaire continuera à les banaliser. Il est urgent d’ouvrir un débat national sur les contenus musicaux, de soutenir les artistes engagés pour le changement, et d’introduire une véritable éthique dans l’industrie musicale.
Faire danser ne devrait jamais se faire au prix de la dignité humaine. La musique malienne mérite mieux. Les femmes aussi !
Khadydiatou Sanogo /maliweb.net
Ce reportage est publié avec le soutien de Journalistes pour les Droits Humains (JDH) au Mali et NED.
Quelle est votre réaction ?
 Like
3
Like
3
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0




![Googan Tan ; "Dura Lex, Sed Lex [La loi est dure, mais c'est la loi]" : Sarkozy, face au fantôme de Kadhafi, paye la facture](https://www.maliweb.net/uploads/images/202504/SEIDINA-OUMAR-DICKO.jpg)