Après le 28 février, les règlements de comptes se multiplièrent. Et certains furent particulièrement brutaux.

Le lendemain du 28 février, les arrestations se sont poursuivies à un bon rythme. Elles ne concernaient plus que le « menu fretin », selon l’expression utilisée par Fankélé. Mais ce dernier ne relâchait pas sa vigilance. Il avait choisi de ne rien négliger et il avait de quoi faire, car les langues se déliaient parmi les prisonniers surtout parmi ceux d’entre eux, qui étaient littéralement terrifiés quand on leur évoque une exécution possible. Les plus déstabilisés étaient les policiers. Leurs gardiens soldats n’avaient aucune raison de les ménager et leur promettaient à tout bout de champ qu’ils iraient au « poteau ». Le Chef était, lui également, attentif au déroulement des événements. Il se montrait intéressé par tout ce qui pouvait accabler ses adversaires. Il tenait en particulier à détruire définitivement la réputation de Niguèlin. Il ne pardonnait pas à cet homme qui, au sein du Conseil militaire, l’avait contesté avec le plus de virulence.
Le sort donna un coup de pouce au Chef dans son entreprise. Certains initiés avaient entendu parler d’une valisette que Niguèlin gardait chez lui, et sur le contenu de laquelle couraient les rumeurs les plus folles. Dèssè avait fait mettre à sac le domicile de son ennemi intime, mais n’y avait rien trouvé. Ce fut un simple soldat qui vendit la mèche aux enquêteurs. Cette fois-ci, les recherches s’orientèrent vers la résidence que l’ancien ministre avait conservée dans le camp de Kati et elles furent conduites de nuit par le « N° 2 » du Conseil en personne. Du sol de la maison creusé en un endroit bien précis fut tirée la fameuse valisette. Diaraba ne retint pas un large sourire quand on lui remit l’objet. Il fit forcer les serrures et laissa échapper un soupir de dépit en voyant le contenu. Dans la valisette, il n’y avait que quelques milliers de dollars, de francs français et de marks allemands. La somme n’était certes pas négligeable, mais bien des commerçants conservaient des montants beaucoup plus importants chez eux que la petite dizaine de millions récupérée. Mais en poussant un peu plus sa fouille, Diaraba trouva plus précieux que cet argent.
La valisette renfermait dans un double fond des dossiers explosifs placés dans de simples chemises en carton. Ces dossiers contenaient des informations qui pouvaient éclabousser plusieurs des membres du Conseil militaire vainqueurs du bras de fer du 28 février. Diaraba lui-même eut un frisson en jetant un coup d’œil dessus. Un moment (cela, il l’avoua par la suite à un ami très proche), il eut la tentation de garder pour lui toute cette dynamite, car elle pouvait lui servir. Mais il se rendit compte que c’était extrêmement risqué. Trop de témoins avaient vu les dossiers, et même s’ils ne savaient pas ce qui était à l’intérieur, ils avaient remarqué l’intérêt prononcé de l’officier. Diaraba se résigna donc à transmettre les documents en mains propres au patron. Ce dernier avait été plutôt déçu lorsqu’on lui avait communiqué le montant de la somme contenue dans la valisette. Par contre ils prit les dossiers contenus dans la valisette de Niguèlin et les plaça dans un coffre quand il se retrouva seul. Les quelques millions trouvés ne pouvaient servir à illustrer de manière éloquente la rapacité de Niguèlin et à le présenter comme un vil prédateur qui avait, sans scrupule aucun, sucé le « sang du peuple ».
Mais l’histoire n’est jamais avare de petites ironies et l’élément accablant, que cherchait à obtenir le boss, allait lui être apporté de manière plus qu’étonnante. En effet, alors que les hommes de Diaraba avaient mis sens dessus sens dessous le domicile de Kati pour trouver quelque chose qui aurait définitivement discrédité Niguèlin et ses compagnons aux yeux de l’opinion publique, ce fut du camp des parachutistes qu’allait provenir une preuve providentielle contre la « bande des trois ». Tout fut déclenché par un acte banal de consignation. Kramo avait été mis sous les verrous avec ses compagnons et tout naturellement sa Mercedes de fonction fut garée dans un lieu sûr au camp. Les clés du véhicule furent ensuite remises à l’adjoint du commandant de la compagnie para.
« LES AFFAIRES DE MILITAIRES » - Il se trouvait que le chauffeur de Kramo, Modian, était un soldat de cette compagnie tout comme son patron. Les compagnons de Modian le virent errer ça et là avec un air soucieux, mais personne ne s’avisa de lui demander ce qui le tracassait. On pensait qu’il était légitimement perturbé par l’arrestation de son patron. En fin d’après-midi le soldat sollicita un entretien avec le nouveau responsable du camp, le lieutenant Klékagni. Ce qu’il raconta fit ciller le jeune officier qui fit aussitôt appeler l’adjudant de la compagnie Niamanto, un homme d’une raideur toute militaire et un autre soldat. Ces deux dernières personnes devaient servir de témoins à l’événement qui allait suivre. Le quatuor se rendit au garage improvisé où se trouvait la Mercedes de Kramo. Le lieutenant fit procéder à l’ouverture du coffre arrière de la voiture. Le soleil avait déjà décliné, mais la lumière était suffisante pour distinguer la valisette de cuir déposée sur le plancher. Les quatre hommes repartirent ensemble au bureau de la compagnie où ils procédèrent à l’ouverture de la mallette qui s’avéra remplie jusqu’à ras bord de billets de banque tous neufs. Soldats et officier reconnurent plus tard que le spectacle de cette fortune insolemment exposée leur coupa le souffle et leur donna le vertige. Aucun d’eux n’avait vu de sa vie autant d’argent à la fois.
Le lieutenant fit venir un secrétaire et lui demanda de dresser le procès-verbal de ce qu’ils allaient faire, c’est-à-dire le décompte de la somme. L’entreprise s’avéra beaucoup plus ardue que les quatre hommes ne s’y attendaient. Aucun d’entre eux n’avait l’habitude de manier les billets et surtout tous craignaient de se tromper dans leurs additions. Ils comptèrent ces gros billets de banque et les recomptèrent. En finir avec le contenu de la petite valise leur prit donc deux bonnes heures et demie. Ils terminèrent trempés de sueur malgré l’air que brassait un vieux ventilateur, c’était sans doute sous l’effet de la concentration et du stress. Klékagni demanda au secrétaire de consigner le montant de leur trouvaille dans le procès-verbal. Quand tout cela fut bouclé, la nuit était déjà très avancée et il était impossible de quitter le camp puisque tous les hommes y étaient consignés avec interdiction formelle d’en sortir jusqu’au moment de la relève. D’autre part, Klékagni n’avait aucun moyen pour avertir un membre du Conseil militaire, tout le monde ayant quitté la « Maison du peuple ». La valisette resta donc sous la surveillance du lieutenant et de l’adjudant de compagnie. Les deux soldats reçurent la permission de rejoindre leur casernement. Ce qu’ils s’empressèrent de faire. En effet, ils avaient quitté leur famille tôt le matin et ils savaient qu’en raison des temps particuliers qui prévalaient, aussi bien les épouses que les enfants des porteurs d’uniforme étaient inquiets sur le sort des chefs de famille. Car, comme ils le disaient eux-mêmes, dans les affaires de militaires tous le monde sait comment cela s’enclenche, mais personne ne se doute de la manière dont cela peut se terminer.
Le lendemain à sept heures, après le rassemblement et la répartition des tâches futures, les consignés de la veille eurent l’autorisation de sortir du camp sans toutefois s’en éloigner pour des raisons évidentes de sécurité. Le lieutenant tenait à remettre en mains propres au nouveau maître du pays la valisette et le procès–verbal. Cette démarche lui avait été conseillée avec beaucoup d’insistance par ses hommes, l’adjudant de compagnie en tête. Car en cette période troublée, les accusations les plus farfelues pouvaient tomber sur n’importe quelle tête et il valait mieux s’entourer d’un maximum de garanties. Arrivé à la Maison du peuple, le lieutenant Klékagni procéda à une rapide inspection de ses soldats affectés à la protection de l’édifice, avant d’aller attendre le boss près de l’entrée du bureau de ce dernier. Le patron, qui avait abandonné son treillis de la veille pour une tenue kaki clair moins martiale, s’étonna à peine de voir un visiteur aussi matinal. Le lieutenant remarqua toutefois que le boss avait une mine soucieuse. Ce n’était pas du tout le visage d’un homme qui avait renversé la situation en sa faveur et qui aurait dû jouir pleinement de son triomphe. Le patron demanda au jeune officier d’attendre qu’il lui fasse signe. Puis il s’installa dans son bureau pour recevoir le trio Sumalé-Diaraba-Fankélé. Ils étaient venus lui faire le premier point de la journée du 28, avant de recevoir du Chef les tâches à réaliser ce 1er mars. Ce fut seulement après les avoir laissés repartir qu’il demanda qu’on introduise Klékagni, porteur de la fameuse valisette. Le jeune officier fit un bref exposé des faits et se tut dans l’attente des questions. Celles-ci ne vinrent pas. Le Chef se leva, un très léger sourire aux lèvres et demanda dans l’interphone à Sumalé de venir. Fankélé, lui, avait été chargé d’accueillir la foule qui, comme lors des événements du 19 novembre 1968, affluait pour présenter des motions de soutien.
TRANSFORME PAR LES EVENEMENTS - Les couloirs de la Maison du peuple grouillaient d’officiers, mais le remue-ménage s’arrêtait au rez-de-chaussée. Seuls de très rares privilégiés étaient admis à l’étage. Dans le bureau du Chef, on entendait la rumeur sourde de la foule qui s’était massée dans la grande cour. Après l’entrée de Sumalé, Klékagni fut invité à donner un maximum de détails sur les circonstances de sa découverte. Au fur et à mesure qu’il parlait, le sourire sur le visage du patron s’élargissait : voici enfin une preuve accablante qui lui permettait de tomber à bras raccourcis sur ses ennemis, et de les dépeindre comme des profiteurs qui accumulaient sans vergogne l’argent mal acquis. Il demanda à Sumalé d’aller prévenir séance tenante la foule, venue lui manifester son soutien, qu’il ferait dans les prochaines minutes une déclaration publique. Resté en tête-à-tête avec Klékagni, le boss examina longuement son vis-à-vis, comme s’il avait voulu percer le fond de son âme. Puis il finit par dire : « Mon lieutenant, vous irez loin, vous irez vraiment loin. Restez toujours aussi honnête que vous l’êtes ». Quand Sumalé revint pour lui dire que tout était prêt, le patron fit signe à Klékagni de le suivre. Il voulait dit-il le présenter au peuple.
Le jeune officier, visiblement gêné par la tournure que prenaient les choses, essaya de se dérober en disant qu’il ne méritait pas un tel honneur. Mais le boss avait déjà tourné les talons, la valisette à la main comme pièce à conviction. Sumalé poussa amicalement le jeune lieutenant dans la foulée du Chef qui vint s’installer au balcon. Dans un discours enflammé, il donna le ton du futur procès à intenter aux prédateurs. Cet homme, qui dans les circonstances ordinaires n’avait aucune éloquence, était littéralement transformé par les événements. Son bégaiement avait disparu et il ne butait plus sur les mots. Il savait trouver les expressions propres à déchainer l’enthousiasme de la foule. Avec des accents d’une très grande conviction, il parlait de justice, d’équité, de respect de l’homme et d’amour du pays. L’assistance était comme en adoration devant lui. Il brandit la valisette en disant que c’était là une partie du trésor accumulé par les pilleurs du peuple, mais que tout le reste serait récupéré. Son geste et ses paroles déclenchèrent un véritable délire dans la foule. Des témoins dirent plus tard que le boss, même s’il devait vivre jusqu’à mille ans, n’oublierait jamais ce moment là. Car il n’y en a pas deux comme celui-là dans l’existence d’un homme.
Le patron avait conscience du caractère privilégié de l’instant. Debout sur le balcon de la Maison du peuple, il savourait intensément chaque seconde de cette heure de gloire. En ces minutes bien précises, il avait la conviction d’être le seul maître à bord. Ce fut d’ailleurs cette nouvelle autorité qu’il affirma haut et fort lors d’une tournée qu’il effectua les jours suivants dans les garnisons de Kati et Bamako. Mais c’est très souvent dans l’euphorie que se commettent les erreurs les plus grossières, et le Chef ne put en éviter une de taille sur laquelle nous reviendrons plus tard. En attendant, essayons de savoir ce que devenaient les prisonniers les plus célèbres de l’époque.
La nuit du 28 février, ils avaient été regroupés dans une petite bâtisse qui se trouvait à l’entrée du camp de Kati. C’était une ancienne guérite qui avait servi de poste de garde et qui pouvait à grand peine accueillir deux hommes. Les conjurés se trouvèrent à plus d’une demie douzaine à l’intérieur, pressés dans une obscurité étouffante. Le petit cagibi avait été entouré d’un champ de barbelés et pendant toute la nuit de puissants projecteurs étaient braqués sur l’abri. Des sentinelles en nombre impressionnant formaient le cordon de sécurité. Certaines d’entre elles racontèrent ensuite que pendant toute cette nuit, elles avaient entendu les hurlements affreux poussés par Tiéni que torturait le manque d’amphétamine. Les prisonniers furent ensuite dispersés dans les différentes garnisons de l’intérieur. En jouant sur les inimitiés des uns et des autres, le Chef avait fait mettre Niguèlin à la disposition de Yéléko au camp de Sévaré. A peine eut-il débarqué là-bas que l’ancien ministre de la défense et de l’Intérieur reçut la visite de son ex-subordonné, tout heureux de pouvoir régler avec lui un vieux contentieux. Yéléko n’avait pas oublié un épisode pas très reluisant de sa carrière et qui datait du temps où il était gouverneur de la région de Kayes. Niguèlin l’avait fait convoquer un jour, tard en fin d’après-midi et il l’avait vertement admonesté sur la gestion de sa région et sur les déplacements inopportuns qu’il s’autorisait en venant sans autorisation à Bamako. Avant de le renvoyer, le ministre avait fait savoir au gouverneur qu’il lui téléphonerait le lendemain à sept heures trente. « Vous avez intérêt à être dans votre bureau au moment de mon coup de fil », avait dit le ministre Niguèlin de cette voix froide qu’il savait prendre lorsqu’il voulait donner tout son poids à une menace.
TOUT LE DESARROI DE TIENI - Il était alors 19 heures passées et il n’y avait pas le moindre train pour rallier Kayes. A cette époque, le rail était quasiment l’unique moyen de transport en direction de la capitale de la Première région administrative du pays. La route se trouvait dans un état plus que exécrable, l’avion était exclu. D’après les proches de Niguèlin, Yèlèko aurait fait sortir de table le chef de gare de la capitale qui dînait tranquillement. Il aurait exigé de ce dernier qu’il lui trouve immédiatement une solution pour rallier sa ville, mais sans lui expliquer les raisons de cette urgence. Le responsable du chemin de fer n’avait rien d’autre à proposer à l’officier que d’affréter une draisine, ce véhicule de la taille d’une grosse camionnette et qui sert à l’inspection par les techniciens des voies ferrées. Mais outre le fait d’être inconfortable, la draisine présentait le désavantage d’être ouverte sur les côtés et d’exposer ses passagers au vent coupant de la nuit. L’inconvénient était notable et il était encore amplifié par la fraîcheur de la saison. Mais Yéléko n’avait pas le choix et il s’embarqua dans ce véhicule de fortune pour parcourir 550 éprouvants kilomètres sans escale. On avait fait mettre à l’arrêt tous les trains de nuit en partance où en provenance de Kayes si bien qu’il fut ponctuel au rendez-vous du coup de fil de son patron, s’évitant ainsi des arrêts de rigueur. Mais Yèlèko n’avait jamais digéré cette mésaventure, et on peut imaginer à quel point il jubila quand il reçut le coup de fil du boss lui demandant de « recevoir » Niguèlin. Il tint à être à l’accueil de celui qu’il désignait comme une « bête sauvage ». Il fit détacher son prisonnier et s’enferma avec lui dans le local qui servait de cellule. Il faut savoir que Yéléko n’était pas un maigrichon et que son passé de commando parachutiste lui avait donné une bonne science du corps à corps.
Lorsque quelques minutes plus tard il demanda qu’on ouvre la porte, Niguèlin ne ressemblait plus à l’officier hautain, plein de morgue et de suffisance qui toisait les anciens gradés avec un dédain qu’il ne cherchait même pas à cacher. La face tuméfiée, les pommettes éclatées, la bouche ensanglantée, l’homme tenait debout surtout grâce à son immense orgueil. C’était ce même orgueil qui l’avait empêché de crier pendant qu’il encaissait les coups lourds de son geôlier, qui pesait au moins une fois et demie plus que lui. Mais il ne put retenir un faible gémissement de douleur lorsqu’il essaya de s’étendre pour récupérer un peu de forces. Le calvaire de Niguèlin ne s’arrêta cependant pas à cette seule correction. Son ennemi revint lui rendre visite le lendemain et lui fit subir le même traitement. Cette fois non plus, Niguèlin ne cria pas, mais il perdit connaissance. Un seau d’eau balancé sans ménagement le fit revenir à lui et en ouvrant les yeux, il vit que son tortionnaire attendait en devisant avec certains officiers et sous-officiers de la garnison.
Au troisième passage à tabac, Niguèlin eut la force de traiter son bourreau de lâche, ce qui lui coûta une dégelée encore plus violente de coups. Après cela on le laissa tranquille, car il devait être plus ou moins présentable pour être interrogé par Dèssè et son équipe d’enquête qui allait venir de Bamako. Niguèlin raconta plus tard à certains de ses codétenus que pendant qu’on le martyrisait, il pensait surtout à Tiéni qu’il savait moins coriace que lui. Mais il ne se doutait pas que l’ancien chef de la Sécurité avait abdiqué dès le premier jour. Tiéni avait même fait transmettre au Chef, par l’intermédiaire de Sumalé, une lettre dans laquelle il confessait ses « erreurs » et demandait l’indulgence du boss. Tiéni avait demandé à Sumalé, qui était son ami, de rappeler au Chef les coups de main qu’il avait donné à celui-ci et les embarras d’où il l’avait tiré, en prenant sur lui certaines fautes qui n’auraient pas dû lui être imputées. Dans cette démarche on sentait tout le désarroi d’un homme qui n’avait jamais imaginé qu’il pouvait tomber aussi bas. D’ailleurs Tiéni, au temps de sa splendeur, se vantait devant qui voulait l’écouter que lui ne serait jamais pris vivant. Il préfèrerait, disait-il, se mettre une balle dans la tête.
Le tout puissant chef de la Sécurité affirmait qu’il s’était compromis dans trop de sales manœuvres pour que grâce lui soit faite si jamais le régime militaire tombait. Mais il ne lui était certainement jamais venu à l’esprit que les siens puissent se saisir de lui. Il en savait trop sur chacun d’eux et pensait que ses dossiers constituaient un rempart derrière lequel il était intouchable. Mais comme le dit la sagesse bamanan : « Tiè magni tiè bolo dè » (Il ne fait jamais bon pour un homme d’être entre les mains d’un autre homme) ! Tiéni avait détenu un pouvoir quasi absolu et il en avait joui de toutes les manières possibles. Puis il avait été « attrapé comme un petit poussin » (l’expression serait du boss lui-même), ficelé comme un vulgaire détrousseur et soumis à un régime dégradant. Tout cela l’avait brisé.
DES DEMANGEAISONS DANS LES MAINS - Il s’était donc rabaissé à écrire une lettre pitoyable au patron, puis voyant que cela n’avait eu aucun effet, il fit demander à Sumalé et obtint de lui que les mauvais traitements corporels auxquels n’avait pas échappé son ami et compagnon Niguèlin lui soient épargnés. Que donna-t-il en échange ? Cela restera un secret entre les deux hommes. Tiéni ne fut donc pas maltraité. Mais certains se chargèrent de lui rappeler sa nouvelle condition. Dèssè, qui était chargé de conduire les enquêtes, se donna le plaisir de balancer en pleine figure de son ancien compagnon du Conseil militaire quelques gifles bien senties. Histoire, dit-il, de « soigner les démangeaisons » qu’il éprouvait dans les mains à la seule vue de Tiéni. Ce dernier laissa échapper des larmes de rage en subissant cette humiliation, mais il ne prit pas le risque d’énerver Dèssè par une réaction d’orgueil que son geôlier lui aurait certainement fait payer cher. Les langues continuaient à se délier et une nouvelle vague d’arrestations passa sur les différents corps de l’armée et de la sécurité.
Le colonel Ussuby, que l’on avait annoncé sous les verrous, était en réalité placé sous étroite surveillance pendant toute une semaine. Son arrestation spectaculaire à Koulouba dans son ministère le 8 mars (une semaine plus tard) devançait de peu celle du Chef d’état-major de l’armée de terre Dantuma, celui de la gendarmerie Niamba ainsi que quelques chefs de bataillon dont le commandant de la zone de défense de Ségou Tiécoroba, des capitaines, lieutenants et quelques sous-officiers. Tous furent déclarés inféodés à la « bande des trois ». Une longue liste de détenus fut dressée afin que la population se rende compte de l’étendue des périls auxquels elle avait échappé. Tout cela relevait d’une grande mise en scène que dirigeait, non sans plaisir, Fankélé. C’était lui qui s’occupait des communiqués de presse. Il donnait des détails sur les caches de trésor des vaincus et rendait compte des activités de la Commission nationale d’enquête, mise en place pour amuser la galerie. Nous vivions alors dans une période où l’intoxication de l’opinion publique marchait à fond. Rien n’était négligé pour salir la réputation des vaincus et pour présenter les vainqueurs comme des redresseurs de torts. Mais tout cela n’était pas sans danger.
Le Chef lui-même avait trouvé un moment que Fankélé en faisait trop et qu’il avait lancé une machine qui pouvait s’emballer dangereusement. « On a tout le temps, il ne faut pas tout révéler », avait-il dit à l’un de ses proches. Le principal bouc émissaire dans cette « campagne d’information du peuple » était Niguèlin. Transféré dans une cellule dans la capitale, il disposait d’un petit poste radio sur lequel il écoutait la liste de ses crimes qui s’allongeait chaque jour davantage. Mais dans cette atmosphère de règlements de compte, le Chef ne perdait pas de vue ce qui demeurait essentiel, l’affirmation de son autorité sur l’armée. Dans ce but, il entreprit une tournée dans les garnisons et à cette occasion il adopta un nouveau look, comme on le dit aujourd’hui. Lui qui avait critiqué les lunettes noires qu’arboraient ses rivaux lorsque ceux-ci étaient au plus haut de leur puissance, se trouva une paire de verres fumés pour effectuer son périple dans les camps de Kati et Bamako. Dans la ville de garnison comme au bataillon des parachutistes, le Chef commit l’erreur dont nous vous parlions plus haut. Il jeta un froid dans ce qui était le corps d’élite de l’armée. En se livrant à une description minutieuse du projet de coup de force de Niguèlin et de ses complices, il déclara que : « les paras devaient être le fer de lance de la manœuvre » et qu’il leur avait été affecté « la mission de l’assassiner ».
Les parachutistes regardèrent avec des yeux ronds le boss. Depuis dix ans, leur troupe assurait la garde personnelle du Chef et ce dernier n’avait pas eu un seul instant à douter de leur loyauté. Voilà qu’à cause de leur ancien chef le capitaine Djalan, qui s’était trouvé dans le camp des comploteurs, on les suspectait d’être « tous mêlés » à une tentative de coup d’Etat. Les parachutistes furent encore plus ulcérés quand dans les jours qui suivirent, on leur retira la garde du Chef pour la confier aux gendarmes de Dula. Le capitaine Bouna - le supérieur de Klékagni - et le jeune lieutenant sentaient le malaise monter dans la troupe. Et ils voyaient bien que s’ils ne faisaient pas quelque chose, la situation pouvait se dégrader au niveau des hommes. Heureusement le boss, averti par son entourage, reçut Bouna peu de jours après sa tournée. Il tenait, dit-il, à faire une mise au point. Il indiqua à l’officier qu’il n’avait pas stigmatisé la compagnie para dans son intégralité, mais seulement des « éléments à la solde de Djalan ». Il suggérait donc qu’une purge soit effectuée pour extraire les complices de l’ancien commandant de compagnie. Klékagni voyait l’engrenage infernal que déclencherait une chasse aux sorcières, et il convainquit son supérieur du danger de déstabilisation qu’amènerait la stigmatisation de certains éléments.
SENSIBLE AUX « CADEAUX » - Personnellement il était soulagé que la garde du boss ait été retirée à ses hommes. Mais son soulagement fut de courte durée. On amena moins de deux mois plus tard au camp para les prisonniers les plus importants. La raison de ce regroupement était des plus prosaïques. Il s’était révélé que les détenus causaient pas mal de dégâts dans leur lieu d’enfermement respectif, situé dans diverses garnisons du pays. Ils causaient avec les sentinelles, leur racontaient leur version des événements de Novembre 1968 et leur faisaient comprendre que les fonds saisis n’étaient pas reversés au Trésor comme l’affirmait Fankélé dans ses communiqués. Les soldats, ébranlés par ces révélations, étaient devenus beaucoup moins rigoureux dans leur surveillance. Ils acceptaient des billets, allaient faire des commissions des détenus, leur amenaient leurs repas. Dèssè, qui devait tenir les soldats en mains, était complètement dépassé. D’autant qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’être lui-même irréprochable. Il avait eu le malheur de montrer qu’il était sensible, lui aussi, aux « petits » cadeaux. Sa commission d’enquête avait mis le grappin sur un homme d’affaires de Ségou, qui était l’ami personnel de Kramo. Justement, celui-ci était venu pour demander qu’on lui restitue la valisette saisie dans le coffre de la Mercedes de ce dernier. Elle lui appartenait et il en avait les preuves. Kramo, qui était ministre des Transports avant les événements de février, avait accepté d’acheminer à partir d’Abidjan la somme de vingt-cinq millions de francs CFA remis par les associés ivoiriens de son ami, qui possédait des parts dans une entreprise de filature située en Côte d’Ivoire.
Arrivé à Bamako, Kramo avait téléphoné au destinataire afin que celui-ci vienne chercher son argent. Arguant divers empêchements, le Ségovien lui donna rendez-vous pour le mercredi 1er mars. Dans l’intervalle arriva ce que nous savons. Cela n’empêcha pas l’ami de Kramo de venir en personne à la Commission d’enquête réclamer que lui soit restitué son argent. Pour toute réponse, il fut arrêté. Son interpellation provoqua une vague de protestations dans le milieu d’affaires de Ségou, qui jugea que l’intéressé avait été victime d’un arbitraire incompréhensible. Pragmatiques comme savent l’être les commerçants, les collègues du prévenu décidèrent de ne pas perdre leur temps dans des démarchages superflus, ni dans des protestations inutiles. Ils se cotisèrent et offrirent à Dèssè un pactole substantiel que ce dernier n’eut pas la force de refuser. Et comme il voulait trainer les pieds pour relaxer l’opérateur économique les proches de celui-ci firent remonter l’affaire jusqu’au niveau de Béréni. Est ce que ce fut le déclencheur ? Qu’importe puisque le businessman fut blanchi rapidement des soupçons portés sur lui. Libéré dans la foulée, il fut accueilli en triomphe dans sa ville. Il apporta les papiers justificatifs et recouvra l’intégralité de la somme contenue dans la valisette confiée à Kramo. On se garda bien de le clamer sur tous les toits. Comme on le voit la commission d’enquête avait de la peine à ficeler des dossiers de prévarication solides. Mais l’affaire ne s’arrêta pas là. Un officier au sein de la commission d’enquête avait suivi toutes ces tractations et écœuré, il fit remonter l’information jusqu’au Chef. Ce dernier poussa un soupir exaspéré et fit la réflexion à haute voix qu’en prison ses ex-compagnons se montraient encore plus nuisibles que s’ils se trouvaient en liberté.
(à suivre)
TIEMOGOBA
 Le lendemain du 28 février, les arrestations se sont poursuivies à un bon rythme. Elles ne concernaient plus que le « menu fretin », selon l’expression utilisée par Fankélé. Mais ce dernier ne relâchait pas sa vigilance. Il avait choisi de ne rien négliger et il avait de quoi faire, car les langues se déliaient parmi les prisonniers surtout parmi ceux d’entre eux, qui étaient littéralement terrifiés quand on leur évoque une exécution possible. Les plus déstabilisés étaient les policiers. Leurs gardiens soldats n’avaient aucune raison de les ménager et leur promettaient à tout bout de champ qu’ils iraient au « poteau ». Le Chef était, lui également, attentif au déroulement des événements. Il se montrait intéressé par tout ce qui pouvait accabler ses adversaires. Il tenait en particulier à détruire définitivement la réputation de Niguèlin. Il ne pardonnait pas à cet homme qui, au sein du Conseil militaire, l’avait contesté avec le plus de virulence.
Le sort donna un coup de pouce au Chef dans son entreprise. Certains initiés avaient entendu parler d’une valisette que Niguèlin gardait chez lui, et sur le contenu de laquelle couraient les rumeurs les plus folles. Dèssè avait fait mettre à sac le domicile de son ennemi intime, mais n’y avait rien trouvé. Ce fut un simple soldat qui vendit la mèche aux enquêteurs. Cette fois-ci, les recherches s’orientèrent vers la résidence que l’ancien ministre avait conservée dans le camp de Kati et elles furent conduites de nuit par le « N° 2 » du Conseil en personne. Du sol de la maison creusé en un endroit bien précis fut tirée la fameuse valisette. Diaraba ne retint pas un large sourire quand on lui remit l’objet. Il fit forcer les serrures et laissa échapper un soupir de dépit en voyant le contenu. Dans la valisette, il n’y avait que quelques milliers de dollars, de francs français et de marks allemands. La somme n’était certes pas négligeable, mais bien des commerçants conservaient des montants beaucoup plus importants chez eux que la petite dizaine de millions récupérée. Mais en poussant un peu plus sa fouille, Diaraba trouva plus précieux que cet argent.
La valisette renfermait dans un double fond des dossiers explosifs placés dans de simples chemises en carton. Ces dossiers contenaient des informations qui pouvaient éclabousser plusieurs des membres du Conseil militaire vainqueurs du bras de fer du 28 février. Diaraba lui-même eut un frisson en jetant un coup d’œil dessus. Un moment (cela, il l’avoua par la suite à un ami très proche), il eut la tentation de garder pour lui toute cette dynamite, car elle pouvait lui servir. Mais il se rendit compte que c’était extrêmement risqué. Trop de témoins avaient vu les dossiers, et même s’ils ne savaient pas ce qui était à l’intérieur, ils avaient remarqué l’intérêt prononcé de l’officier. Diaraba se résigna donc à transmettre les documents en mains propres au patron. Ce dernier avait été plutôt déçu lorsqu’on lui avait communiqué le montant de la somme contenue dans la valisette. Par contre ils prit les dossiers contenus dans la valisette de Niguèlin et les plaça dans un coffre quand il se retrouva seul. Les quelques millions trouvés ne pouvaient servir à illustrer de manière éloquente la rapacité de Niguèlin et à le présenter comme un vil prédateur qui avait, sans scrupule aucun, sucé le « sang du peuple ».
Mais l’histoire n’est jamais avare de petites ironies et l’élément accablant, que cherchait à obtenir le boss, allait lui être apporté de manière plus qu’étonnante. En effet, alors que les hommes de Diaraba avaient mis sens dessus sens dessous le domicile de Kati pour trouver quelque chose qui aurait définitivement discrédité Niguèlin et ses compagnons aux yeux de l’opinion publique, ce fut du camp des parachutistes qu’allait provenir une preuve providentielle contre la « bande des trois ». Tout fut déclenché par un acte banal de consignation. Kramo avait été mis sous les verrous avec ses compagnons et tout naturellement sa Mercedes de fonction fut garée dans un lieu sûr au camp. Les clés du véhicule furent ensuite remises à l’adjoint du commandant de la compagnie para.
« LES AFFAIRES DE MILITAIRES » - Il se trouvait que le chauffeur de Kramo, Modian, était un soldat de cette compagnie tout comme son patron. Les compagnons de Modian le virent errer ça et là avec un air soucieux, mais personne ne s’avisa de lui demander ce qui le tracassait. On pensait qu’il était légitimement perturbé par l’arrestation de son patron. En fin d’après-midi le soldat sollicita un entretien avec le nouveau responsable du camp, le lieutenant Klékagni. Ce qu’il raconta fit ciller le jeune officier qui fit aussitôt appeler l’adjudant de la compagnie Niamanto, un homme d’une raideur toute militaire et un autre soldat. Ces deux dernières personnes devaient servir de témoins à l’événement qui allait suivre. Le quatuor se rendit au garage improvisé où se trouvait la Mercedes de Kramo. Le lieutenant fit procéder à l’ouverture du coffre arrière de la voiture. Le soleil avait déjà décliné, mais la lumière était suffisante pour distinguer la valisette de cuir déposée sur le plancher. Les quatre hommes repartirent ensemble au bureau de la compagnie où ils procédèrent à l’ouverture de la mallette qui s’avéra remplie jusqu’à ras bord de billets de banque tous neufs. Soldats et officier reconnurent plus tard que le spectacle de cette fortune insolemment exposée leur coupa le souffle et leur donna le vertige. Aucun d’eux n’avait vu de sa vie autant d’argent à la fois.
Le lieutenant fit venir un secrétaire et lui demanda de dresser le procès-verbal de ce qu’ils allaient faire, c’est-à-dire le décompte de la somme. L’entreprise s’avéra beaucoup plus ardue que les quatre hommes ne s’y attendaient. Aucun d’entre eux n’avait l’habitude de manier les billets et surtout tous craignaient de se tromper dans leurs additions. Ils comptèrent ces gros billets de banque et les recomptèrent. En finir avec le contenu de la petite valise leur prit donc deux bonnes heures et demie. Ils terminèrent trempés de sueur malgré l’air que brassait un vieux ventilateur, c’était sans doute sous l’effet de la concentration et du stress. Klékagni demanda au secrétaire de consigner le montant de leur trouvaille dans le procès-verbal. Quand tout cela fut bouclé, la nuit était déjà très avancée et il était impossible de quitter le camp puisque tous les hommes y étaient consignés avec interdiction formelle d’en sortir jusqu’au moment de la relève. D’autre part, Klékagni n’avait aucun moyen pour avertir un membre du Conseil militaire, tout le monde ayant quitté la « Maison du peuple ». La valisette resta donc sous la surveillance du lieutenant et de l’adjudant de compagnie. Les deux soldats reçurent la permission de rejoindre leur casernement. Ce qu’ils s’empressèrent de faire. En effet, ils avaient quitté leur famille tôt le matin et ils savaient qu’en raison des temps particuliers qui prévalaient, aussi bien les épouses que les enfants des porteurs d’uniforme étaient inquiets sur le sort des chefs de famille. Car, comme ils le disaient eux-mêmes, dans les affaires de militaires tous le monde sait comment cela s’enclenche, mais personne ne se doute de la manière dont cela peut se terminer.
Le lendemain à sept heures, après le rassemblement et la répartition des tâches futures, les consignés de la veille eurent l’autorisation de sortir du camp sans toutefois s’en éloigner pour des raisons évidentes de sécurité. Le lieutenant tenait à remettre en mains propres au nouveau maître du pays la valisette et le procès–verbal. Cette démarche lui avait été conseillée avec beaucoup d’insistance par ses hommes, l’adjudant de compagnie en tête. Car en cette période troublée, les accusations les plus farfelues pouvaient tomber sur n’importe quelle tête et il valait mieux s’entourer d’un maximum de garanties. Arrivé à la Maison du peuple, le lieutenant Klékagni procéda à une rapide inspection de ses soldats affectés à la protection de l’édifice, avant d’aller attendre le boss près de l’entrée du bureau de ce dernier. Le patron, qui avait abandonné son treillis de la veille pour une tenue kaki clair moins martiale, s’étonna à peine de voir un visiteur aussi matinal. Le lieutenant remarqua toutefois que le boss avait une mine soucieuse. Ce n’était pas du tout le visage d’un homme qui avait renversé la situation en sa faveur et qui aurait dû jouir pleinement de son triomphe. Le patron demanda au jeune officier d’attendre qu’il lui fasse signe. Puis il s’installa dans son bureau pour recevoir le trio Sumalé-Diaraba-Fankélé. Ils étaient venus lui faire le premier point de la journée du 28, avant de recevoir du Chef les tâches à réaliser ce 1er mars. Ce fut seulement après les avoir laissés repartir qu’il demanda qu’on introduise Klékagni, porteur de la fameuse valisette. Le jeune officier fit un bref exposé des faits et se tut dans l’attente des questions. Celles-ci ne vinrent pas. Le Chef se leva, un très léger sourire aux lèvres et demanda dans l’interphone à Sumalé de venir. Fankélé, lui, avait été chargé d’accueillir la foule qui, comme lors des événements du 19 novembre 1968, affluait pour présenter des motions de soutien.
TRANSFORME PAR LES EVENEMENTS - Les couloirs de la Maison du peuple grouillaient d’officiers, mais le remue-ménage s’arrêtait au rez-de-chaussée. Seuls de très rares privilégiés étaient admis à l’étage. Dans le bureau du Chef, on entendait la rumeur sourde de la foule qui s’était massée dans la grande cour. Après l’entrée de Sumalé, Klékagni fut invité à donner un maximum de détails sur les circonstances de sa découverte. Au fur et à mesure qu’il parlait, le sourire sur le visage du patron s’élargissait : voici enfin une preuve accablante qui lui permettait de tomber à bras raccourcis sur ses ennemis, et de les dépeindre comme des profiteurs qui accumulaient sans vergogne l’argent mal acquis. Il demanda à Sumalé d’aller prévenir séance tenante la foule, venue lui manifester son soutien, qu’il ferait dans les prochaines minutes une déclaration publique. Resté en tête-à-tête avec Klékagni, le boss examina longuement son vis-à-vis, comme s’il avait voulu percer le fond de son âme. Puis il finit par dire : « Mon lieutenant, vous irez loin, vous irez vraiment loin. Restez toujours aussi honnête que vous l’êtes ». Quand Sumalé revint pour lui dire que tout était prêt, le patron fit signe à Klékagni de le suivre. Il voulait dit-il le présenter au peuple.
Le jeune officier, visiblement gêné par la tournure que prenaient les choses, essaya de se dérober en disant qu’il ne méritait pas un tel honneur. Mais le boss avait déjà tourné les talons, la valisette à la main comme pièce à conviction. Sumalé poussa amicalement le jeune lieutenant dans la foulée du Chef qui vint s’installer au balcon. Dans un discours enflammé, il donna le ton du futur procès à intenter aux prédateurs. Cet homme, qui dans les circonstances ordinaires n’avait aucune éloquence, était littéralement transformé par les événements. Son bégaiement avait disparu et il ne butait plus sur les mots. Il savait trouver les expressions propres à déchainer l’enthousiasme de la foule. Avec des accents d’une très grande conviction, il parlait de justice, d’équité, de respect de l’homme et d’amour du pays. L’assistance était comme en adoration devant lui. Il brandit la valisette en disant que c’était là une partie du trésor accumulé par les pilleurs du peuple, mais que tout le reste serait récupéré. Son geste et ses paroles déclenchèrent un véritable délire dans la foule. Des témoins dirent plus tard que le boss, même s’il devait vivre jusqu’à mille ans, n’oublierait jamais ce moment là. Car il n’y en a pas deux comme celui-là dans l’existence d’un homme.
Le patron avait conscience du caractère privilégié de l’instant. Debout sur le balcon de la Maison du peuple, il savourait intensément chaque seconde de cette heure de gloire. En ces minutes bien précises, il avait la conviction d’être le seul maître à bord. Ce fut d’ailleurs cette nouvelle autorité qu’il affirma haut et fort lors d’une tournée qu’il effectua les jours suivants dans les garnisons de Kati et Bamako. Mais c’est très souvent dans l’euphorie que se commettent les erreurs les plus grossières, et le Chef ne put en éviter une de taille sur laquelle nous reviendrons plus tard. En attendant, essayons de savoir ce que devenaient les prisonniers les plus célèbres de l’époque.
La nuit du 28 février, ils avaient été regroupés dans une petite bâtisse qui se trouvait à l’entrée du camp de Kati. C’était une ancienne guérite qui avait servi de poste de garde et qui pouvait à grand peine accueillir deux hommes. Les conjurés se trouvèrent à plus d’une demie douzaine à l’intérieur, pressés dans une obscurité étouffante. Le petit cagibi avait été entouré d’un champ de barbelés et pendant toute la nuit de puissants projecteurs étaient braqués sur l’abri. Des sentinelles en nombre impressionnant formaient le cordon de sécurité. Certaines d’entre elles racontèrent ensuite que pendant toute cette nuit, elles avaient entendu les hurlements affreux poussés par Tiéni que torturait le manque d’amphétamine. Les prisonniers furent ensuite dispersés dans les différentes garnisons de l’intérieur. En jouant sur les inimitiés des uns et des autres, le Chef avait fait mettre Niguèlin à la disposition de Yéléko au camp de Sévaré. A peine eut-il débarqué là-bas que l’ancien ministre de la défense et de l’Intérieur reçut la visite de son ex-subordonné, tout heureux de pouvoir régler avec lui un vieux contentieux. Yéléko n’avait pas oublié un épisode pas très reluisant de sa carrière et qui datait du temps où il était gouverneur de la région de Kayes. Niguèlin l’avait fait convoquer un jour, tard en fin d’après-midi et il l’avait vertement admonesté sur la gestion de sa région et sur les déplacements inopportuns qu’il s’autorisait en venant sans autorisation à Bamako. Avant de le renvoyer, le ministre avait fait savoir au gouverneur qu’il lui téléphonerait le lendemain à sept heures trente. « Vous avez intérêt à être dans votre bureau au moment de mon coup de fil », avait dit le ministre Niguèlin de cette voix froide qu’il savait prendre lorsqu’il voulait donner tout son poids à une menace.
TOUT LE DESARROI DE TIENI - Il était alors 19 heures passées et il n’y avait pas le moindre train pour rallier Kayes. A cette époque, le rail était quasiment l’unique moyen de transport en direction de la capitale de la Première région administrative du pays. La route se trouvait dans un état plus que exécrable, l’avion était exclu. D’après les proches de Niguèlin, Yèlèko aurait fait sortir de table le chef de gare de la capitale qui dînait tranquillement. Il aurait exigé de ce dernier qu’il lui trouve immédiatement une solution pour rallier sa ville, mais sans lui expliquer les raisons de cette urgence. Le responsable du chemin de fer n’avait rien d’autre à proposer à l’officier que d’affréter une draisine, ce véhicule de la taille d’une grosse camionnette et qui sert à l’inspection par les techniciens des voies ferrées. Mais outre le fait d’être inconfortable, la draisine présentait le désavantage d’être ouverte sur les côtés et d’exposer ses passagers au vent coupant de la nuit. L’inconvénient était notable et il était encore amplifié par la fraîcheur de la saison. Mais Yéléko n’avait pas le choix et il s’embarqua dans ce véhicule de fortune pour parcourir 550 éprouvants kilomètres sans escale. On avait fait mettre à l’arrêt tous les trains de nuit en partance où en provenance de Kayes si bien qu’il fut ponctuel au rendez-vous du coup de fil de son patron, s’évitant ainsi des arrêts de rigueur. Mais Yèlèko n’avait jamais digéré cette mésaventure, et on peut imaginer à quel point il jubila quand il reçut le coup de fil du boss lui demandant de « recevoir » Niguèlin. Il tint à être à l’accueil de celui qu’il désignait comme une « bête sauvage ». Il fit détacher son prisonnier et s’enferma avec lui dans le local qui servait de cellule. Il faut savoir que Yéléko n’était pas un maigrichon et que son passé de commando parachutiste lui avait donné une bonne science du corps à corps.
Lorsque quelques minutes plus tard il demanda qu’on ouvre la porte, Niguèlin ne ressemblait plus à l’officier hautain, plein de morgue et de suffisance qui toisait les anciens gradés avec un dédain qu’il ne cherchait même pas à cacher. La face tuméfiée, les pommettes éclatées, la bouche ensanglantée, l’homme tenait debout surtout grâce à son immense orgueil. C’était ce même orgueil qui l’avait empêché de crier pendant qu’il encaissait les coups lourds de son geôlier, qui pesait au moins une fois et demie plus que lui. Mais il ne put retenir un faible gémissement de douleur lorsqu’il essaya de s’étendre pour récupérer un peu de forces. Le calvaire de Niguèlin ne s’arrêta cependant pas à cette seule correction. Son ennemi revint lui rendre visite le lendemain et lui fit subir le même traitement. Cette fois non plus, Niguèlin ne cria pas, mais il perdit connaissance. Un seau d’eau balancé sans ménagement le fit revenir à lui et en ouvrant les yeux, il vit que son tortionnaire attendait en devisant avec certains officiers et sous-officiers de la garnison.
Au troisième passage à tabac, Niguèlin eut la force de traiter son bourreau de lâche, ce qui lui coûta une dégelée encore plus violente de coups. Après cela on le laissa tranquille, car il devait être plus ou moins présentable pour être interrogé par Dèssè et son équipe d’enquête qui allait venir de Bamako. Niguèlin raconta plus tard à certains de ses codétenus que pendant qu’on le martyrisait, il pensait surtout à Tiéni qu’il savait moins coriace que lui. Mais il ne se doutait pas que l’ancien chef de la Sécurité avait abdiqué dès le premier jour. Tiéni avait même fait transmettre au Chef, par l’intermédiaire de Sumalé, une lettre dans laquelle il confessait ses « erreurs » et demandait l’indulgence du boss. Tiéni avait demandé à Sumalé, qui était son ami, de rappeler au Chef les coups de main qu’il avait donné à celui-ci et les embarras d’où il l’avait tiré, en prenant sur lui certaines fautes qui n’auraient pas dû lui être imputées. Dans cette démarche on sentait tout le désarroi d’un homme qui n’avait jamais imaginé qu’il pouvait tomber aussi bas. D’ailleurs Tiéni, au temps de sa splendeur, se vantait devant qui voulait l’écouter que lui ne serait jamais pris vivant. Il préfèrerait, disait-il, se mettre une balle dans la tête.
Le tout puissant chef de la Sécurité affirmait qu’il s’était compromis dans trop de sales manœuvres pour que grâce lui soit faite si jamais le régime militaire tombait. Mais il ne lui était certainement jamais venu à l’esprit que les siens puissent se saisir de lui. Il en savait trop sur chacun d’eux et pensait que ses dossiers constituaient un rempart derrière lequel il était intouchable. Mais comme le dit la sagesse bamanan : « Tiè magni tiè bolo dè » (Il ne fait jamais bon pour un homme d’être entre les mains d’un autre homme) ! Tiéni avait détenu un pouvoir quasi absolu et il en avait joui de toutes les manières possibles. Puis il avait été « attrapé comme un petit poussin » (l’expression serait du boss lui-même), ficelé comme un vulgaire détrousseur et soumis à un régime dégradant. Tout cela l’avait brisé.
DES DEMANGEAISONS DANS LES MAINS - Il s’était donc rabaissé à écrire une lettre pitoyable au patron, puis voyant que cela n’avait eu aucun effet, il fit demander à Sumalé et obtint de lui que les mauvais traitements corporels auxquels n’avait pas échappé son ami et compagnon Niguèlin lui soient épargnés. Que donna-t-il en échange ? Cela restera un secret entre les deux hommes. Tiéni ne fut donc pas maltraité. Mais certains se chargèrent de lui rappeler sa nouvelle condition. Dèssè, qui était chargé de conduire les enquêtes, se donna le plaisir de balancer en pleine figure de son ancien compagnon du Conseil militaire quelques gifles bien senties. Histoire, dit-il, de « soigner les démangeaisons » qu’il éprouvait dans les mains à la seule vue de Tiéni. Ce dernier laissa échapper des larmes de rage en subissant cette humiliation, mais il ne prit pas le risque d’énerver Dèssè par une réaction d’orgueil que son geôlier lui aurait certainement fait payer cher. Les langues continuaient à se délier et une nouvelle vague d’arrestations passa sur les différents corps de l’armée et de la sécurité.
Le colonel Ussuby, que l’on avait annoncé sous les verrous, était en réalité placé sous étroite surveillance pendant toute une semaine. Son arrestation spectaculaire à Koulouba dans son ministère le 8 mars (une semaine plus tard) devançait de peu celle du Chef d’état-major de l’armée de terre Dantuma, celui de la gendarmerie Niamba ainsi que quelques chefs de bataillon dont le commandant de la zone de défense de Ségou Tiécoroba, des capitaines, lieutenants et quelques sous-officiers. Tous furent déclarés inféodés à la « bande des trois ». Une longue liste de détenus fut dressée afin que la population se rende compte de l’étendue des périls auxquels elle avait échappé. Tout cela relevait d’une grande mise en scène que dirigeait, non sans plaisir, Fankélé. C’était lui qui s’occupait des communiqués de presse. Il donnait des détails sur les caches de trésor des vaincus et rendait compte des activités de la Commission nationale d’enquête, mise en place pour amuser la galerie. Nous vivions alors dans une période où l’intoxication de l’opinion publique marchait à fond. Rien n’était négligé pour salir la réputation des vaincus et pour présenter les vainqueurs comme des redresseurs de torts. Mais tout cela n’était pas sans danger.
Le Chef lui-même avait trouvé un moment que Fankélé en faisait trop et qu’il avait lancé une machine qui pouvait s’emballer dangereusement. « On a tout le temps, il ne faut pas tout révéler », avait-il dit à l’un de ses proches. Le principal bouc émissaire dans cette « campagne d’information du peuple » était Niguèlin. Transféré dans une cellule dans la capitale, il disposait d’un petit poste radio sur lequel il écoutait la liste de ses crimes qui s’allongeait chaque jour davantage. Mais dans cette atmosphère de règlements de compte, le Chef ne perdait pas de vue ce qui demeurait essentiel, l’affirmation de son autorité sur l’armée. Dans ce but, il entreprit une tournée dans les garnisons et à cette occasion il adopta un nouveau look, comme on le dit aujourd’hui. Lui qui avait critiqué les lunettes noires qu’arboraient ses rivaux lorsque ceux-ci étaient au plus haut de leur puissance, se trouva une paire de verres fumés pour effectuer son périple dans les camps de Kati et Bamako. Dans la ville de garnison comme au bataillon des parachutistes, le Chef commit l’erreur dont nous vous parlions plus haut. Il jeta un froid dans ce qui était le corps d’élite de l’armée. En se livrant à une description minutieuse du projet de coup de force de Niguèlin et de ses complices, il déclara que : « les paras devaient être le fer de lance de la manœuvre » et qu’il leur avait été affecté « la mission de l’assassiner ».
Les parachutistes regardèrent avec des yeux ronds le boss. Depuis dix ans, leur troupe assurait la garde personnelle du Chef et ce dernier n’avait pas eu un seul instant à douter de leur loyauté. Voilà qu’à cause de leur ancien chef le capitaine Djalan, qui s’était trouvé dans le camp des comploteurs, on les suspectait d’être « tous mêlés » à une tentative de coup d’Etat. Les parachutistes furent encore plus ulcérés quand dans les jours qui suivirent, on leur retira la garde du Chef pour la confier aux gendarmes de Dula. Le capitaine Bouna - le supérieur de Klékagni - et le jeune lieutenant sentaient le malaise monter dans la troupe. Et ils voyaient bien que s’ils ne faisaient pas quelque chose, la situation pouvait se dégrader au niveau des hommes. Heureusement le boss, averti par son entourage, reçut Bouna peu de jours après sa tournée. Il tenait, dit-il, à faire une mise au point. Il indiqua à l’officier qu’il n’avait pas stigmatisé la compagnie para dans son intégralité, mais seulement des « éléments à la solde de Djalan ». Il suggérait donc qu’une purge soit effectuée pour extraire les complices de l’ancien commandant de compagnie. Klékagni voyait l’engrenage infernal que déclencherait une chasse aux sorcières, et il convainquit son supérieur du danger de déstabilisation qu’amènerait la stigmatisation de certains éléments.
SENSIBLE AUX « CADEAUX » - Personnellement il était soulagé que la garde du boss ait été retirée à ses hommes. Mais son soulagement fut de courte durée. On amena moins de deux mois plus tard au camp para les prisonniers les plus importants. La raison de ce regroupement était des plus prosaïques. Il s’était révélé que les détenus causaient pas mal de dégâts dans leur lieu d’enfermement respectif, situé dans diverses garnisons du pays. Ils causaient avec les sentinelles, leur racontaient leur version des événements de Novembre 1968 et leur faisaient comprendre que les fonds saisis n’étaient pas reversés au Trésor comme l’affirmait Fankélé dans ses communiqués. Les soldats, ébranlés par ces révélations, étaient devenus beaucoup moins rigoureux dans leur surveillance. Ils acceptaient des billets, allaient faire des commissions des détenus, leur amenaient leurs repas. Dèssè, qui devait tenir les soldats en mains, était complètement dépassé. D’autant qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’être lui-même irréprochable. Il avait eu le malheur de montrer qu’il était sensible, lui aussi, aux « petits » cadeaux. Sa commission d’enquête avait mis le grappin sur un homme d’affaires de Ségou, qui était l’ami personnel de Kramo. Justement, celui-ci était venu pour demander qu’on lui restitue la valisette saisie dans le coffre de la Mercedes de ce dernier. Elle lui appartenait et il en avait les preuves. Kramo, qui était ministre des Transports avant les événements de février, avait accepté d’acheminer à partir d’Abidjan la somme de vingt-cinq millions de francs CFA remis par les associés ivoiriens de son ami, qui possédait des parts dans une entreprise de filature située en Côte d’Ivoire.
Arrivé à Bamako, Kramo avait téléphoné au destinataire afin que celui-ci vienne chercher son argent. Arguant divers empêchements, le Ségovien lui donna rendez-vous pour le mercredi 1er mars. Dans l’intervalle arriva ce que nous savons. Cela n’empêcha pas l’ami de Kramo de venir en personne à la Commission d’enquête réclamer que lui soit restitué son argent. Pour toute réponse, il fut arrêté. Son interpellation provoqua une vague de protestations dans le milieu d’affaires de Ségou, qui jugea que l’intéressé avait été victime d’un arbitraire incompréhensible. Pragmatiques comme savent l’être les commerçants, les collègues du prévenu décidèrent de ne pas perdre leur temps dans des démarchages superflus, ni dans des protestations inutiles. Ils se cotisèrent et offrirent à Dèssè un pactole substantiel que ce dernier n’eut pas la force de refuser. Et comme il voulait trainer les pieds pour relaxer l’opérateur économique les proches de celui-ci firent remonter l’affaire jusqu’au niveau de Béréni. Est ce que ce fut le déclencheur ? Qu’importe puisque le businessman fut blanchi rapidement des soupçons portés sur lui. Libéré dans la foulée, il fut accueilli en triomphe dans sa ville. Il apporta les papiers justificatifs et recouvra l’intégralité de la somme contenue dans la valisette confiée à Kramo. On se garda bien de le clamer sur tous les toits. Comme on le voit la commission d’enquête avait de la peine à ficeler des dossiers de prévarication solides. Mais l’affaire ne s’arrêta pas là. Un officier au sein de la commission d’enquête avait suivi toutes ces tractations et écœuré, il fit remonter l’information jusqu’au Chef. Ce dernier poussa un soupir exaspéré et fit la réflexion à haute voix qu’en prison ses ex-compagnons se montraient encore plus nuisibles que s’ils se trouvaient en liberté.
(à suivre)
TIEMOGOBA
Le lendemain du 28 février, les arrestations se sont poursuivies à un bon rythme. Elles ne concernaient plus que le « menu fretin », selon l’expression utilisée par Fankélé. Mais ce dernier ne relâchait pas sa vigilance. Il avait choisi de ne rien négliger et il avait de quoi faire, car les langues se déliaient parmi les prisonniers surtout parmi ceux d’entre eux, qui étaient littéralement terrifiés quand on leur évoque une exécution possible. Les plus déstabilisés étaient les policiers. Leurs gardiens soldats n’avaient aucune raison de les ménager et leur promettaient à tout bout de champ qu’ils iraient au « poteau ». Le Chef était, lui également, attentif au déroulement des événements. Il se montrait intéressé par tout ce qui pouvait accabler ses adversaires. Il tenait en particulier à détruire définitivement la réputation de Niguèlin. Il ne pardonnait pas à cet homme qui, au sein du Conseil militaire, l’avait contesté avec le plus de virulence.
Le sort donna un coup de pouce au Chef dans son entreprise. Certains initiés avaient entendu parler d’une valisette que Niguèlin gardait chez lui, et sur le contenu de laquelle couraient les rumeurs les plus folles. Dèssè avait fait mettre à sac le domicile de son ennemi intime, mais n’y avait rien trouvé. Ce fut un simple soldat qui vendit la mèche aux enquêteurs. Cette fois-ci, les recherches s’orientèrent vers la résidence que l’ancien ministre avait conservée dans le camp de Kati et elles furent conduites de nuit par le « N° 2 » du Conseil en personne. Du sol de la maison creusé en un endroit bien précis fut tirée la fameuse valisette. Diaraba ne retint pas un large sourire quand on lui remit l’objet. Il fit forcer les serrures et laissa échapper un soupir de dépit en voyant le contenu. Dans la valisette, il n’y avait que quelques milliers de dollars, de francs français et de marks allemands. La somme n’était certes pas négligeable, mais bien des commerçants conservaient des montants beaucoup plus importants chez eux que la petite dizaine de millions récupérée. Mais en poussant un peu plus sa fouille, Diaraba trouva plus précieux que cet argent.
La valisette renfermait dans un double fond des dossiers explosifs placés dans de simples chemises en carton. Ces dossiers contenaient des informations qui pouvaient éclabousser plusieurs des membres du Conseil militaire vainqueurs du bras de fer du 28 février. Diaraba lui-même eut un frisson en jetant un coup d’œil dessus. Un moment (cela, il l’avoua par la suite à un ami très proche), il eut la tentation de garder pour lui toute cette dynamite, car elle pouvait lui servir. Mais il se rendit compte que c’était extrêmement risqué. Trop de témoins avaient vu les dossiers, et même s’ils ne savaient pas ce qui était à l’intérieur, ils avaient remarqué l’intérêt prononcé de l’officier. Diaraba se résigna donc à transmettre les documents en mains propres au patron. Ce dernier avait été plutôt déçu lorsqu’on lui avait communiqué le montant de la somme contenue dans la valisette. Par contre ils prit les dossiers contenus dans la valisette de Niguèlin et les plaça dans un coffre quand il se retrouva seul. Les quelques millions trouvés ne pouvaient servir à illustrer de manière éloquente la rapacité de Niguèlin et à le présenter comme un vil prédateur qui avait, sans scrupule aucun, sucé le « sang du peuple ».
Mais l’histoire n’est jamais avare de petites ironies et l’élément accablant, que cherchait à obtenir le boss, allait lui être apporté de manière plus qu’étonnante. En effet, alors que les hommes de Diaraba avaient mis sens dessus sens dessous le domicile de Kati pour trouver quelque chose qui aurait définitivement discrédité Niguèlin et ses compagnons aux yeux de l’opinion publique, ce fut du camp des parachutistes qu’allait provenir une preuve providentielle contre la « bande des trois ». Tout fut déclenché par un acte banal de consignation. Kramo avait été mis sous les verrous avec ses compagnons et tout naturellement sa Mercedes de fonction fut garée dans un lieu sûr au camp. Les clés du véhicule furent ensuite remises à l’adjoint du commandant de la compagnie para.
« LES AFFAIRES DE MILITAIRES » - Il se trouvait que le chauffeur de Kramo, Modian, était un soldat de cette compagnie tout comme son patron. Les compagnons de Modian le virent errer ça et là avec un air soucieux, mais personne ne s’avisa de lui demander ce qui le tracassait. On pensait qu’il était légitimement perturbé par l’arrestation de son patron. En fin d’après-midi le soldat sollicita un entretien avec le nouveau responsable du camp, le lieutenant Klékagni. Ce qu’il raconta fit ciller le jeune officier qui fit aussitôt appeler l’adjudant de la compagnie Niamanto, un homme d’une raideur toute militaire et un autre soldat. Ces deux dernières personnes devaient servir de témoins à l’événement qui allait suivre. Le quatuor se rendit au garage improvisé où se trouvait la Mercedes de Kramo. Le lieutenant fit procéder à l’ouverture du coffre arrière de la voiture. Le soleil avait déjà décliné, mais la lumière était suffisante pour distinguer la valisette de cuir déposée sur le plancher. Les quatre hommes repartirent ensemble au bureau de la compagnie où ils procédèrent à l’ouverture de la mallette qui s’avéra remplie jusqu’à ras bord de billets de banque tous neufs. Soldats et officier reconnurent plus tard que le spectacle de cette fortune insolemment exposée leur coupa le souffle et leur donna le vertige. Aucun d’eux n’avait vu de sa vie autant d’argent à la fois.
Le lieutenant fit venir un secrétaire et lui demanda de dresser le procès-verbal de ce qu’ils allaient faire, c’est-à-dire le décompte de la somme. L’entreprise s’avéra beaucoup plus ardue que les quatre hommes ne s’y attendaient. Aucun d’entre eux n’avait l’habitude de manier les billets et surtout tous craignaient de se tromper dans leurs additions. Ils comptèrent ces gros billets de banque et les recomptèrent. En finir avec le contenu de la petite valise leur prit donc deux bonnes heures et demie. Ils terminèrent trempés de sueur malgré l’air que brassait un vieux ventilateur, c’était sans doute sous l’effet de la concentration et du stress. Klékagni demanda au secrétaire de consigner le montant de leur trouvaille dans le procès-verbal. Quand tout cela fut bouclé, la nuit était déjà très avancée et il était impossible de quitter le camp puisque tous les hommes y étaient consignés avec interdiction formelle d’en sortir jusqu’au moment de la relève. D’autre part, Klékagni n’avait aucun moyen pour avertir un membre du Conseil militaire, tout le monde ayant quitté la « Maison du peuple ». La valisette resta donc sous la surveillance du lieutenant et de l’adjudant de compagnie. Les deux soldats reçurent la permission de rejoindre leur casernement. Ce qu’ils s’empressèrent de faire. En effet, ils avaient quitté leur famille tôt le matin et ils savaient qu’en raison des temps particuliers qui prévalaient, aussi bien les épouses que les enfants des porteurs d’uniforme étaient inquiets sur le sort des chefs de famille. Car, comme ils le disaient eux-mêmes, dans les affaires de militaires tous le monde sait comment cela s’enclenche, mais personne ne se doute de la manière dont cela peut se terminer.
Le lendemain à sept heures, après le rassemblement et la répartition des tâches futures, les consignés de la veille eurent l’autorisation de sortir du camp sans toutefois s’en éloigner pour des raisons évidentes de sécurité. Le lieutenant tenait à remettre en mains propres au nouveau maître du pays la valisette et le procès–verbal. Cette démarche lui avait été conseillée avec beaucoup d’insistance par ses hommes, l’adjudant de compagnie en tête. Car en cette période troublée, les accusations les plus farfelues pouvaient tomber sur n’importe quelle tête et il valait mieux s’entourer d’un maximum de garanties. Arrivé à la Maison du peuple, le lieutenant Klékagni procéda à une rapide inspection de ses soldats affectés à la protection de l’édifice, avant d’aller attendre le boss près de l’entrée du bureau de ce dernier. Le patron, qui avait abandonné son treillis de la veille pour une tenue kaki clair moins martiale, s’étonna à peine de voir un visiteur aussi matinal. Le lieutenant remarqua toutefois que le boss avait une mine soucieuse. Ce n’était pas du tout le visage d’un homme qui avait renversé la situation en sa faveur et qui aurait dû jouir pleinement de son triomphe. Le patron demanda au jeune officier d’attendre qu’il lui fasse signe. Puis il s’installa dans son bureau pour recevoir le trio Sumalé-Diaraba-Fankélé. Ils étaient venus lui faire le premier point de la journée du 28, avant de recevoir du Chef les tâches à réaliser ce 1er mars. Ce fut seulement après les avoir laissés repartir qu’il demanda qu’on introduise Klékagni, porteur de la fameuse valisette. Le jeune officier fit un bref exposé des faits et se tut dans l’attente des questions. Celles-ci ne vinrent pas. Le Chef se leva, un très léger sourire aux lèvres et demanda dans l’interphone à Sumalé de venir. Fankélé, lui, avait été chargé d’accueillir la foule qui, comme lors des événements du 19 novembre 1968, affluait pour présenter des motions de soutien.
TRANSFORME PAR LES EVENEMENTS - Les couloirs de la Maison du peuple grouillaient d’officiers, mais le remue-ménage s’arrêtait au rez-de-chaussée. Seuls de très rares privilégiés étaient admis à l’étage. Dans le bureau du Chef, on entendait la rumeur sourde de la foule qui s’était massée dans la grande cour. Après l’entrée de Sumalé, Klékagni fut invité à donner un maximum de détails sur les circonstances de sa découverte. Au fur et à mesure qu’il parlait, le sourire sur le visage du patron s’élargissait : voici enfin une preuve accablante qui lui permettait de tomber à bras raccourcis sur ses ennemis, et de les dépeindre comme des profiteurs qui accumulaient sans vergogne l’argent mal acquis. Il demanda à Sumalé d’aller prévenir séance tenante la foule, venue lui manifester son soutien, qu’il ferait dans les prochaines minutes une déclaration publique. Resté en tête-à-tête avec Klékagni, le boss examina longuement son vis-à-vis, comme s’il avait voulu percer le fond de son âme. Puis il finit par dire : « Mon lieutenant, vous irez loin, vous irez vraiment loin. Restez toujours aussi honnête que vous l’êtes ». Quand Sumalé revint pour lui dire que tout était prêt, le patron fit signe à Klékagni de le suivre. Il voulait dit-il le présenter au peuple.
Le jeune officier, visiblement gêné par la tournure que prenaient les choses, essaya de se dérober en disant qu’il ne méritait pas un tel honneur. Mais le boss avait déjà tourné les talons, la valisette à la main comme pièce à conviction. Sumalé poussa amicalement le jeune lieutenant dans la foulée du Chef qui vint s’installer au balcon. Dans un discours enflammé, il donna le ton du futur procès à intenter aux prédateurs. Cet homme, qui dans les circonstances ordinaires n’avait aucune éloquence, était littéralement transformé par les événements. Son bégaiement avait disparu et il ne butait plus sur les mots. Il savait trouver les expressions propres à déchainer l’enthousiasme de la foule. Avec des accents d’une très grande conviction, il parlait de justice, d’équité, de respect de l’homme et d’amour du pays. L’assistance était comme en adoration devant lui. Il brandit la valisette en disant que c’était là une partie du trésor accumulé par les pilleurs du peuple, mais que tout le reste serait récupéré. Son geste et ses paroles déclenchèrent un véritable délire dans la foule. Des témoins dirent plus tard que le boss, même s’il devait vivre jusqu’à mille ans, n’oublierait jamais ce moment là. Car il n’y en a pas deux comme celui-là dans l’existence d’un homme.
Le patron avait conscience du caractère privilégié de l’instant. Debout sur le balcon de la Maison du peuple, il savourait intensément chaque seconde de cette heure de gloire. En ces minutes bien précises, il avait la conviction d’être le seul maître à bord. Ce fut d’ailleurs cette nouvelle autorité qu’il affirma haut et fort lors d’une tournée qu’il effectua les jours suivants dans les garnisons de Kati et Bamako. Mais c’est très souvent dans l’euphorie que se commettent les erreurs les plus grossières, et le Chef ne put en éviter une de taille sur laquelle nous reviendrons plus tard. En attendant, essayons de savoir ce que devenaient les prisonniers les plus célèbres de l’époque.
La nuit du 28 février, ils avaient été regroupés dans une petite bâtisse qui se trouvait à l’entrée du camp de Kati. C’était une ancienne guérite qui avait servi de poste de garde et qui pouvait à grand peine accueillir deux hommes. Les conjurés se trouvèrent à plus d’une demie douzaine à l’intérieur, pressés dans une obscurité étouffante. Le petit cagibi avait été entouré d’un champ de barbelés et pendant toute la nuit de puissants projecteurs étaient braqués sur l’abri. Des sentinelles en nombre impressionnant formaient le cordon de sécurité. Certaines d’entre elles racontèrent ensuite que pendant toute cette nuit, elles avaient entendu les hurlements affreux poussés par Tiéni que torturait le manque d’amphétamine. Les prisonniers furent ensuite dispersés dans les différentes garnisons de l’intérieur. En jouant sur les inimitiés des uns et des autres, le Chef avait fait mettre Niguèlin à la disposition de Yéléko au camp de Sévaré. A peine eut-il débarqué là-bas que l’ancien ministre de la défense et de l’Intérieur reçut la visite de son ex-subordonné, tout heureux de pouvoir régler avec lui un vieux contentieux. Yéléko n’avait pas oublié un épisode pas très reluisant de sa carrière et qui datait du temps où il était gouverneur de la région de Kayes. Niguèlin l’avait fait convoquer un jour, tard en fin d’après-midi et il l’avait vertement admonesté sur la gestion de sa région et sur les déplacements inopportuns qu’il s’autorisait en venant sans autorisation à Bamako. Avant de le renvoyer, le ministre avait fait savoir au gouverneur qu’il lui téléphonerait le lendemain à sept heures trente. « Vous avez intérêt à être dans votre bureau au moment de mon coup de fil », avait dit le ministre Niguèlin de cette voix froide qu’il savait prendre lorsqu’il voulait donner tout son poids à une menace.
TOUT LE DESARROI DE TIENI - Il était alors 19 heures passées et il n’y avait pas le moindre train pour rallier Kayes. A cette époque, le rail était quasiment l’unique moyen de transport en direction de la capitale de la Première région administrative du pays. La route se trouvait dans un état plus que exécrable, l’avion était exclu. D’après les proches de Niguèlin, Yèlèko aurait fait sortir de table le chef de gare de la capitale qui dînait tranquillement. Il aurait exigé de ce dernier qu’il lui trouve immédiatement une solution pour rallier sa ville, mais sans lui expliquer les raisons de cette urgence. Le responsable du chemin de fer n’avait rien d’autre à proposer à l’officier que d’affréter une draisine, ce véhicule de la taille d’une grosse camionnette et qui sert à l’inspection par les techniciens des voies ferrées. Mais outre le fait d’être inconfortable, la draisine présentait le désavantage d’être ouverte sur les côtés et d’exposer ses passagers au vent coupant de la nuit. L’inconvénient était notable et il était encore amplifié par la fraîcheur de la saison. Mais Yéléko n’avait pas le choix et il s’embarqua dans ce véhicule de fortune pour parcourir 550 éprouvants kilomètres sans escale. On avait fait mettre à l’arrêt tous les trains de nuit en partance où en provenance de Kayes si bien qu’il fut ponctuel au rendez-vous du coup de fil de son patron, s’évitant ainsi des arrêts de rigueur. Mais Yèlèko n’avait jamais digéré cette mésaventure, et on peut imaginer à quel point il jubila quand il reçut le coup de fil du boss lui demandant de « recevoir » Niguèlin. Il tint à être à l’accueil de celui qu’il désignait comme une « bête sauvage ». Il fit détacher son prisonnier et s’enferma avec lui dans le local qui servait de cellule. Il faut savoir que Yéléko n’était pas un maigrichon et que son passé de commando parachutiste lui avait donné une bonne science du corps à corps.
Lorsque quelques minutes plus tard il demanda qu’on ouvre la porte, Niguèlin ne ressemblait plus à l’officier hautain, plein de morgue et de suffisance qui toisait les anciens gradés avec un dédain qu’il ne cherchait même pas à cacher. La face tuméfiée, les pommettes éclatées, la bouche ensanglantée, l’homme tenait debout surtout grâce à son immense orgueil. C’était ce même orgueil qui l’avait empêché de crier pendant qu’il encaissait les coups lourds de son geôlier, qui pesait au moins une fois et demie plus que lui. Mais il ne put retenir un faible gémissement de douleur lorsqu’il essaya de s’étendre pour récupérer un peu de forces. Le calvaire de Niguèlin ne s’arrêta cependant pas à cette seule correction. Son ennemi revint lui rendre visite le lendemain et lui fit subir le même traitement. Cette fois non plus, Niguèlin ne cria pas, mais il perdit connaissance. Un seau d’eau balancé sans ménagement le fit revenir à lui et en ouvrant les yeux, il vit que son tortionnaire attendait en devisant avec certains officiers et sous-officiers de la garnison.
Au troisième passage à tabac, Niguèlin eut la force de traiter son bourreau de lâche, ce qui lui coûta une dégelée encore plus violente de coups. Après cela on le laissa tranquille, car il devait être plus ou moins présentable pour être interrogé par Dèssè et son équipe d’enquête qui allait venir de Bamako. Niguèlin raconta plus tard à certains de ses codétenus que pendant qu’on le martyrisait, il pensait surtout à Tiéni qu’il savait moins coriace que lui. Mais il ne se doutait pas que l’ancien chef de la Sécurité avait abdiqué dès le premier jour. Tiéni avait même fait transmettre au Chef, par l’intermédiaire de Sumalé, une lettre dans laquelle il confessait ses « erreurs » et demandait l’indulgence du boss. Tiéni avait demandé à Sumalé, qui était son ami, de rappeler au Chef les coups de main qu’il avait donné à celui-ci et les embarras d’où il l’avait tiré, en prenant sur lui certaines fautes qui n’auraient pas dû lui être imputées. Dans cette démarche on sentait tout le désarroi d’un homme qui n’avait jamais imaginé qu’il pouvait tomber aussi bas. D’ailleurs Tiéni, au temps de sa splendeur, se vantait devant qui voulait l’écouter que lui ne serait jamais pris vivant. Il préfèrerait, disait-il, se mettre une balle dans la tête.
Le tout puissant chef de la Sécurité affirmait qu’il s’était compromis dans trop de sales manœuvres pour que grâce lui soit faite si jamais le régime militaire tombait. Mais il ne lui était certainement jamais venu à l’esprit que les siens puissent se saisir de lui. Il en savait trop sur chacun d’eux et pensait que ses dossiers constituaient un rempart derrière lequel il était intouchable. Mais comme le dit la sagesse bamanan : « Tiè magni tiè bolo dè » (Il ne fait jamais bon pour un homme d’être entre les mains d’un autre homme) ! Tiéni avait détenu un pouvoir quasi absolu et il en avait joui de toutes les manières possibles. Puis il avait été « attrapé comme un petit poussin » (l’expression serait du boss lui-même), ficelé comme un vulgaire détrousseur et soumis à un régime dégradant. Tout cela l’avait brisé.
DES DEMANGEAISONS DANS LES MAINS - Il s’était donc rabaissé à écrire une lettre pitoyable au patron, puis voyant que cela n’avait eu aucun effet, il fit demander à Sumalé et obtint de lui que les mauvais traitements corporels auxquels n’avait pas échappé son ami et compagnon Niguèlin lui soient épargnés. Que donna-t-il en échange ? Cela restera un secret entre les deux hommes. Tiéni ne fut donc pas maltraité. Mais certains se chargèrent de lui rappeler sa nouvelle condition. Dèssè, qui était chargé de conduire les enquêtes, se donna le plaisir de balancer en pleine figure de son ancien compagnon du Conseil militaire quelques gifles bien senties. Histoire, dit-il, de « soigner les démangeaisons » qu’il éprouvait dans les mains à la seule vue de Tiéni. Ce dernier laissa échapper des larmes de rage en subissant cette humiliation, mais il ne prit pas le risque d’énerver Dèssè par une réaction d’orgueil que son geôlier lui aurait certainement fait payer cher. Les langues continuaient à se délier et une nouvelle vague d’arrestations passa sur les différents corps de l’armée et de la sécurité.
Le colonel Ussuby, que l’on avait annoncé sous les verrous, était en réalité placé sous étroite surveillance pendant toute une semaine. Son arrestation spectaculaire à Koulouba dans son ministère le 8 mars (une semaine plus tard) devançait de peu celle du Chef d’état-major de l’armée de terre Dantuma, celui de la gendarmerie Niamba ainsi que quelques chefs de bataillon dont le commandant de la zone de défense de Ségou Tiécoroba, des capitaines, lieutenants et quelques sous-officiers. Tous furent déclarés inféodés à la « bande des trois ». Une longue liste de détenus fut dressée afin que la population se rende compte de l’étendue des périls auxquels elle avait échappé. Tout cela relevait d’une grande mise en scène que dirigeait, non sans plaisir, Fankélé. C’était lui qui s’occupait des communiqués de presse. Il donnait des détails sur les caches de trésor des vaincus et rendait compte des activités de la Commission nationale d’enquête, mise en place pour amuser la galerie. Nous vivions alors dans une période où l’intoxication de l’opinion publique marchait à fond. Rien n’était négligé pour salir la réputation des vaincus et pour présenter les vainqueurs comme des redresseurs de torts. Mais tout cela n’était pas sans danger.
Le Chef lui-même avait trouvé un moment que Fankélé en faisait trop et qu’il avait lancé une machine qui pouvait s’emballer dangereusement. « On a tout le temps, il ne faut pas tout révéler », avait-il dit à l’un de ses proches. Le principal bouc émissaire dans cette « campagne d’information du peuple » était Niguèlin. Transféré dans une cellule dans la capitale, il disposait d’un petit poste radio sur lequel il écoutait la liste de ses crimes qui s’allongeait chaque jour davantage. Mais dans cette atmosphère de règlements de compte, le Chef ne perdait pas de vue ce qui demeurait essentiel, l’affirmation de son autorité sur l’armée. Dans ce but, il entreprit une tournée dans les garnisons et à cette occasion il adopta un nouveau look, comme on le dit aujourd’hui. Lui qui avait critiqué les lunettes noires qu’arboraient ses rivaux lorsque ceux-ci étaient au plus haut de leur puissance, se trouva une paire de verres fumés pour effectuer son périple dans les camps de Kati et Bamako. Dans la ville de garnison comme au bataillon des parachutistes, le Chef commit l’erreur dont nous vous parlions plus haut. Il jeta un froid dans ce qui était le corps d’élite de l’armée. En se livrant à une description minutieuse du projet de coup de force de Niguèlin et de ses complices, il déclara que : « les paras devaient être le fer de lance de la manœuvre » et qu’il leur avait été affecté « la mission de l’assassiner ».
Les parachutistes regardèrent avec des yeux ronds le boss. Depuis dix ans, leur troupe assurait la garde personnelle du Chef et ce dernier n’avait pas eu un seul instant à douter de leur loyauté. Voilà qu’à cause de leur ancien chef le capitaine Djalan, qui s’était trouvé dans le camp des comploteurs, on les suspectait d’être « tous mêlés » à une tentative de coup d’Etat. Les parachutistes furent encore plus ulcérés quand dans les jours qui suivirent, on leur retira la garde du Chef pour la confier aux gendarmes de Dula. Le capitaine Bouna - le supérieur de Klékagni - et le jeune lieutenant sentaient le malaise monter dans la troupe. Et ils voyaient bien que s’ils ne faisaient pas quelque chose, la situation pouvait se dégrader au niveau des hommes. Heureusement le boss, averti par son entourage, reçut Bouna peu de jours après sa tournée. Il tenait, dit-il, à faire une mise au point. Il indiqua à l’officier qu’il n’avait pas stigmatisé la compagnie para dans son intégralité, mais seulement des « éléments à la solde de Djalan ». Il suggérait donc qu’une purge soit effectuée pour extraire les complices de l’ancien commandant de compagnie. Klékagni voyait l’engrenage infernal que déclencherait une chasse aux sorcières, et il convainquit son supérieur du danger de déstabilisation qu’amènerait la stigmatisation de certains éléments.
SENSIBLE AUX « CADEAUX » - Personnellement il était soulagé que la garde du boss ait été retirée à ses hommes. Mais son soulagement fut de courte durée. On amena moins de deux mois plus tard au camp para les prisonniers les plus importants. La raison de ce regroupement était des plus prosaïques. Il s’était révélé que les détenus causaient pas mal de dégâts dans leur lieu d’enfermement respectif, situé dans diverses garnisons du pays. Ils causaient avec les sentinelles, leur racontaient leur version des événements de Novembre 1968 et leur faisaient comprendre que les fonds saisis n’étaient pas reversés au Trésor comme l’affirmait Fankélé dans ses communiqués. Les soldats, ébranlés par ces révélations, étaient devenus beaucoup moins rigoureux dans leur surveillance. Ils acceptaient des billets, allaient faire des commissions des détenus, leur amenaient leurs repas. Dèssè, qui devait tenir les soldats en mains, était complètement dépassé. D’autant qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’être lui-même irréprochable. Il avait eu le malheur de montrer qu’il était sensible, lui aussi, aux « petits » cadeaux. Sa commission d’enquête avait mis le grappin sur un homme d’affaires de Ségou, qui était l’ami personnel de Kramo. Justement, celui-ci était venu pour demander qu’on lui restitue la valisette saisie dans le coffre de la Mercedes de ce dernier. Elle lui appartenait et il en avait les preuves. Kramo, qui était ministre des Transports avant les événements de février, avait accepté d’acheminer à partir d’Abidjan la somme de vingt-cinq millions de francs CFA remis par les associés ivoiriens de son ami, qui possédait des parts dans une entreprise de filature située en Côte d’Ivoire.
Arrivé à Bamako, Kramo avait téléphoné au destinataire afin que celui-ci vienne chercher son argent. Arguant divers empêchements, le Ségovien lui donna rendez-vous pour le mercredi 1er mars. Dans l’intervalle arriva ce que nous savons. Cela n’empêcha pas l’ami de Kramo de venir en personne à la Commission d’enquête réclamer que lui soit restitué son argent. Pour toute réponse, il fut arrêté. Son interpellation provoqua une vague de protestations dans le milieu d’affaires de Ségou, qui jugea que l’intéressé avait été victime d’un arbitraire incompréhensible. Pragmatiques comme savent l’être les commerçants, les collègues du prévenu décidèrent de ne pas perdre leur temps dans des démarchages superflus, ni dans des protestations inutiles. Ils se cotisèrent et offrirent à Dèssè un pactole substantiel que ce dernier n’eut pas la force de refuser. Et comme il voulait trainer les pieds pour relaxer l’opérateur économique les proches de celui-ci firent remonter l’affaire jusqu’au niveau de Béréni. Est ce que ce fut le déclencheur ? Qu’importe puisque le businessman fut blanchi rapidement des soupçons portés sur lui. Libéré dans la foulée, il fut accueilli en triomphe dans sa ville. Il apporta les papiers justificatifs et recouvra l’intégralité de la somme contenue dans la valisette confiée à Kramo. On se garda bien de le clamer sur tous les toits. Comme on le voit la commission d’enquête avait de la peine à ficeler des dossiers de prévarication solides. Mais l’affaire ne s’arrêta pas là. Un officier au sein de la commission d’enquête avait suivi toutes ces tractations et écœuré, il fit remonter l’information jusqu’au Chef. Ce dernier poussa un soupir exaspéré et fit la réflexion à haute voix qu’en prison ses ex-compagnons se montraient encore plus nuisibles que s’ils se trouvaient en liberté.
(à suivre)
TIEMOGOBA
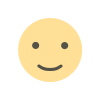 Like
0
Like
0
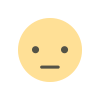 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
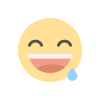 Drôle
0
Drôle
0
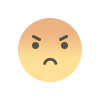 Hmmm
0
Hmmm
0
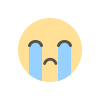 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0















































