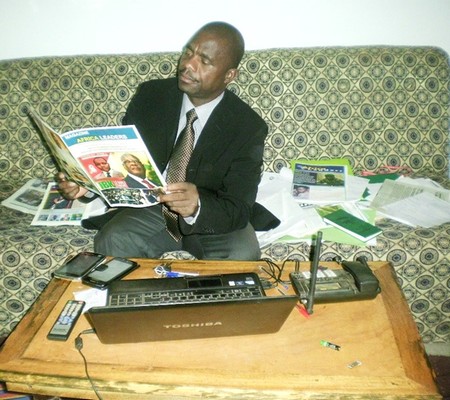La perspective que Donald Trump puisse décider à tout moment se retirer conflit ukrainien inquiète certains pays occidentaux, et le mot est faible. Même l’Australie, pourtant éloignée du Vieux Continent, a commencé à expédier 49 chars Abrams déclassés qu’elle souhaitait depuis longtemps donner à l’Ukraine. Les États-Unis ont, en tant que producteur, longtemps tenté de refuser de donner le feu vert, avant de finir par céder ce lundi. Une autorisation américaine qui arrive alors que visiblement, les premiers chars étaient déjà presque en route vers l’Ukraine.
Le Premier ministre australien Anthony Albanese a remporté une réélection surprise plus tôt ce mois-ci contre son rival conservateur, proche de Trump, devenant ainsi le premier Premier ministre à accroître sa majorité depuis un siècle, ce qui lui donne une certaine liberté pour le faire.
Responsabilité de l’Europe
Mais la capacité de l’Ukraine à survivre sans l’aide militaire américaine ne dépend pas que de l’Australie. Selon l’Ukraine Support Tracker de l’Institut pour l’économie mondiale de Kiel (IfW), l’Australie n’a jusqu’à présent fourni que 858 millions d’euros d’aide militaire. Cela le place à une place relativement insignifiante, au 16e rang mondial. Dans une autre étude publiée par l’IfW en mars, il s’avère que la responsabilité incombe en premier lieu à l’Europe.
“Outre la difficulté de fournir à l’Ukraine le même niveau d’assistance en termes de renseignement, de communications par satellite et de systèmes d’armes, dont l’Europe elle-même ne dispose pas, l’effort financier devrait être doublé.”
Kiel Institute for the World Economy
Le Vieux Continent a déjà dépassé les États-Unis en termes d’aide totale à l’Ukraine, avec 23 milliards d’euros. Mais en termes d’aide militaire, Washington reste en tête avec un milliard de dollars d’avance. Et au-delà des problèmes pratiques — comme la difficulté de fournir à l’Ukraine le même niveau d’assistance en termes de renseignement, de communications par satellite et de systèmes d’armes, dont l’Europe elle-même manque — les efforts financiers de l’Europe devraient redoubler pour combler le vide laissé par Trump, a déclaré l’IfW.
L’Allemagne promet 11 milliards
Pour l’instant, cet objectif semble loin d’être atteint, même si les dirigeants européens comme le chancelier allemand Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer tentent de se présenter comme les sauveurs de l’Ukraine. Mais pour l’instant, ils n’en font pas assez pour garantir les chances de survie de l’Ukraine.
L’Allemagne, qui a jusqu’à présent fourni 12,6 milliards d’euros d’aide militaire, devançant ainsi les États-Unis, a récemment promis d’ajouter 11 milliards d’euros. Mais ce montant s’applique pour une période de quatre ans. Si cette somme est répartie équitablement, cela représente près de 2,8 milliards par an. Et ce n’est pas du tout le double de ce que Berlin a donné jusqu’à présent. C’est même nettement moins que les 4,2 milliards qu’elle dépense actuellement en moyenne par an.
La Belgique grimpe à la 9e place
En scrutant les engagements déjà pris par d’autres pays européens cette année, il s’avère ainsi que l’Allemagne n’est pas l’État faisant le plus d’efforts. La première place revient au Royaume-Uni, qui promet pour 2025 5,4 milliards d’euros d’aides militaires, soit un montant supérieur à ses dépenses annuelles moyennes actuelles. La Norvège se démarque en prenant la deuxième place avec ses 4,3 milliards d’aides militaires (voire 7,3 milliards pour l’aide totale, humanitaire comprise) promis pour cette année, et l’Allemagne arrive seulement troisième.
Outre les Allemands, les Danois menacent également de fournir un soutien militaire moindre qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent. Copenhague chuterait ainsi de la 3e à la 8e place des pays européens soutenant l’Ukraine. En dehors du top 10, la Pologne et la Finlande devraient faire de même, bien que ces deux pays ont exprimé très ouvertement leur opposition à la Russie voisine de Vladimir Poutine.
La Belgique, quant à elle, double son montant annuel avec le milliard approuvé par le Conseil des ministres la semaine dernière. Un montant qui place notre pays à la 9ème place en termes de promesses pour cette année, contre la 12ème auparavant.
L’aide norvégienne multipliée par six
On notera également les hausses enregistrées en Italie (qui était auparavant 13e, désormais 7e) et en Espagne (Madrid passant de 17e à 10e). Leur effort reste limité, vu la taille de ces pays, mais ils font un grand pas en avant. Le plus gros effort vient toutefois de la Norvège, qui double son aide totale et multiplie par six son aide militaire.
La Norvège peut se le permettre car elle dispose d’un énorme fonds souverain financé par les revenus de l’extraction du pétrole et du gaz naturel. En mars de cette année, ce montant s’élevait à 1,7 billion d’euros. Et puisqu’elle a gagné au moins 100 milliards grâce à la hausse des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Ukraine, la pression s’est accrue pour qu’elle en restitue une partie aux victimes de ce conflit.
Source: https://www.7sur7.be/

 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0