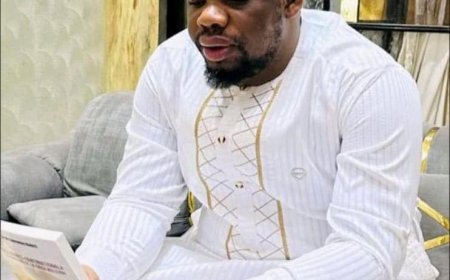Décryptage : Conflit de mots : entre terrorisme et banditisme
Ce matin, intéressons-nous à deux termes, terrorisme et banditisme, amalgamés pour qualifier la crise sécuritaire. Chaque village avait son bandit

Deux termes qui reviennent régulièrement dans le débat public. Ils alimentent un vocabulaire révélateur de l’émergence d’un nouvel ordre aux confins des univers africain, oriental et occidental.
Ils sont aussi significatifs du désappointement des populations, prises dans l’expression des rivalités entre l’Occident et la Fédération de Russie. C’est le contexte d’un équilibre précaire des rapports de force géopolitiques. Les efforts de prise de recul pour comprendre le phénomène sécuritaire échouent.
Au Mali, par le passé, le banditisme se traduisait dans les villages, par le vol d’un bélier, d’un bœuf par un individu pendant la nuit ou à l’abri des regards. La bête était alors revendue quelques heures sur une foire ou à un boucher en catimini à quelques kilomètres du dit lieu.
Le bandit était le délinquant du village, connu de tout le monde, mais bénéficiait d’une certaine tolérance. Chaque village avait son filou, son bandit ou son voleur, sougnènikela en bambara, zayo en songhay. Ça, c’était hier.
Aujourd’hui, ce sont des groupes d’individus, organisés et armés en collaboration avec les groupes armés terroristes, qui extorquent les populations de leurs biens au vu et au su de tous. Ils sévissent par la terreur et la violence : assassinats, crime organisé, viol. Partout, il s’est développé une mafia locale. Dans la conjoncture actuelle, parler de banditisme au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Bénin, c’est nier le phénomène sécuritaire. Par méconnaissance ou à dessein.
Désigner les attaques narcoterroristes actuelles par le terme de banditisme, c’est embrouiller l’opinion publique par la confusion des mots. Hélas ! Les humiliations et les assujettissements quotidiens des populations sont le fait des narcoterroristes. Le narcoterrorisme (Amara, 2019) est un phénomène circulaire. Dans nos Etats, il phosphore sur les vulnérabilités : corruption, instabilité, pauvreté…
Le narcoterrorisme, c’est aussi une guerre d’usure. Il grignote du terrain faute d’une évaluation objective. En cause, nos divisions internes. L’intrusion du numérique dans la gouvernance complexifie l’analyse, si tant est qu’elle existe. Cela dit, toute évaluation objective du narcoterrorisme passe par l’étude de ses causes profondes : manque d’emploi, carence éducative et sanitaire, abus, etc.
Certes, le narcoterrorisme se nourrit de la proximité religieuse. Mais, il s’enracine dans la quasi-absence de développement. Certes, la critique contre l’ordre international est nécessaire. Mais, notre responsabilité individuelle et collective doit être questionnée pour relever les défis sécuritaires. Certes, le contexte géopolitique est trouble.
Un trouble qui rend la perspective sécuritaire imprédictible. Mais, la priorité reste locale, celle de la construction de la paix. Certes, la dénonciation sous la pancarte géopolitique des crises internationales (Ukraine-Russie, Palestine-Israël) est centrale. Mais, nous devons nous astreindre à une analyse plus fine pour changer les conditions de vie de nos concitoyens.
Terminons par l’idée qu’il est nécessaire d’inventer un nouvel exercice du pouvoir qui prône la négociation et l’unité pour ramener la paix et la sécurité, ressorts de tout changement. Il serait utile pour les chefs d’Etats nigérien, burkinabé et malien de délocaliser leur conseil des ministres dans les capitales régionales. Une belle manière de manifester leur solidarité aux populations, en prise avec le narcoterrorisme.
Une question : qu’est-ce qui peut arrêter la crise sécuritaire ?
Une offre politique ;
L’organisation d’un scrutin présidentiel ;
Un travail diplomatique pour normaliser les relations avec l’Algérie ;
Et vous, qu’en pensez-vous ?
Mohamed Amara
(sociologue)
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0