Opinion : L’histoire a de la mémoire, même quand la diplomatie l’oublie
Lors du Forum de Lomé sur la paix et la sécurité, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a invoqué la figure de Modibo Keïta pour défendre la jeunesse au pouvoir au sein de l’Alliance des États du Sahel.
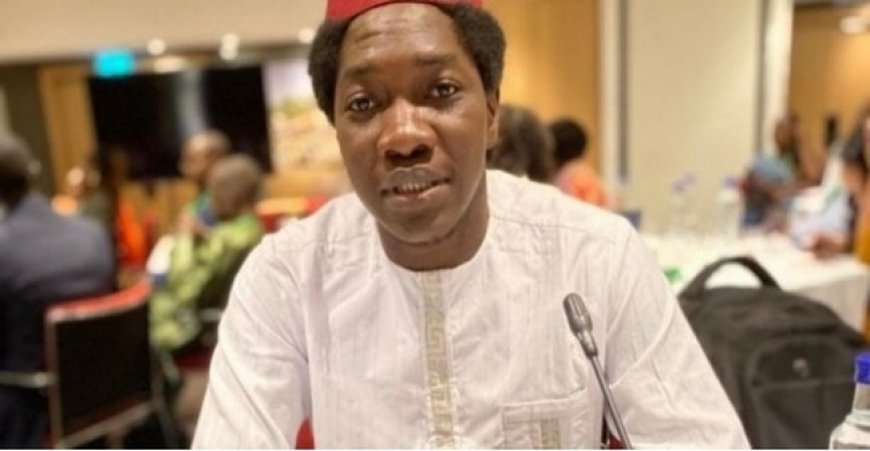
Une comparaison qui a suscité un débat inattendu, révélant à la fois la puissance symbolique de la mémoire du premier président du Mali et les fragilités du discours politique contemporain. Car on ne convoque pas impunément l’héritage de celui qui incarne encore la rigueur, la dignité et la vision du Mali indépendant.
Le Forum de Lomé sur la paix et la sécurité se voulait un rendez-vous d’idées, une plateforme de réflexion sur les défis complexes que traverse l’Afrique. Le panel a porté sur le thème « L’Afrique face aux défis sécuritaires complexes : comment renforcer et rendre durable la paix et la stabilité dans un monde en mutation ? ». Laissait espérer un dialogue nourri, à la hauteur des enjeux. Pourtant, en écoutant les ministres des Affaires étrangères des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), on restait sur sa faim. Les interventions, souvent prévisibles, ont davantage servi à réaffirmer les discours de souveraineté, d’unité et d’autonomie stratégique qu’à interroger la complexité des crises. Les grands mots étaient présents, mais les nuances beaucoup moins, insistant davantage sur la posture que sur une véritable analyse critique et prospective.
Rien d’étonnant, tant les débats sur la sécurité au Sahel finissent souvent par tourner autour des mêmes arguments : dénonciation du néocolonialisme, exaltation de la souveraineté, légitimation des transitions militaires. Pourtant, au milieu de cette rhétorique bien rodée, un propos de quelques secondes du ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, évoquant Modibo Keïta a suffi pour provoquer une onde de réactions inattendues sur les réseaux sociaux. L’intervention pour illustrer la jeunesse et la légitimité de la génération actuelle au pouvoir, est devenue virale mais pas dans le sens attendu.
« Les qualités que nous avons aujourd’hui, ils ne les avaient pas. Modibo Keïta était un instituteur, il n’avait pas été préparé à diriger un pays. Nous avons ces expériences aujourd’hui. Ce qui est important pour nous, c’est de comprendre que la jeunesse n’est pas pour demain. » Ces propos, à première vue anodins, se voulaient une célébration de la jeunesse et de la compétence des dirigeants actuels. Mais ils ont déclenché des réactions passionnantes, précisément parce qu’ils concernaient Modibo Keïta, figure tutélaire du Mali et symbole d’un moment fondateur de l’histoire africaine.
C’est bien beau, même si le ministre n’a pas clairement précisé quelles qualités distingueraient les générations. Je ne m’attarde pas sur la comparaison. À chaque époque ses défis, et les nôtres sont déjà suffisamment complexes. La responsabilité et l’implication des jeunes ne se décrètent pas dans les discours, elles se construisent par des politiques publiques concrètes. Et si l’on parle de préparation de la jeunesse à particulier pleinement à la gouvernance, la meilleure demeure celle que procure un système éducatif solide, inclusif et adapté aux réalités contemporaines. Or, malgré quelques initiatives, nous en sommes encore loin. Mais la comparaison mérite réflexion, dans la mesure où elle oppose l’impréparation supposée d’une figure politique majeure du continent, à une génération actuelle essentiellement issue du rang militaire. Modibo Keïta, avant d’être président, fut un acteur politique de premier plan, forgé dans les débats, les luttes syndicales et les institutions.
Les dirigeants d’aujourd’hui, eux, viennent du monde de l'armée, un univers de discipline et d’ordre, mais dont la vocation première n’est pas la conduite des affaires publiques ni la gestion du pluralisme politique. Et comme souvent, dans notre époque hyper connectée, certains extraits d’une intervention sont coupés, relayés, puis les algorithmes font le reste du boulot. La réaction suscitée ne tient pas seulement à la figure évoquée, mais à la manière dont elle l’a été. Le ministre a commis une double erreur factuelle et symbolique.
Factuelle, d’abord, en se trompant sur l’âge du premier président du Mali au moment de son accession au pouvoir, base même de son argumentaire sur la jeunesse. Il a dit que le président Keïta avait juste 33 ans au lieu de 45 ans lorsqu’il prenait la tête de la jeune République du Mali. Une vérification rapide sur internet aurait suffi à éviter cette approximation. Symbolique, ensuite, en réduisant Modibo Keïta à sa seule profession d’instituteur, comme si ce métier résumait l’homme. Ce raccourci occulte le parcours politique et intellectuel de Modibo Keita. Il fut syndicaliste, maire de Bamako, député, vice-président de l’Assemblée nationale française, président du Conseil du gouvernement soudanais, puis chef de l’État malien.
Il fut également cofondateur du Rassemblement Démocratique Africain (RDA), un mouvement panafricain qui a mené plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest vers l’indépendance. Le réduire à son passage dans l’enseignement, c’est nier la profondeur d’un engagement façonné par l’action, la réflexion et le sacrifice. Ce qui a nourri la polémique, ce n’est pas la maladresse, mais la légèreté avec laquelle la mémoire d’un homme d’État de cette envergure a été convoquée. Son héritage dépasse largement le Mali, même s’il suscite des critiques. Je fais partie de ceux qui émettent des réserves à son sujet. Il incarne toutefois une génération emblématique de dirigeants africains, tels que Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba. Sa mémoire reste vive, surtout dans un Mali en quête de repères.
Le ministre Abdoulaye Diop est reconnu pour son engagement constant sur la scène diplomatique et pour son rôle dans la défense de la souveraineté du Mali. Dans un contexte politique et diplomatique aussi tendu que celui du Mali actuel, la parole publique n’est jamais anodine. Elle engage l’État, elle façonne la perception du pays, elle structure le rapport entre mémoire et présent. Aujourd’hui, rien ne se pardonne, tout est scruté, et les moindres propos deviennent viraux grâce aux réseaux sociaux.
Ce qui hier aurait pu passer pour une simple imprécision devient désormais un fait politique, commenté, disséqué, amplifié au-delà des frontières. Les responsables publics ne parlent plus seulement devant un auditoire : ils s’expriment face à un continent connecté, à une opinion numérique instantanée, qui exige précision et cohérence. Dans ce monde d’exposition permanente, les mots n’appartiennent plus à ceux qui les prononcent : ils vivent, se transforment, se retournent parfois contre eux. Et c’est précisément pour cela que la rigueur du discours devient une forme de prudence diplomatique.
Bah Traoré
Analyste politique
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0















































