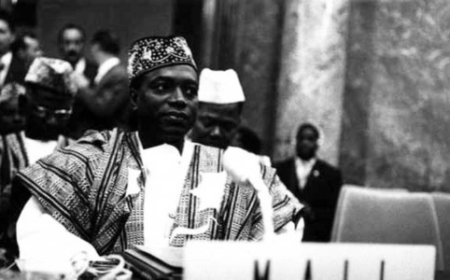L’héritage des chaines invisibles : Pourquoi l'Afrique francophone est à la traine
Au cœur de l'Afrique, là où le soleil de plomb révèle les cicatrices d'un passé colonial tenace, une question lancinante persiste : pourquoi certaines nations, hier sous le joug de la France, semblent-elles piégées dans un éternel recommencement, tandis que leurs voisines, autrefois couronnées par le sceptre britannique, affichent des trajectoires de développement plus dynamiques ?
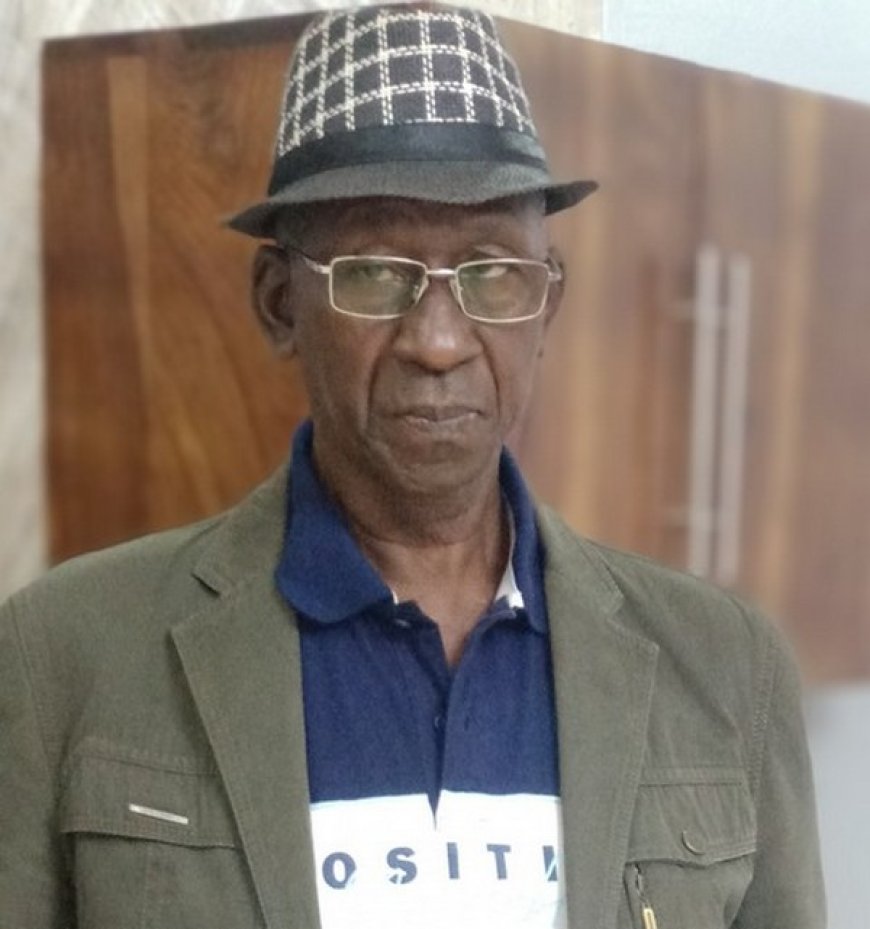
Derrière le vernis des indépendances proclamées, se cache une toile complexe d'accords et de pratiques, de choix et d'héritages, qui continue de façonner les destins. Embarquons pour une analyse sans concession, où les chiffres parlent, les histoires résonnent, et les destins se croisent, pour comprendre l'inégale marche des nations africaines.
Le 1er août 2025 marquera pour de nombreux pays africains francophones l'anniversaire d'une indépendance dont les promesses semblent parfois lointaines. Un demi-siècle et plus après la fin officielle de la colonisation, le débat sur l'influence persistante des anciennes puissances coloniales fait rage. Si la Grande-Bretagne et la France ont toutes deux laissé une empreinte indélébile, les trajectoires de développement de leurs anciennes colonies révèlent des différences frappantes, soulevant la question d'un "héritage invisible" qui pèserait plus lourd sur le destin de l'Afrique francophone.
La notion des "11 accords secrets" qui auraient lié la France à ses anciennes colonies est devenue une référence quasi mythique pour dénoncer la Françafrique. S'il n'existe pas de document unique et estampillé "secret" portant ce titre, cette liste agrège des dispositions réelles ou des interprétations de clauses figurant dans divers accords de coopération post-indépendance, ainsi que des pratiques établies.
Parmi les plus emblématiques, Le Franc CFA et le contrôle monétaire : C'est le pilier central des critiques. Pendant des décennies, les pays de la Zone Franc CFA ont été contraints de déposer une part significative de leurs réserves de change (jusqu'à 50 à 60%) auprès du Trésor français. Ce mécanisme, présenté comme une garantie de stabilité monétaire, a été largement perçu comme un frein à la souveraineté économique, limitant la capacité des États à mener des politiques monétaires indépendantes et à financer leur développement.
Le droit de premier refus sur les ressources naturelles : Si la clause explicite est difficile à trouver, la réalité économique a longtemps montré une préférence accordée aux entreprises françaises pour l'exploitation des richesses minières, pétrolières ou agricoles.
Les accords de défense et la présence militaire : Les accords post-indépendance ont souvent octroyé à la France le droit de maintenir des bases militaires et d'intervenir militairement, un droit souvent exercé pour soutenir des régimes alliés ou "stabiliser" des situations, mais perçu par certains comme une ingérence dans les affaires intérieures.
La priorité aux entreprises françaises dans les marchés publics : Les réseaux d'influence et les liens historiques ont souvent avantagé les entreprises françaises dans l'obtention de contrats majeurs, parfois au détriment de la compétitivité et du développement de champions nationaux.
Ces points, combinés, dessinent le tableau d'une dépendance structurelle qui aurait entravé l'émergence d'une véritable autonomie économique et politique.
Le contraste anglais : Une "indépendance" plus robuste ?
Comparons cette situation avec celle des anciennes colonies britanniques. Si la Couronne a elle aussi laissé un héritage complexe, la nature de sa décolonisation et des relations post-indépendance présente des différences notables :
Le Royaume-Uni n'a jamais imposé un système de "Sterling CFA" où les réserves de ses anciennes colonies étaient centralisées à Londres. Des pays comme le Nigeria, le Ghana ou la Tanzanie ont, dès leur indépendance, eu le contrôle total de leur monnaie et de leur politique monétaire, leur offrant une plus grande flexibilité pour répondre aux chocs économiques et financer leurs propres projets de développement.
Les anciennes colonies britanniques ont souvent eu plus de latitude pour diversifier leurs partenaires économiques et commerciaux dès l'indépendance. Bien que le Commonwealth ait maintenu des liens, il ne s'est pas accompagné des mêmes contraintes économiques perçues que celles du système de la Françafrique.
Le système juridique britannique (common law), avec son insistance sur la règle de droit et l'indépendance de la justice, a pu, dans certains cas, offrir un cadre plus propice à la bonne gouvernance et à la stabilité institutionnelle, même si des défis majeurs persistent. L'accent mis sur les institutions (parlements, justice) a souvent été plus prégnant que dans le modèle français où l'exécutif est parfois prédominant.
Le Ghana (ancienne Gold Coast britannique) contre la Côte d'Ivoire (ancienne Côte française) : Bien que voisins et dotés de ressources similaires (cacao, or), leurs trajectoires post-indépendance ont différé. Le Ghana, malgré des périodes d'instabilité, a souvent été cité pour ses réformes économiques audacieuses et sa capacité à se redresser, notamment après l'ajustement structurel des années 1980 et 1990. Sa souveraineté monétaire lui a permis de mieux gérer les chocs des matières premières. La Côte d'Ivoire, bien que longtemps considérée comme un "miracle économique" africain, a connu des crises politiques profondes et une dépendance économique forte vis-à-vis de la France, notamment via la gestion de ses filières clés.
Le Nigeria : Géant démographique et économique, le Nigeria a toujours eu une autonomie monétaire totale. Malgré d'immenses défis de gouvernance et de corruption, il a développé une industrie pétrolière et un secteur privé dynamiques, avec une capacité à attirer des investissements diversifiés.
La Tanzanie : Sous Julius Nyerere, la Tanzanie a expérimenté un modèle de développement autonome (Ujamaa) et a toujours maintenu une indépendance farouche vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, y compris en termes de politique étrangère et économique.
Sans tomber dans une généralisation simpliste, les indicateurs de développement tendent à confirmer une disparité. Bien que des exceptions existent des deux côtés, l'Afrique anglophone compte proportionnellement plus de pays ayant atteint un niveau de développement économique supérieur ou une croissance plus soutenue. Ces généralisations doivent être nuancées par les contextes spécifiques de chaque pays, la qualité de la gouvernance locale, les ressources naturelles, etc.
Vers une Nouvelle Ère ?
L'analyse de cet héritage colonial complexe n'est pas une simple récrimination historique, mais une clé de compréhension des défis actuels. La France, consciente de ces critiques, a engagé des réformes, notamment avec la fin du Franc CFA dans sa forme historique et la transformation progressive de ses bases militaires. Cependant, la route vers une égalité de partenariat véritable est encore longue.
Pour les nations africaines, l'enjeu est de transformer cet héritage, de capitaliser sur leurs propres forces, de renforcer leur gouvernance, et de diversifier leurs alliances pour s'affranchir des "chaînes invisibles" du passé. Le développement de l'Afrique ne sera pleinement réalisé que lorsque chaque nation pourra écrire son propre chapitre, sans l'ombre portée des empires d'antan, mais avec la pleine maîtrise de son destin économique, politique et culturel. L'avenir de l'Afrique, qu'elle soit francophone ou anglophone, dépendra de sa capacité à forger une véritable souveraineté.
A. K. Dramé
Journaliste indépendant, analyste et chercheur en Stratégie de Croissance Accélérée, Enjeux et Innovation du Développement Durable
Encadré :
11 accords secrets qui lient la France à ses anciennes colonies
Voici les 11 points souvent cités, avec des nuances et des précisions :
La dette coloniale pour le remboursement des "bénéfices de la colonisation" : L'idée que les pays nouvellement indépendants auraient dû rembourser le coût des infrastructures construites par la France durant la colonisation est souvent avancée. Il s'agit d'une interprétation controversée, car beaucoup estiment que ces infrastructures ont été construites avec des ressources africaines et pour les intérêts coloniaux. Cependant, des mécanismes de financement et des prêts ont pu être mis en place, créant une forme de dépendance.
La confiscation automatique des réserves financières nationales : C'est un point central et très débattu. De nombreux pays de la zone Franc CFA (Franc de la Communauté Financière Africaine, anciennement Franc des Colonies Françaises d'Afrique) étaient (et dans une certaine mesure, certains sont encore) obligés de déposer une part importante de leurs réserves de change (jusqu'à 50% ou plus) auprès du Trésor français. Ce système a été critiqué pour limiter la souveraineté monétaire de ces pays. La réforme de la zone Franc CFA est en cours, avec le remplacement du FCFA par l'Eco dans l'UEMOA, et des évolutions des règles de dépôt des réserves.
Le droit de premier refus sur toutes ressources brutes ou naturelles découvertes : Cela signifie que la France aurait un droit de préemption sur les ressources naturelles (minerais, pétrole, etc.) découvertes dans ces pays. Si cet accord n'existe pas en tant que clause explicite dans tous les traités, la préférence accordée aux entreprises françaises pour l'exploitation de ces ressources est une réalité économique qui s'est souvent manifestée par le passé.
Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres : Cette pratique a longtemps été dénoncée comme un frein au développement des entreprises locales et à la concurrence. Les réseaux d'influence et les liens historiques ont souvent favorisé les entreprises françaises dans l'obtention de contrats.
Droits exclusifs de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires : Les accords de défense post-indépendance ont souvent inclus des clauses de ce type, garantissant à la France un rôle prépondérant dans l'équipement et la formation des armées africaines, ainsi qu'un accès à certaines infrastructures militaires.
Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement : C'est l'un des aspects les plus visibles et les plus controversés des relations franco-africaines. Des accords de défense signés avec plusieurs pays permettent à la France d'intervenir militairement sur leur territoire, souvent à la demande des gouvernements en place, mais parfois aussi pour "défendre ses intérêts".
L'obligation de faire du français la langue officielle et la langue de l'éducation : Si le français est bien la langue officielle et d'enseignement dans de nombreux pays francophones, il s'agit davantage d'un héritage colonial et d'un choix des États que d'une "obligation" contractuelle explicite dans tous les accords. Cependant, la promotion de la langue française et de la culture française a toujours été un axe fort de la politique de coopération.
L'obligation d'utiliser le Franc CFA : Comme mentionné au point 2, le Franc CFA est une monnaie commune à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest (Uémoa) et d'Afrique Centrale (Cemac), dont la parité était garantie par la France. Ce système monétaire est au cœur des critiques sur la souveraineté économique des pays africains. Des réformes sont en cours pour évoluer vers l'Eco et modifier les règles de gestion des réserves.
L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves : Ce point est directement lié au fonctionnement de la zone Franc CFA, où les pays membres devaient effectivement rendre compte de la gestion de leurs réserves et de leurs politiques économiques.
Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France : Des clauses dans certains accords de défense ont pu limiter la capacité des pays africains à nouer des alliances militaires avec d'autres puissances sans l'accord de la France.
L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale : Ce point fait référence aux liens historiques et aux implications des pays africains dans les guerres mondiales aux côtés de la France. Bien que non formalisé par un "accord secret" moderne de ce type, il reflète l'idée d'une solidarité militaire implicite ou explicite dans certaines situations.
A. K. Dramé
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0