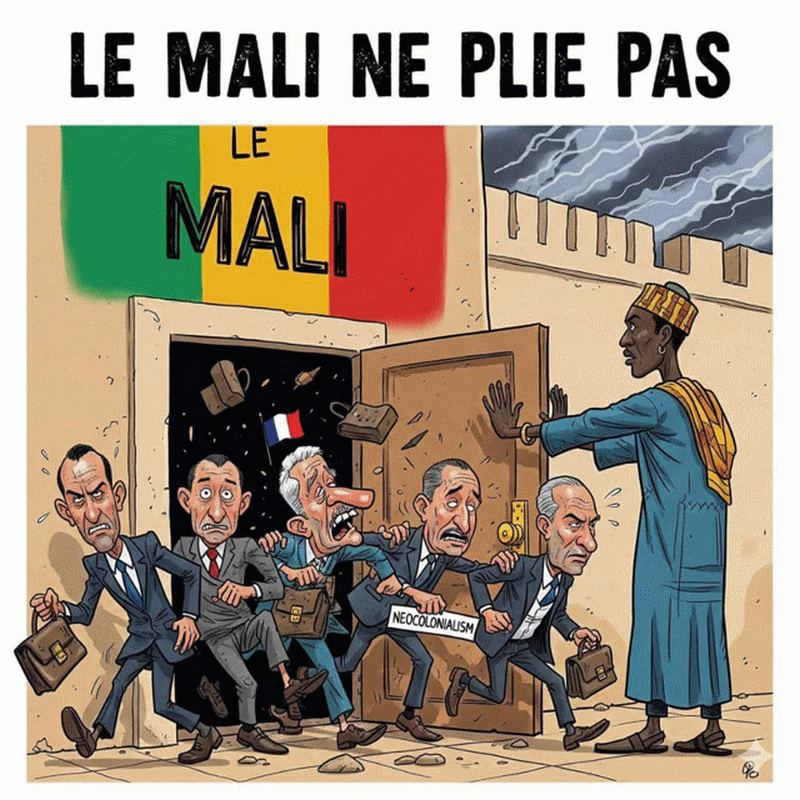Au Sahel, la réorientation des appareils de sécurité a perturbé les trafics criminels
L’Afrique de l’Ouest, déjà marquée par la fragilité institutionnelle et la faiblesse de ses dispositifs de contrôle maritime, s’impose depuis deux décennies comme une zone stratégique pour le narcotrafic mondial.

Depuis les années 2000, la cocaïne en provenance d’Amérique latine a trouvé dans les rivages ouest-africains une route alternative vers l’Europe, échappant aux radars traditionnels de la répression. Si le phénomène n’est pas nouveau, son intensification récente porte la marque d’un nouvel acteur collectif : les groupes criminels issus des Balkans, notamment d’Albanie, du Monténégro et de Serbie.
Selon le rapport de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), ces organisations ont consolidé des bases opérationnelles dans plusieurs États côtiers – Sénégal, Gambie, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Guinée et Cap-Vert –, transformant ces points d’ancrage en hubs de transbordement.
L’inscription durable de ces réseaux dans le paysage criminel ouest-africain révèle à la fois une internationalisation des routes et un redéploiement stratégique : l’Afrique n’est plus seulement une zone de passage, mais un segment intégré de la chaîne logistique du narco trafic vers l’Union européenne.
Face à cette dynamique, l’Union européenne demeure le principal destinataire de la cocaïne transitant par l’Afrique de l’Ouest. Or, les bouleversements politiques récents au Sahel – avec l’effondrement institutionnel relatif au Mali, au Burkina Faso et plus récemment au Niger – viennent perturber les circuits établis du crime transnational.
Le discours dominant, en Europe comme en Afrique, souligne d’abord les effets négatifs de cette militarisation du pouvoir : risques sécuritaires accrus, affaiblissement des États civils, marginalisation des alliances internationales conventionnelles. Pourtant, un paradoxe mérite attention : l’instabilité générée par les juntes militaires fragilise aussi des canaux de trafic qui menaçaient directement la sécurité européenne.
Contrairement à une idée reçue, les narcotrafiquants recherchent avant tout la stabilité et la prévisibilité : un environnement portuaire fluide, des fonctionnaires corruptibles mais prévisibles, une hiérarchie policière claire où l’achat de protection est possible. L’irruption d’appareils militaires au sommet du pouvoir brise cette mécanique huilée, plongeant les réseaux dans l’incertitude et interrompant parfois les accords informels établis depuis longtemps avec les milieux politico-administratifs.
Les pouvoirs du Sahel agissent comme un grain de sable dans la mécanique criminelle transnationale. Les narcotrafiquants sont sérieusement perturbés.
Le Mali et le Niger, bien qu’ils ne soient pas directement des plaques côtières, jouent un rôle de corridors terrestres pour les convois de stupéfiants. Les cargaisons débarquées en Guinée-Bissau ou au Sénégal traversent ensuite ces espaces sahéliens en direction du Maghreb et de la Méditerranée. Les coups d’État successifs et la réorientation des appareils de sécurité ont introduit une imprévisibilité inédite.
Au Mali, les nouvelles autorités ont redéployé priorités et effectifs vers la lutte contre les insurrections internes. Les mécanismes de compromission qui facilitaient autrefois le transit sont désormais brouillés, voire stoppés, par la reconfiguration de l’autorité militaire.
Au Niger, la prise de pouvoir en 2023 a contribué à désorganiser les circuits logistiques du crime, prouvant une fois encore combien les trafiquants dépendent d’une géographie politique stable pour prospérer.
L'arrivée des militaires, agit paradoxalement comme un grain de sable dans la mécanique criminelle transnationale. Là où les narcotrafiquants recherchaient des routes fluides et pérennes, ils trouvent aujourd’hui des goulots d’étranglement, des contrôles erratiques, une imprévisibilité nuisible à leurs cargaisons.
Dans ce contexte, l’Union européenne, souvent critique vis-à-vis des nouveaux pouvoirs sahéliens, a intérêt à nuancer son discours. Certes, les transitions militaires posent de redoutables défis diplomatiques et géopolitiques. Mais du strict point de vue sécuritaire, leur existence introduit une variable favorable : la désarticulation de réseaux criminels Balkans–Afrique de l’Ouest.
L’UE, grande consommatrice de cocaïne et confrontée à une hausse de la pénétration de drogues sur son espace intérieur, voit mécaniquement sa vulnérabilité réduite. Chaque retard, chaque détour, chaque perte financière imposée aux organisations criminelles compromet leurs marges et affaiblit leur capacité d’expansion. Dans la realpolitik sécuritaire, les militaires sahéliens rendent involontairement un service à l’Europe, en perturbant une chaîne logistique dont Bruxelles et les capitales européennes peinent à endiguer l’ampleur.
Faut-il pour autant souhaiter la perpétuation des régimes militaires pour affaiblir les routes de la cocaïne ? Poser ainsi la question révèle l’ambivalence morale et politique. Une Europe qui se féliciterait explicitement du verrouillage incertain introduit par les militaires donnerait prise à une accusation de cynisme. De plus, l’effet reste conjoncturel : les trafiquants, adaptatifs par nature, repèrent déjà d’autres trajectoires, notamment via le Golfe de Guinée et en direction de l’Afrique du Nord-Est.
Il serait donc illusoire de croire que la seule instabilité politique suffit à enrayer durablement le commerce de cocaïne. Mais sur la temporalité immédiate, la désorganisation imposée au Sahel réduit la fluidité des flux et contribue, factuellement, à une baisse des volumes qui atteignent les ports européens.
L’Afrique de l’Ouest reste un théâtre où s’entrecroisent vulnérabilités institutionnelles et ambitions criminelles mondiales. L’ancrage de groupes venus des Balkans illustre combien le continent est intégralement intégré à la géopolitique du crime globalisé. Mais l’irruption des militaires au Mali et au Niger, tout en posant d’immenses défis en matière de gouvernance, a débouché sur un effet paradoxal : la fragilisation des routes de la cocaïne vers l’Europe.
L’Union européenne aurait tort de ne voir dans ces transformations qu’un facteur négatif. Tout en maintenant une ligne de principe attachée au rétablissement d’autorités civiles, elle gagnerait à reconnaître que l’instabilité sahélienne lui offre, à brève échéance, un ralentissement du flux de stupéfiants.
Une lucidité stratégique – consistant à anticiper les recompositions, développer une coopération accrue avec les pays côtiers, et exploiter la fenêtre d’opportunité créée par la désorganisation actuelle du crime transnational –s’impose désormais.
En d’autres termes, dans une région où les équilibres se redessinent brutalement, il est permis à l’Europe de se réjouir silencieusement : la militarisation politique du Sahel, en perturbant les circuits criminels, offre une respiration inattendue à ses propres dispositifs de sécurité.
Oussouf Diagola
La chronique des relations internationales et de la geopolitique du sahel, la feuille n° 67 du 15 sept. 2025 contact nabara@gmail.com
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0