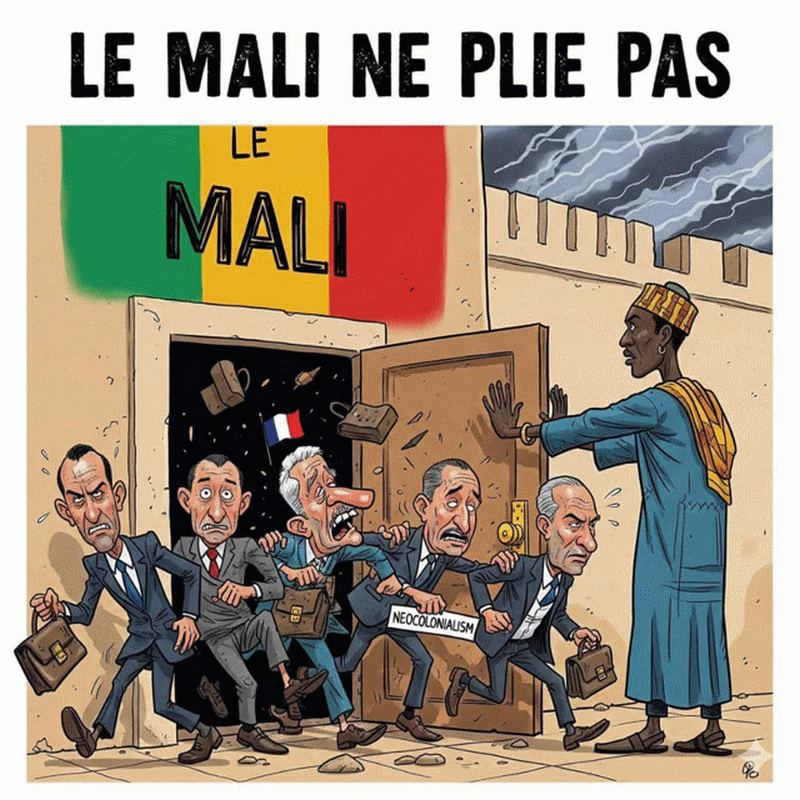Goongan Ta : Le Mali au cœur de la désinformation
Dans les conflits contemporains, l'arme la plus redoutable n'est plus seulement le fusil ou le missile, mais bien la manipulation de l'information.

Aux champs de bataille traditionnels s'ajoute désormais un autre théâtre, tout aussi décisif : celui des esprits. La guerre ne se joue plus uniquement sur les terrains sablonneux du Sahel, elle se mène aussi dans l'espace médiatique, dans les imaginaires collectifs et sur les réseaux sociaux où circulent rumeurs, infox et récits orientés.
Au Mali, la guerre asymétrique conduite par les groupes djihadistes illustre parfaitement cette réalité. Conscients de la faiblesse relative de leurs moyens militaires face à l'armée régulière, les forces du mal misent sur la communication et la désinformation pour décupler leur influence. Leur véritable objectif n'est pas tant de remporter des batailles militaires que de gagner la bataille de l'opinion. Ils cherchent à installer la peur, à entretenir l'impression d'une menace omniprésente, à donner l'illusion d'une défaite là où il n'y en a pas. C'est dans cet espace d'incertitude et de manipulation que s'opère une grande part de leur puissance.
Les attaques coordonnées du 1er juillet 2025 et de début septembre dernier en sont une illustration emblématique. Ces jours-là, plusieurs localités de l'ouest malien : Diboli, Sandaré, Nioro, Gogui, Kayes, mais aussi du centre, à Niono et Molodo, furent frappées simultanément. Des postes de police et de douane visés, des véhicules incendiés, des casernes brièvement attaquées par les combattants du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), dirigé par Iyad Ag Ghali. Mais au-delà des faits militaires, c'est surtout leur mise en récit qui interpelle.
Certains médias et relais d'opinion ont présenté ces villes comme "proches de la frontière sénégalaise", alors que plusieurs d'entre elles se trouvent à plus de 700, voire 1000 kilomètres de Dakar. Cette approximation n'a rien d'innocent. Elle oriente la perception des événements, façonne une réalité géopolitique fictive et nourrit un climat de panique. La ville de Nioro du Sahel, par exemple, a été décrite comme assiégée, plongée dans un blocus total, alors même que les fêtes religieuses du Maouloud et de l'Ism s'y sont déroulées normalement, rassemblant des milliers de pèlerins venus de tout le Mali et des pays voisins.
L'écart entre les faits vécus sur le terrain et les récits relayés par certains commentateurs illustre la mécanique perverse de la désinformation : transformer des inquiétudes légitimes en prophéties apocalyptiques.
Comparer Nioro à Farabougou, comme le font certains pseudo-analystes, relève d'un contresens historique et sociologique. Ni la démographie, ni l'espace géographique, ni le degré de sécurisation ne sont comparables. Nioro, cité religieuse sanctuarisée, reste sous le contrôle de l'État et vit ses grands rassemblements religieux en toute normalité. Assimiler les deux n'est pas seulement une erreur : c'est une manière d'alimenter les fantasmes, d'exagérer la menace et de légitimer indirectement la terreur en lui donnant une résonance qu'elle n'a pas.
Par ailleurs, la question mérite d'être posée : pourquoi associer artificiellement Niono ou Molodo, situés au cœur du delta intérieur du Niger, à une prétendue zone frontalière sénégalaise ? Pourquoi insister sur une menace qui se rapprocherait du Sénégal ? Ces coïncidences ne sont pas fortuites. Elles traduisent une stratégie de communication où la géographie sert de prétexte pour dramatiser la situation et légitimer de nouvelles ingérences. En manipulant les cartes, on manipule aussi les esprits.
La mécanique de la désinformation est toujours la même : amplifier, déformer ou inventer. Dans ce cas précis, l'amalgame spatial suggère que l'instabilité malienne s'étend au Sénégal, créant une psychose transfrontalière. Ailleurs, ce sont les bilans des pertes militaires qui sont grossis, falsifiés ou purement inventés. Des garnisons entières sont déclarées "tombées" alors qu'elles résistent. Des dizaines de soldats sont annoncés "morts" alors qu'ils continuent le combat. Chaque fake news agit comme une balle invisible : elle ne vise pas les corps, mais les consciences. Elle fragilise la confiance entre populations et institutions, instille le doute dans l'opinion, érode la cohésion nationale et sape le moral des troupes.
Cette "guerre invisible" est redoutable parce qu'elle exploite nos émotions et notre besoin de comprendre. Un récit choquant, même faux, circule plus vite qu'un démenti rigoureux. Une carte mal dessinée reliant artificiellement Niono au Sénégal marque plus durablement l'imaginaire collectif qu'une rectification publiée après coup. Le sensationnalisme devient ainsi une arme asymétrique : il coûte peu aux agresseurs, mais ses effets psychologiques sont immenses.
Face à une telle menace, la riposte ne peut se limiter à l'action militaire. Elle doit s'appuyer sur l'intelligence collective et la vigilance citoyenne. Chacun doit cultiver l'esprit critique, apprendre à distinguer le vrai du faux et refuser de relayer des rumeurs infondées.
Les médias, pour leur part, portent une responsabilité majeure : éviter le piège du spectaculaire, vérifier scrupuleusement leurs sources, replacer les faits dans leur contexte exact, qu'il soit géographique, historique ou politique. Sans cette rigueur, ils deviennent, volontairement ou non, les complices de ceux qui veulent déstabiliser le pays.
Car derrière chaque manipulation se dessine une finalité claire : affaiblir le Mali, miner la confiance en ses Forces armées (FAMa), et imposer l'image d'un État en échec pour justifier à terme une nouvelle tutelle ou une intervention extérieure. Mais cette stratégie ne réussit que si les citoyens y adhèrent passivement. Or, l'histoire du Mali démontre que, lorsqu'elles sont unies et lucides, les populations savent déjouer les pièges de la propagande.
La guerre asymétrique que mènent les djihadistes est donc aussi une guerre de l'information. Pour y résister, il ne suffit pas de défendre nos frontières : il faut également protéger nos esprits.
L'union sacrée autour de la vérité, la vigilance citoyenne et l'éducation critique aux médias constituent nos meilleures armes pour préserver la cohésion nationale et défendre la souveraineté du Mali contre cette offensive invisible.
DICKO Seydina Oumar
Journaliste- Historien- Écrivain
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0