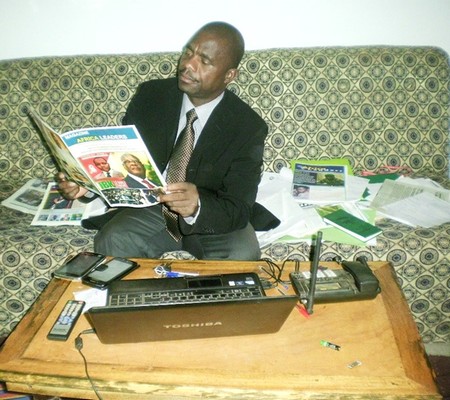La Démocratie, une valeur transculturelle : Réflexions pour une pédagogie civique contemporaine
En mémoire du Professeur Assoi ADIKO, historien émérite, disparu le 08 Juillet 1997

La démocratie, souvent perçue comme une construction politique occidentale, s’inscrit en réalité dans une longue histoire de pratiques collectives et de régulations sociales partagées à travers les cultures.
Elle constitue aujourd’hui bien plus qu’un système politique : c’est un mode de vie, un idéal de coexistence fondé sur le respect mutuel, la responsabilité citoyenne et l’autodiscipline.
Dans un espace sahélien fracturé par les conflits, les replis identitaires et les dérives autoritaires, la démocratie semble à la fois affaiblie et mésinterprétée.
Trop souvent réduite à des procédures électorales ou instrumentalisée à des fins de légitimation, elle perd de sa portée émancipatrice. Or, loin d’être une importation exogène, la démocratie possède des ancrages anciens dans les cultures africaines.
Sa redécouverte, son enracinement et sa transmission aux jeunes générations deviennent donc une tâche fondamentale, à la fois politique, pédagogique et morale.
Cet article propose une lecture transculturelle de la démocratie et plaide pour une pédagogie civique renouvelée, destinée à la jeunesse africaine, tant sur le plan théorique que pratique.
1. La démocratie, un concept à réhabiliter de son identité africaine
Le terme « démocratie », du grec « dêmos » (peuple) et « kratos » (pouvoir), n’est pas récent, il remonte à la Grèce antique. Toutefois, la notion qu’il véhicule est beaucoup plus vieille ; elle existe depuis que les humains se sont regroupés en sociétés.
Au fil du temps, des gouvernements ont parfois réduit son importance ou l'ont complètement supprimée.
Dans les sociétés africaines traditionnelles, des formes d’organisation politique ancestrales ont incarné des pratiques démocratiques.
Ainsi, le dialogue au sein des conseils de clans, les assemblées villageoises, les processus de décision par tirage au sort ou par consensus constituent-ils des exemples concrets de gouvernance participative bien avant la colonisation.
Dire que la démocratie serait étrangère à l’Afrique relève donc d’un préjugé colonial et d’une essentialisation électoraliste. La gouvernance par la discussion et la recherche du consensus, bien que parfois hiérarchisée, existait dans les sociétés segmentaires ou lignagères du continent.
La modernité démocratique en Afrique comme ailleurs est donc autant héritée que reconstruite.
Pour mieux comprendre ce qu’est la démocratie, il est nécessaire de distinguer ce qui ne relève pas de cette notion.
La démocratie est en opposition avec certaines idées politiques, qui sont des formes concurrentes de pouvoir :
la monarchie, un système dirigé par un seul individu ; ce type de pouvoir est héréditaire et souvent justifié par un droit divin ;
la tyrannie, l'utilisation de la force pour diriger et contrôler ;
l'oligarchie, le pouvoir réservé à quelques grandes familles ;
la ploutocratie, un gouvernement dirigé par les riches ;
l'aristocratie, le pouvoir confié aux nobles ;
tandis que la gérontocratie, plus vécue en Afrique, est un système où les anciens gouvernent du fait de leur expérience. Dans nos sociétés, on accorde beaucoup d'importance à l'âge, ce qui est judicieux : les diplômes ne sont pas tout. Même quelqu'un avec une intelligence moyenne, ayant beaucoup observé, a sans doute beaucoup appris et possède de l'expérience. Le respect que nous portons aux aînés repose sur leur vécu.
Alors, qu'est-ce que la démocratie ? Elle se présente comme un idéal de liberté qui valorise les droits de chacun et remplace l’autorité traditionnelle par le consentement du peuple.
C'est pourquoi on dit souvent que la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. De ce fait, nous revenons à une nouvelle idée, une nouvelle vision du monde qui donne une place prépondérante à chaque individu.
Les types de démocratie développés depuis l'époque de la Grèce et de Rome ont été modernisés au 18ème siècle, par d'importants penseurs, qu'on pourrait en réalité qualifier de sociologues, tels que Montesquieu et Jean-Jacques ROUSSEAU.
En effet, Rousseau est reconnu comme le fondateur des démocraties contemporaines. Dans son ouvrage intitulé « Le contrat social », il soutient que chaque personne doit participer à sa propre gouvernance ; en d'autres termes, le pouvoir d'un État ou d'une nation doit appartenir au peuple.
2. Le fondement philosophique de la démocratie : raison partagée et égalité civique
La montée des révolutions, initiée par des penseurs français et marquée principalement en 1789, a modifié de manière fondamentale cette idée politique, la transformant d'une simple pensée à une conception de civilisation.
En examinant la perception contemporaine de la démocratie, il devient essentiel de se référer à René DESCARTES, qui déclare que « la raison est la chose la mieux partagée du monde ». Ce bon sens partagé constitue la base fondamentale de la démocratie.
Lorsque tout le monde a accès à la raison, aucune personne ne devrait posséder le pouvoir uniquement pour elle-même. Étant donné que le bon sens est présent en chacun de nous, cela nous permet de saisir l'ampleur universelle de la démocratie.
Le suffrage universel ne représente-t-il pas le principal pilier de la démocratie ? Cela découle justement du bon sens que nous avons tous. Si chacun d'entre nous détient un brin de bon sens, alors chacun de nous a aussi une petite part de pouvoir. Donc, nous pouvons conclure qu’une voix équivaut à une autre. Voici le premier principe de la démocratie et son aspect universel.
Le second principe que nous pouvons considérer, et qui serve également de fondation à la démocratie, est que le pouvoir et la politique impliquent tout le monde. La politique doit être jugée par tous les citoyens.
Cet engagement se présente sous deux formes : des droits et des obligations. Prenons l’exemple d’un patient visitant un hôpital pour recevoir des soins. A-t-il un droit ? Remplit-il une obligation ? C’est en effet les deux. L’État se doit d’améliorer la santé des citoyens qui contribuent à sa propre existence, ce qui constitue un droit pour ceux-ci. En même temps, le citoyen, pour jouer son rôle dans la société et prévenir de contagions à autrui, a l’impérieuse obligation de se soigner. Cela s’applique également à la démocratie, qui englobe un aspect de “devoir” ainsi qu’un aspect de “droit”.
De plus, il est évident que les choix politiques ne requièrent aucune formation spécifique, aucune spécialité, et cela constitue le troisième principe, établissant la démocratie comme un idéal d’égalité et de liberté pour tous.
3.La démocratie comme une culture et non comme un dogme institutionnel
On confond souvent démocratie et institutions démocratiques. Or la démocratie est d’abord une culture, un rapport au pouvoir, au collectif, à l’altérité qui s’ajuste aux circonstances particulières de chaque pays.
Elle peut prendre des formes variées : directe, représentative, participative. Elle peut s’exercer dans des contextes républicains comme monarchiques, à condition que le consentement populaire soit réel et que les libertés soient garanties.
Prenez par exemple l’Europe Occidentale. Les républiques s’inspirent de la démocratie (France) autant que les monarchies constitutionnelles (Angleterre). Cela implique que, bien que la démocratie soit une idée, une valeur concrète, son application ne peut pas être uniforme : il existe d’ailleurs différentes méthodes de représentation (directe et indirecte).
Pensez un moment à 22 000 000 de personnes dans un parlement, en train de discuter de l'avenir du Mali. Nous aurions eu une représentation très importante, c'est vrai, mais quel grand chaos en résulterait. C’est pour cette raison que le peuple laisse librement ses pouvoirs à des représentants. En fait, vous devez bien faire la différence entre les réactions d'une foule et celles d'un groupe bien organisé.
Ainsi, la démocratie, en tant que concept politique, touche-t-elle les individus et devient une idée qui inclut des aspects politiques, sociaux et économiques.
La civilisation moderne, qui évolue dans le monde actuel, se manifeste pour les individus sous la forme de libertés, souvent appelées libertés fondamentales. Ces libertés englobent la liberté de circulation, la liberté de pensée et de croyance religieuse, ainsi que la liberté d’exprimer ses idées, tant à l’oral qu’à l’écrit. A cela s’ajoute la liberté d’association, qui représente des avancées majeures offertes par la démocratie aux citoyens.
Dans cet espace, il est essentiel de noter que la démocratie authentique ne fixe aucune limite ou restriction à l’exercice des libertés fondamentales, sauf celles nécessaires pour respecter la liberté des autres. Aucune restriction ne devrait exister, sauf si notre liberté empiète sur celle des autres ou menace le bien commun. C’est précisément parce que la démocratie repose sur l’égalité de tous que des limites sont acceptables : la loi s’applique à tous de manière égale. Si la liberté était seulement le droit d’agir comme on le souhaite, alors la société deviendrait un véritable désordre où la force du plus fort prévaut toujours.
Cependant, les libertés individuelles n’auraient pas de signification si elles ne s’étendaient pas au groupe et à la communauté. La liberté serait incomplète si la collectivité n’en profitait pas.
La démocratie et l’idéal de liberté se manifestent d’abord chez les individus, puis se dévoilent au sein des collectivités. Il faut donc tenir compte des dynamiques communautaires, des logiques coutumières, sans céder aux tentations autoritaires souvent justifiées par la tradition négative.
Il est vrai que transmettre des idées aussi théoriques à des jeunes est un défi. Pour enseigner la démocratie de manière efficace aux jeunes, il serait peut-être nécessaire de repenser cette notion.
4. Enseigner la démocratie aux jeunes : un impératif pédagogique
Comment transmettre la démocratie à la jeunesse ? il faut nécessairement déconstruire l’idée que la liberté signifie faire ce que l’on veut.
Éduquer à la démocratie doit être reconnue comme une instruction civique qui cherche à prouver que liberté et discipline sont étroitement liées. La liberté est indissociable de la règle. Cette idée peut sembler choquante, mais cette position paradoxale pourrait susciter des réactions chez les jeunes. Si vous présentez la démocratie aux jeunes comme étant la même chose que la liberté, qui est en réalité liée à la discipline, vous attirerez leur attention avant de vous engager dans une analyse. La vie en société serait-elle possible sans discipline pour protéger la liberté de chacun ?
Il existe de nombreux exemples pour prouver aux jeunes que liberté ne signifie pas simplement faire ce qu'ils veulent. Ainsi, la liberté, envisagée comme une qualité humaine, une valeur essentielle, nécessite des repères, impose des limites et doit être orientée pour le bien de la communauté.
L'expérience des libertés fondamentales et des libertés individuelles ne prend véritablement forme que lorsque l’on fait partie d’un groupe, d’une collectivité.
La discipline apparaît donc comme un moyen d'aider chacun à tirer pleinement parti de sa liberté. En tant qu'individu vulnérable dans la société, on s'appuie sur la discipline – c'est-à-dire sur la loi qui assure sa protection – pour jouir de sa liberté.
Lorsque l'on enseigne la démocratie à de jeunes personnes, il devient compliqué de gérer leurs réactions si la discipline n'est pas considérée. Cette discipline vise à montrer aux jeunes que « l'art naît de contrainte, vit de lutte et meurt de liberté », comme le souligne à juste titre André GIDE.
Parler de démocratie devant des jeunes en la qualifiant de principe de liberté totale, c'est négliger la pédagogie. Les jeunes doivent vivre en groupe et, par conséquent, ils doivent respecter non seulement une bonne discipline, mais aussi pratiquer l'autodiscipline.
Il est nécessaire de faire émerger chez les jeunes leur valeur individuelle tout en leur permettant de prendre conscience que cette valeur individuelle doit respecter la valeur collective et l'intérêt général.
La démocratie, représentant un type de civilisation centrée sur la liberté tout en s'opposant à l'anarchie, nous renvoie encore une fois à la notion de discipline.
Les aînés ont une compréhension et un jugement que les jeunes n'ont pas encore atteint. Ce que les jeunes détiennent, et peut-être même plus qu’eux, c'est un sens aigu de la justice ; ils semblent plus justes que les aînés, car ils sont peut-être plus innocents.
Les jeunes, à l'instar des adultes, évoluent dans un monde qui se rapporte constamment à la liberté. Ils doivent être sensibilisés à ce concept universel. Et quand nous parlons, nous devons être aussi capables de nous taire et écouter.
Dans l'enseignement de la démocratie aux jeunes à travers une formation civique, il est essentiel de pouvoir montrer que les droits vont de pair avec les devoirs. Former des citoyens, ce n’est pas former des consommateurs de droits, mais des acteurs du vivre-ensemble.
Redonner sens à la démocratie, ce n’est pas seulement organiser des élections, mais réconcilier les individus avec leur puissance d’agir collective. C’est former des jeunes conscients que la liberté ne se reçoit pas, elle se conquiert et se protège, chaque jour, par la parole, le vote éclairé, la solidarité et le respect mutuel.
Par Dr Mahamadou KONATE,
Bamako, le 08 juillet 2025
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0