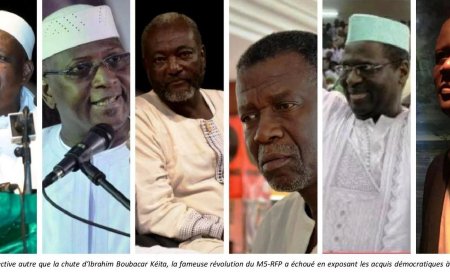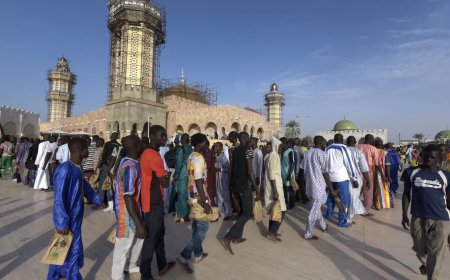L’insoluble équation de la durée des transitions politiques : TR + LD = TY + AN
Une République se cristallise dans sa Constitution, qui incarne son régime politique et définit les règles de son fonctionnement quotidien. Lorsqu’une crise imprévue la frappe, l’obligeant à changer, même temporairement, de régime politique, la raison commande à cette République d’adopter de nouvelles règles de survie pour s’adapter à ces circonstances exceptionnelles.

Au Mali, à la suite de l’insurrection populaire d’août 2020, une décision cruciale fut prise : au lieu de suspendre la Constitution et de confier les pleins pouvoirs à un Régisseur national, il fut décidé de maintenir les normes ordinaires de gouvernance tout en instaurant des autorités spéciales chargées de gérer cette situation exceptionnelle.
Cette approche stratégique a engendré une situation complexe et inextricable.
Le premier des trois organes de gouvernance, pour agir efficacement et prendre des décisions idoines en période d’urgence, s’est vu contraint de marginaliser les autres instances et de dépasser le cadre légal en vigueur.
Les actions de cet organe furent d’abord accueillies avec enthousiasme, dans un élan de soulagement et de joie générale. Mais, par la suite, il fut exigé, avec discernement et justice, qu'on rende des comptes pour les atteintes aux droits des citoyens, injustement bafoués en violation des lois souveraines.
Ces violations concernaient non seulement l’ancienne Constitution maintenue, mais aussi la Charte de la Transition adoptée, ainsi qu’une nouvelle Constitution votée par la suite.
En réalité, une telle critique n’aurait probablement pas été formulée contre un Président-Régisseur investi des pleins pouvoirs, qui aurait eu la légitimité de prendre des décisions audacieuses dans un cadre exceptionnel. À Rome, ce genre de Régisseur national prenait le titre de dictateur.
Malgré cette situation délicate, l’éloquence persuasive du vieux Méron, premier des vizirs, domina tous les débats. Sa préoccupation semblait davantage centrée sur sa gloire personnelle et l’héritage qu’il souhaitait laisser, plutôt que sur le bien-être et l’avenir du Mali.
Il ne cherchait pas véritablement à identifier le moyen le plus légitime et sûr de sortir l’État malien de cette impasse complexe. Au contraire, Méron s’efforçait de s’approprier tous les honneurs de cette entreprise audacieuse de sauvetage du régime, même au prix d’un coût dissuasif pour la nation.
Ainsi fut-il, pendant un temps, justement célébré comme le théoricien triomphant du « libérateur », mais aussi, à juste titre, critiqué comme celui qui plongea davantage le pays dans un piège obscur et comme l’un des co-responsables de violations des lois établies.
Il est d’une importance capitale que, quelle que soit la manière dont le mandat d’une transition politique est conféré, sa durée soit strictement limitée à un terme très court, non prorogeable, à l’image de la dictature romaine d’antan.
Comme l’ont écrit nos historiens, dans des situations de crise nécessitant une telle transition, un État se trouve rapidement dans une position binaire : « il est détruit ou il est sauvé ». Une fois l’urgence passée, une transition prolongée, tout comme une dictature mal encadrée, peut aisément devenir « tyrannique ou inutile ».
À Rome, le mandat des dictateurs était limité à six mois, et la plupart d’entre eux choisissaient d’abdiquer avant même l’expiration de ce délai. Comme le souligne Rousseau dans Le Contrat social, si ce terme avait été prolongé, les dictateurs auraient pu être tentés de l’étendre davantage pour consolider leur emprise, comme l’ont souvent fait les transitions politiques en Afrique, prolongées sur un an ou plus.
À l'époque, le dictateur disposait uniquement du temps nécessaire — ces six mois — pour répondre à l’urgence ayant justifié son élection, sans latitude pour des projets d’envergure à long terme.
C’est précisément cette rigueur qui permit à cette institution de préserver l’État pendant des siècles.
Au regard des expériences africaines, les futures constitutions devraient concevoir la transition politique comme une catégorie spécifique de période d’exception, régie avec rigueur et célérité, afin que l’État retrouve rapidement son fonctionnement normal et corrige les failles structurelles révélées par la crise.
Le cadre de cette transition pourrait reposer sur les principes suivants :
• Un mandat strictement limité à 9 mois, non renouvelable ;
• La réunion des conditions nécessaires pour organiser des élections anticipées, permettant à l’État de se doter d’autorités légitimes ;
• La formation d’une équipe dirigeante de transition, composée d’un président et d’un gouvernement, non reconductible ni éligible à la fin du mandat ;
• Une gouvernance par ordonnances pour assurer une gestion efficace et rapide.
Une telle précaution pourrait même servir de garde-fou contre tout projet de suspension constitutionnelle ou institutionnelle. Dans une telle éventualité, les institutions encombrantes seraient systématiquement mises en veille, jusqu’au rétablissement d’une normalité permettant à la République de fonctionner à nouveau pleinement
Dr. Mahamadou KONATÉ. Analyste politique
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0