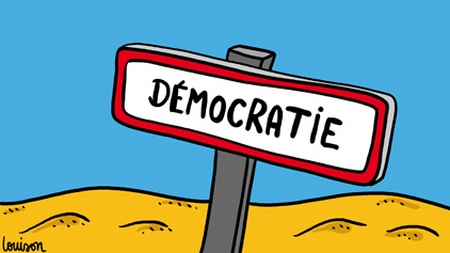Interrogations sur l’objectivité intellectuelle : cas de Choguel
Du 5 au 22 juillet 2025, deux anciens ministres, Mohamed Salikènè COULIBALY et Choguel Kokalla MAÏGA, ont exprimé dans les médias des analyses critiques à l’égard de Modibo KEÏTA et de son héritage.

Tout a commencé le 4 juin 2025, lorsque Choguel Kokala MAÏGA a publié un texte intitulé « Contribution à la compréhension de certaines pages de l’histoire post-indépendance du Mali : Mise au point à propos des interventions et polémiques sur la mémoire de feu Président Modibo KEÏTA, sur les FAMa et sur le processus démocratique au Mali ». Dans ce texte, il a analysé en partie les faiblesses du président KEÏTA et les lacunes de sa gestion.
En réponse, le 5 juillet 2025, M. COULIBALY a publié un texte intitulé « Réplique à Choguel pour la manifestation de la vérité », dans lequel il conteste plusieurs affirmations de M. MAÏGA sur le père de la Nation, les qualifiant de tendancieuses. M. MAÏGA a réagi le 22 juillet avec un titre provocateur : « De la mythification de Modibo KEÏTA à la falsification d’un pan de l’histoire du Mali contemporain : cas Mohamed Salikènè COULIBALY ».
Sans m’engager dans un débat long et compliqué entre ces deux personnes, avec leurs textes dépassant chacun une dizaine de pages, je souhaite, en tant que jeune citoyen soucieux de vérité, signaler quelques incohérences qui interpellent, chacun des protagonistes affirmant agir pour notre bien.
1. Les incohérences dans la réponse du 22 juillet 2025
1.1. Critiques méthodologiques et stylistiques. Dans le quatrième paragraphe de son texte, M. MAÏGA reproche à son adversaire des écarts de méthode et de style scientifique.
Concernant la méthode, il déplore l’utilisation par M. COULIBALY d’expressions jugées peu appropriées à une démarche scientifique, indiquant qu'elles lui font dire des choses qu'il n'a pas dites, comme « la tentation partisane », « des sous-entendus » ou « des formulations imprécises ».
Pourtant, dans le même article, M. MAÏGA recourt à des suppositions et jugements similaires envers son critique. Par exemple, il l’accuse de vouloir mythifier et falsifier l’histoire (comme indiqué dans le titre et la conclusion ; n’est-ce pas un procès d’intention ?), de mentir (par. 13 ; mentir implique une intention), de faire « de longues digressions » et de « privilégier le subjectif » sur le réel (par. 12), de ne pas savoir différencier un parti d’inspiration marxiste-léniniste d’un parti marxiste-léniniste (par. 9 ; comment le sait-il, n’ayant jamais posé la question ?), et d’afficher une « notable insuffisance de connaissances sur la vie de l’US-RDA » (par. 8 ; cela ne rappelle-t-il pas les « formulations imprécises » reprochées à COULIBALY ?).
Concernant le style, M. MAÏGA dénonce chez son contradicteur un manque de « modestie », affirmant que celui-ci se « pare du manteau de celui qui détient la vérité », à travers des expressions pompeuses.
Or, lui-même adopte un ton condescendant avec des expressions comme « d’une remise à niveau dont certains ont besoin ou, pis, le retour pur et simple sur les bancs pour apprendre » (par. 8), « sur des sujets que vous êtes loin de maîtriser » (par. 10), « poursuivez votre documentation avec la lecture des passages consacrés aux sujets » (par. 10), et bien d’autres dans sa tribune initiale du 4 juin où, notamment, il prétend que sa réplique est « toujours basée sur la vérité », reposant sur « des vérités irréfutables », et qu’il poursuit « le rétablissement de certaines vérités que la jeunesse doit connaître ». Pourtant, lorsque M. COULIBALY propose des rectificatifs, M. MAÏGA s’en offusque.
1.2. L’image de Modibo KEÏTA
Dans le sixième paragraphe, M. MAÏGA se défend d’avoir donné de Modibo KEÏTA une image de dictateur, tout en reconnaissant avoir dit qu’il y avait « concentration du pouvoir entre ses mains », qu’il « aimait le pouvoir », et que « peut-être » il en était même « avide ».
Or, tout dictionnaire français, qu’il soit général ou spécialisé, indique que ces traits caractérisent l’image d’un dictateur. C’est précisément ce qui lui a été reproché : non pas d’avoir appelé Modibo « dictateur », mais d’avoir construit cette image.
2. La querelle de terminologie dans la réponse du 22 juillet 2025
2.1. Le terme « clivant »
Dans le cinquième paragraphe, M. MAÏGA tente de donner une interprétation objective du terme « clivant », s’en revendiquant plutôt que de s’en lamenter. Il définit le clivage comme une forme de séparation ou de division. Pour convaincre, il évoque l’histoire politique du pays, depuis la création de l’US-RDA, où les partis politiques se forment, se divisent et se recomposent selon les conflits entre leurs membres. Ainsi, être clivant serait, selon lui, inévitable pour tout homme politique, surtout s’il se dit démocrate.
Cependant, à y regarder de près, le mot n’est pas utilisé dans ce sens littéral. La signification d’un mot dépend aussi de son contexte, de son usage social et culturel. Outre la définition du dictionnaire Larousse, qui décrit « clivant » comme désignant « quelqu’un ou quelque chose qui divise profondément l’opinion », nuançant ainsi la définition de M. MAÏGA, il faut considérer la connotation que lui attribue le monde politique malien : celle d’une personne adoptant des positions exclusives, privilégiant des sujets qui divisent fortement les citoyens.
Être un rassembleur n’a jamais signifié « rassembler tout le monde », comme le suppose M. MAÏGA. On considère comme rassembleur un homme politique qui cherche à unir un maximum de personnes par un discours inclusif, harmonisant les opinions sur des enjeux majeurs, tout en évitant les sujets profondément clivant et en privilégiant un ton non agressif.
2.2. Défense partisane
En lisant les textes de M. MAÏGA et de M. COULIBALY, on constate que leurs écarts méthodologiques les font apparaître comme des défenseurs de camps opposés, l’un soutenant Moussa TRAORÉ, l’autre Modibo KEÏTA. Bien qu’ils reconnaissent tous deux que leurs figures admirées ont des qualités et des défauts, leur défense prend parfois le pas sur l’analyse rationnelle.
Néanmoins, leur engagement est indéniable pour éclairer un aspect significatif de notre histoire, à savoir la gouvernance de la première République.
Nous, jeunes, aurions davantage appris si ce dialogue s’était poursuivi dans un respect mutuel, sans condescendance, compte tenu de l’étendue de la culture des deux protagonistes. À partir de leur confrontation documentée, les historiens maliens pourraient sortir de leur apathie, et la jeunesse renforcer ses connaissances pour relever les défis du futur.
Il est inacceptable, j'en conviens, au nom de la vérité historique, de dissimuler les qualités ou les défauts d’un grand leader politique, ou de les déformer uniquement pour « endoctriner et manipuler la jeunesse malienne, dans le but d’atteindre des objectifs politiques inavoués qui ne servent pas les Maliens ». Cela concerne des personnalités comme Mamadou KONATÉ, Fily Dabo SISSOKO, Modibo KEÏTA, Moussa TRAORÉ, Alpha O. KONARÉ, et Amadou T. TOURÉ, pour n’en nommer que quelques-unes.
Par Dr Mahamadou KONATÉ
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0