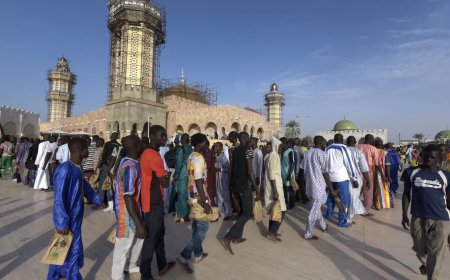La CPI dans le collimateur des USA : L’indépendance de la Justice internationale encore écornée
Un nouvel épisode s’ajoute au chapitre déjà long du bras de fer entre la Cour pénale internationale (CPI) et les États-Unis d’Amérique, mais aussi certains de leurs plus proches alliés dont Israël. Ce qui relance encore une fois la faisabilité même de l’existence pleine et entière d’une juridiction supranationale qui mettrait tous les justiciables du monde au même pied d’égalité.

La semaine dernière, le secrétaire d’État américain, Marco Rubio, a annoncé des sanctions à l’encontre de deux juges de la CPI. Il s’agit de la Canadienne Kimberly Prost et du Français Nicolas Guillou. Les procureurs adjoints Nazhat Shameem Khan des îles Fidji et le Sénégalais Mame Mandiaye Niang sont aussi visés par ces mesures pour leur action visant, dit-il, à « enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des États-Unis ou d’Israël, sans le consentement de l’une ou l’autre de ces nations ». Dans la foulée, cette annonce a été saluée par le Premier ministre Benyamin Netanyahou, lui-même visé par un mandat d’arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans la bande de Gaza.
Pour les détracteurs de la Cour, il s’agit d’une preuve supplémentaire que l’idéal d’une justice pénale universelle n’est autre qu’une utopie. En revanche, ceux qui veulent bien croire en cet idéal voient dans les mesures de l’administration américaine une forme d’aveu de culpabilité. Si l’on n’a rien à se reprocher, l’on n’use pas de sa position de force pour s’octroyer une quelconque immunité sous couvert de souveraineté.
Un défi pour la légitimité internationale
Ces sanctions soulèvent une question fondamentale : comment une juridiction censée garantir l’égalité de tous devant la loi peut-elle fonctionner quand les grandes puissances refusent de s’y soumettre ? Depuis sa création, la CPI a souvent été accusée de cibler prioritairement les dirigeants africains, alimentant le sentiment d’une justice sélective. Les attaques américaines renforcent ce déséquilibre et donnent du crédit à ceux qui dénoncent une Cour « instrumentalisée ».
Pourtant, dans un monde marqué par la multiplication des conflits armés et des crimes de masse, l’existence d’un mécanisme judiciaire international demeure une nécessité. Loin de disparaître, la CPI est appelée à se réinventer pour ne pas sombrer dans l’insignifiance. Cela suppose un soutien accru des États parties, mais aussi une réaffirmation claire de son indépendance face aux pressions politiques.
Selon que vous soyez puissant ou misérable, la Justice vous rendra innocent ou coupable ?
La question reste entière : la CPI peut-elle un jour imposer ses décisions aux puissances qui s’y opposent ? Tant que les États-Unis et leurs alliés continueront de dicter leurs propres règles, la justice internationale restera perçue comme incomplète, inégale, voire instrumentalisée.
La projection dans l’avenir ne peut éluder une interrogation majeure : verra-t-on un jour un haut responsable d’un pays développé comparaitre devant la Cour pénale internationale ? Les précédents laissent sceptiques. À ce jour, la quasi-totalité des poursuites ont concerné des dirigeants africains ou issus de pays fragiles. Mais la persistance des crimes de guerre en Ukraine, en Palestine ou ailleurs, et la montée de la pression des opinions publiques mondiales, pourraient rebattre les cartes.
La condamnation effective d’un dirigeant d’une grande puissance paraît aujourd’hui improbable tant les équilibres géopolitiques dictent les limites de la justice internationale. Mais l’histoire regorge de revirements : qui aurait imaginé, avant Nuremberg, que des dignitaires nazis seraient jugés par une juridiction internationale ? L’idée d’une justice véritablement universelle reste peut-être une utopie… mais une utopie nécessaire, car elle constitue l’horizon moral vers lequel tend l’humanité.
En définitive, la question n’est pas seulement de savoir si un responsable d’un État puissant sera un jour jugé et condamné par la CPI, mais si la communauté internationale acceptera enfin que la loi prime réellement sur la force.
Ahmed M. Thiam
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0