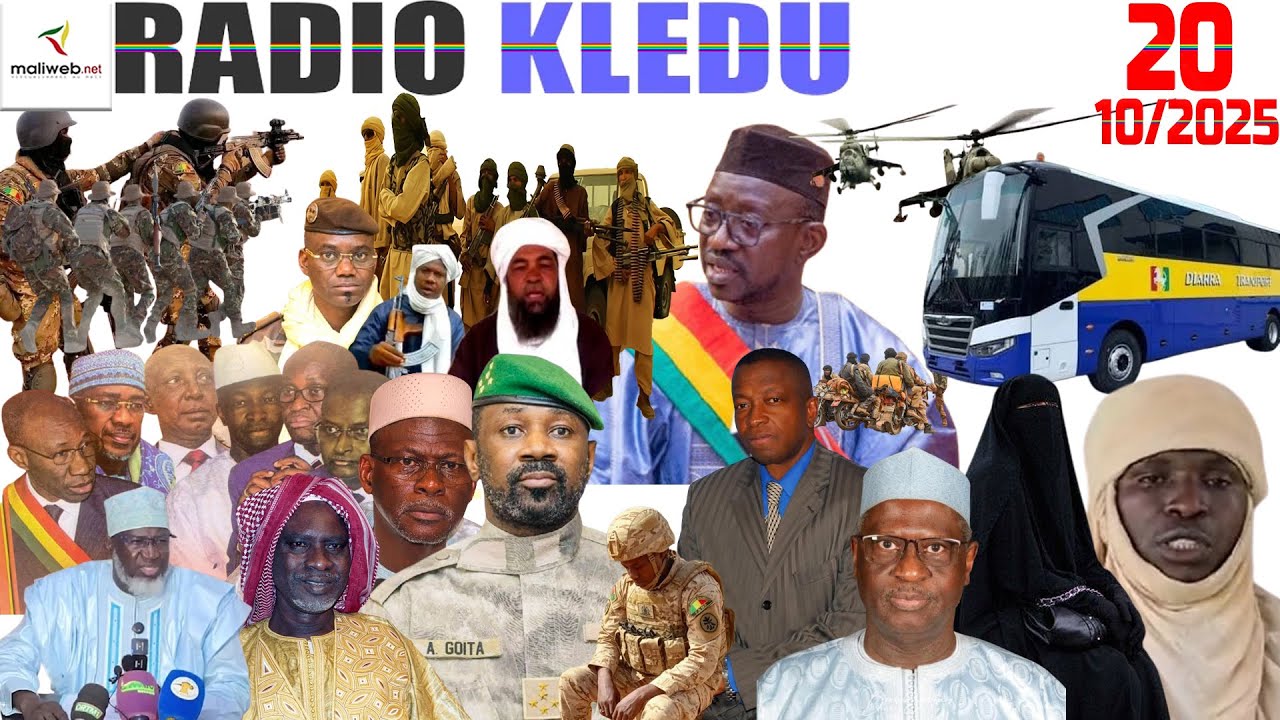Lu sur un forum d’échanges : « Un État fort n'est pas autoritaire, mais juste, efficace et respecté »
Depuis des décennies, le Mali est confronté à une faiblesse structurelle et endémique de l'État, une réalité qui gangrène toutes les strates de la société.

Cette défaillance chronique se manifeste par un désordre et une indiscipline généralisés, érodant la confiance des citoyens et entravant la capacité de l'État à exercer pleinement ses fonctions régaliennes.
L'érosion de l'autorité publique n'est pas un phénomène récent. Ses prémices se sont manifestées dès l'ère du général Moussa Traoré. Le cas emblématique des dédommagements et des démolitions à Bozola, liés à un projet d'aménagement urbain inachevé, a semé un sentiment d'injustice et d'impuissance, marquant une première fissure dans le contrat social.
Paradoxalement, la période dite démocratique, loin d'apporter le renouveau espéré, a accentué cette érosion, notamment dans le secteur crucial de l'éducation. Le syndicat estudiantin, jadis un contre-pouvoir légitime, s'est transformé en une force supplétive, voire une autorité parallèle. Le ministère de l'Éducation s'est retrouvé contraint de subir les diktats de ces organisations, qui définissaient les règles de passage, géraient et parfois détournaient les fonds, et distribuaient les dortoirs. Cette situation a non seulement miné la qualité de l'enseignement malien, le reléguant au rang des plus faibles de la sous-région, mais a également privé l'État de ressources financières vitales, détournées de leur vocation première. C'est une véritable abdication de la souveraineté éducative. Heureusement, la transition actuelle a mis fin à ce désordre estudiantin en dissolvant totalement ce syndicat.
Le chaos qui règne sur nos routes est peut-être le symptôme le plus visible et quotidien de cette faiblesse étatique. La circulation à Bamako et dans les autres villes maliennes est une véritable jungle où aucune règle ne semble s'appliquer. Motos-taxis, tricycles et transports en commun ignorent allègrement feux rouges, priorités et signalisations. À cela s'ajoute l'occupation anarchique de la chaussée par des vendeurs, au vu et au su des autorités, sans aucune sanction. L'occupation illicite de l'emprise des rails par des constructions, fruit de la complicité d'agents véreux de l'État, est également flagrante. Il convient de saluer les récentes démolitions entreprises sous cette transition pour la construction d'autoroutes, et il est impératif que cette dynamique se poursuive le long des voies ferrées. Ce désordre n'est pas le fruit du hasard ; il est le miroir d'une police routière qui, trop souvent, préfère le racket à la rigueur de l'application de la loi. L'absence criante d'initiatives pour faire respecter l'immatriculation des motos ou le port du casque n'est pas une simple négligence ; elle est une démission de l'État face à la sécurité de ses citoyens et à l'organisation de l'espace public. Comment un État peut-il ne pas assurer la sécurité élémentaire de ses habitants dans un espace aussi régulé que la voie publique ? C'est une anomie qui gangrène profondément le tissu social.
Corruption, clientélisme, méfiance généralisée…
Plus profondément, la faiblesse de l'État malien se manifeste par une impunité rampante et une application de la loi à deux vitesses. Les scandales financiers à répétition, rarement suivis de sanctions exemplaires, les passe-droits qui régissent l'accès aux services, et l'incapacité à collecter efficacement les impôts ou à réguler les marchés informels sont autant d'indicateurs d'un État dont les leviers sont grippés.
Lorsque la loi n'est pas appliquée à tous de manière égale, la légitimité de l'État s'effrite, ouvrant la voie à la corruption, au clientélisme et à une méfiance citoyenne généralisée. L'article 1er du chapitre 1er de la nouvelle constitution malienne stipule pourtant que : « Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs.» Cette noble proclamation reste malheureusement lettre morte tant que l'État ne s'arme pas de la force et de la volonté nécessaires pour la concrétiser.
Le projet du Mali Kura ne peut aboutir que si cette faiblesse structurelle de l'État est prise à bras-le-corps. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement, mais d'une refondation profonde. Un État fort n'est pas un État autoritaire, mais un État juste, efficace et respecté. C'est un État capable de faire respecter la loi sans complaisance, d'assurer la sécurité de ses citoyens, de garantir des services publics de qualité et de défendre inconditionnellement l'intérêt général. Ce n'est qu'à cette condition que le désordre cédera la place à l'ordre, l'indiscipline à la citoyenneté, et que le Mali pourra enfin emprunter la voie d'un développement durable et équitable.
D. B.
Artiste plasticien
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
1
Triste
1
 Ouah
0
Ouah
0