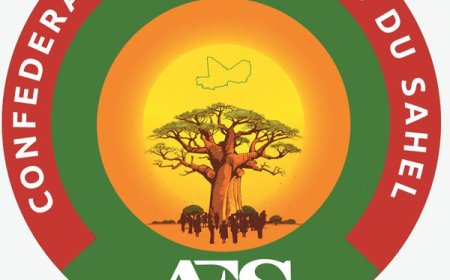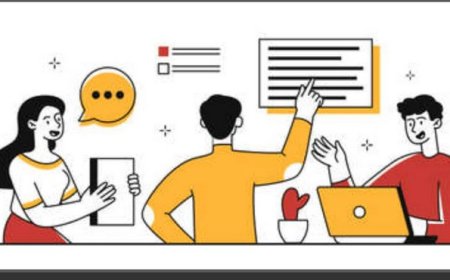Que faire quand l’homme que vous aimez vous cherche querelle pour se débarrasser de vous ? Le combat est à ce moment inégal entre l’égoïste et l’amoureuse.

Il faut le reconnaître, l’homme est par essence égoïste lorsque son plaisir est en jeu. Il sait aussi se montrer ingrat, même avec celles qui lui ont donné les plus beaux moments de sa vie. Il est très souvent prompt à jeter la pierre à sa compagne dès lors que disparaît l’attrait physique et que chancelle l’entente dans le couple. Très souvent par sa faute naissent des situations conflictuelles alors qu’un brin de délicatesse, un soupçon de compréhension, un grain de tendresse auraient suffi pour réparer les déchirures de l’amour blessé.
Les femmes font elles aussi des écarts, mais elles sont en général plus victimes que coupables. Cependant lorsqu’elles jugent avoir suffisamment encaissé, il leur arrive de se venger de la manière la plus impitoyable qui soit et le retour de flamme est souvent dévastateur pour l’homme. Les cas que nous allons aborder aujourd’hui offrent des situations très diverses de femmes traumatisées. Ils me furent donnés lors d’une rencontre chez ma vieille amie (et votre vieille connaissance) Mâh. C
e jour là, je l’avais trouvée en compagnie de deux jeunes femmes. La première, Oumouba, ne m’était pas totalement inconnue. Nous nous étions déjà rencontrés dans des cérémonies sociales, mais sans avoir eu le temps de vraiment bavarder. C’était une belle femme d’une quarantaine d’années et sa robe largement décolletée laissait suggérer un corps agréablement épanoui.
En outre son teint soigneusement entretenu et son allure élégamment nonchalante en disaient long sur la peine qu’elle prenait pour bien paraître. Mâh mit fin à mes supputations intérieures en me la présentant comme une amie à sa petite sœur. Elle enchaîna sur le récit des mésaventures de cette dame. Oumouba avait fait de solides études en Belgique et possédait une maîtrise en gestion d’entreprise. Elle avait également travaillé dans une société en Europe pour se constituer son trousseau. Mais si professionnellement elle avait su bien mener sa barque, sur le plan sentimental, ce fut tout autre chose.
La jeune femme s’était d’abord mise en ménage avec un Camerounais dont elle s’aperçut bien vite de l’insupportable brutalité. Oumouba tint pourtant trois longues années et elle finit par se séparer de son compagnon, ne pouvant plus accepter d’être le défouloir d’un incorrigible buveur. M’Bikap, c’était son nom, n’était pas un homme foncièrement méchant, mais il était impossible de le faire renoncer à l’alcool, qui était à la base de ses déchaînements de violence. Quand Oumouba rompit avec son bourreau, elle envisagea de rentrer au pays.
Les appuis dont jouissait un de ses beaux-frères lui ouvrirent des perspectives intéressantes dans la fonction publique. Mais habituée aux salaires européens, la jeune femme ne pouvait se faire à la maigreur des rétributions maliennes. L’insistance de ses parents et la déception née de sa séparation avec M’Bikap l’incitèrent pourtant à "faire le saut" et à fermer les yeux sur le niveau désespérément bas des revenus qui l’attendaient. Au départ Oumouba voulut garder une indépendance totale vis-à-vis de sa famille. Pour y parvenir elle s’acheta une villa derrière le fleuve qu’elle meubla à son goût, fit venir sa petite voiture et commença à travailler dans un service financier où elle occupa très vite des fonctions de chef de personnel. Une compétition de grossesse- Oumouba s’était donnée comme ligne de conduite de maintenir une certaine réserve vis-à-vis des hommes. Pour elle, la distance ainsi marquée lui assurerait le respect de ses collègues et de ses interlocuteurs administratifs. En outre, mis à part cet argument "professionnel", la jeune femme encore échaudée par sa première expérience de vie commune, gardait de très forts préjugés contre les hommes.
Elle ne se rendait pas compte que la cuirasse qu’elle s’était forgée effarouchait même les prétendants animés de bonnes intentions à son égard. Elle était devenue la "muso kalan né" (femme instruite) pour laquelle le mâle malien n’a habituellement pas beaucoup de sympathie. Trois années passèrent et la solitude commença à peser sur Oumouba, sans compter que sa mère et ses tantes se désolaient de la voir devenir petit à petit vieille fille. "Ce fut à cette époque que ma petite sœur me l’amena, poursuivit Mâh. J’entrepris de lui permettre d’avoir une vision moins négative des hommes. Au départ Oumouba voulait un mari à elle seule, un homme courtois, doux, attachant et très instruit. Je lui dis sans ambages que cet oiseau-là ne courait pas les rues dans notre pays et qu’elle devait accepter de laisser tomber ses critères de "toubabesse".
Oumouba me fréquentait assidûment et je sentais qu’elle me faisait confiance pour lui trouver un compagnon, qui se rapprocherait de son idéal. Pour cela, je lui conseillais de commencer par ressembler d’abord à une Malienne. Elle devait notamment varier sa garde-robe, celle-ci était en effet constituée uniquement d’habits européens. En prenant le style local, elle intimiderait moins les hommes qui voulaient faire sa connaissance. Ensuite, je lui conseillai de trouver un peu de temps à consacrer au social. Cérémonies de mariage, baptêmes, sans compter les décès. Ce serait en allant aux gens qu’elle avait le plus de chance de trouver le mari qu’il lui fallait. L’effet de sa transformation ne tarda pas à se manifester. Elle eut un, puis deux vrais amis dans le milieu masculin, ce qui contribua à la rendre moins rigide avec les hommes.
Dans son service beaucoup lui avouèrent qu’ils ne la croyaient pas capable de s’humaniser. Oumouba devenait de plus en plus sociable et par conséquent, je la voyais moins. Je ne lui en tenais pas rigueur car cela prouvait qu’elle s’adaptait. Un jour cependant elle vint me voir pour me révéler qu’elle pensait être amoureuse d’un homme. Seul inconvénient, il était marié. Mais, et cela Oumouba le dit avec un air triomphant, sa femme n’avait pas d’enfant. Je douchais l’enthousiasme de ma jeune amie en lui disant que ce n’était pas ce qu’il lui fallait, surtout après qu’elle m’eut dit le nom de son élu. J’entrepris de la convaincre. Je lui dis d’abord de ne pas faire la bêtise de tomber enceinte des œuvres de son amant. Un enfant ne l’aiderait pas à s’attacher cet homme et ne pousserait pas ce dernier au divorce. Oumouba sursauta en entendant cela et je compris que j’avais mis dans le doigt sur son plan secret. Ensuite, je la dissuadais d’entrer en concurrence avec la femme de son amant. Cela ne lui amènerait que des tourments. Elle se torturerait chaque jour en imaginant "son" homme dans les bras d’une autre. Enfin je lui exposai le dossier de Idrissa, l’homme qu’elle aimait et que tout Bamako connaissait. C’était un bourreau de cœur sans scrupules et un homme qui nourrissait en outre une très haute opinion de lui-même.
Au bout de ma démonstration, je commis la maladresse de suggérer à Oumouba le nom d’un ingénieur géologue, un brave type qui s’appelait Zoumana et que j’avais repéré pour elle. Ma maladresse fut de le proposer alors que je n’avais pas du tout convaincu Oumouba de renoncer à Idrissa. Je crois que ce fut de cette conversation que naquit la distance que Oumouba prit vis-à-vis de moi. Elle cessa en effet de me fréquenter, jugeant que je n’étais pas de son côté. Deux mois après, ma sœur Aïnana vint me faire part du mariage de sa copine. La nouvelle me fit mal, car je restais persuadée que Oumouba avait fait le mauvais choix.
Trois ans après, toute fierté bue, elle vint me trouver pour me relater le calvaire qu’elle avait vécu pendant plus d’un an, mais ça je préfère que ce soit elle-même qui le raconte". Comme l’assistance tournait le regard vers Oumouba, cette dernière entama d’une voix hésitante son récit. "Mâh a bien posé le problème et je dois avouer que je me suis complètement trompée sur le compte de Idrissa. Au moment où nous nous marions mon amant m’avait caché que, contrairement à ce qu’il m’avait raconté au début de nos relations, sa femme était enceinte d’un mois. Si bien que j’étais ridicule de considérer mon mariage comme un défi à ma coépouse. Mais Idrissa de toutes façons me comblait comme amant d’abord, puis comme époux. J’avais volontairement omis de dire à Mâh que nous vivions déjà une grande passion charnelle au moment où je vins l’entretenir de mon problème. Je crois que ce fut de cette passion que naquit mon esprit de compétition. J’étais égoïste, mais en amour qui ne l’est pas ? Le fait de vivre sous des toits différents exacerbait davantage mes appétits sexuels. Quand je n’étais pas de nuitée, mon humeur massacrante se ressentait au service. Mon planton se risqua à me faire la remarque et au lieu de le punir pour son impertinence, je pris l’homme comme confident. Lorsque je tombais en état de grossesse ce fut le même planton qui me révéla que j’aurai une fille.
Quelques mois après, il me dit que ma coépouse aurait un garçon. J’étais si anéantie que ce jour-là je restai tard au bureau à pleurer sur mon sort. J’ignorais en effet à ce moment-là que ma rivale était en état de grossesse. Mon époux me le confirma sans sourciller le lendemain, en ajoutant cyniquement que Assa (ma coépouse) était "en avance d’un mois" sur moi. Je mesurai alors toute sa duplicité et je me reprochais amèrement d’avoir été aveuglée à ce point. Assa accoucha comme prévu d’un garçon et le jour du baptême, mes belles-mères et mes belles-sœurs m’exhortèrent à suivre son exemple. Quand ma fille vint au monde, ces mégères ne se privèrent pas de me faire part de leur déception, et cela de la manière la plus méchante qui soit. Mon mari, comme attendu, se rapprocha davantage de Assa. Ses passages chez moi étaient toujours prétextes à dispute et le ton montait de plus en plus entre nous sans que je ne me rende compte.
Le boycott au lit- Un soir il me gifla et par réflexe je répliquai. Alors il entreprit en représailles de me bouder au lit. J’étais mortifiée, mais ma fierté ne me permit pas de lui présenter des excuses. Moi, je voulais qu’on s’explique et qu’on se demande pardon réciproquement. Idrissa n’était pas prêt à cela. Il jugeait que c’était lui l’offensé. Sa bouderie vira au boycott total. Je subis cette situation d’indifférence conjugale pendant quatorze mois avant de craquer. Je vins voir Mâh qui me conseilla le divorce. Mais pour moi, quitter mon ménage était une sorte de capitulation. J’essayai donc de reculer cette échéance.
Après avoir rassemblé mon courage je fis appel à un oncle de Drissa et à un Imam pour prier mon époux de m’excuser. Ce qu’il fit du bout des lèvres, mais son comportement ne changea guère. Mon travail se ressentait du délaissement de celui, qui n’était mon mari que de nom depuis vingt mois. Finalement au bout de deux ans et trois mois je me résolus à demander le divorce, que je n’eu aucun mal à obtenir. Inutile de vous dire que c’est une femme vexée et sans doute marquée à jamais par le détachement de son mari que vous avez devant vous". Sa voix se brisa en prononçant cette dernière phrase.
La troisième femme qui était avec nous lui vint en aide et traita Idrissa de "criminel". La gifle, dira-t-elle, n’a été qu’un prétexte pour faire ses quatre volontés. "En homme responsable, fulmina-t-elle, Idrissa aurait du le lendemain divorcer de Oumouba au lieu de la garder pendant deux ans et lui faire connaître les affres du détachement. Ce que notre amie n’ose pas dire, c’est qu’au début le manque de rapports conjugaux a perturbé son équilibre physiologique. Il lui était arrivé durant ces premiers mois d’avoir des rêves humides. Son mari se doutait bien qu’elle n’avait pas un caractère volage, sinon il se serait comporté différemment. Oumouba fut obligée de demander une mutation dans un autre service. Heureusement qu’on le lui accorda, car comment aurait-elle pu supporter jour après jour les regards inquisiteurs des agents qu’elles contrôlaient ? En tout cas, voilà cinq ans qu’elle vit encore divorcée, pas du tout prête à recommencer malgré les sollicitations de certains prétendants. Ses parents eux désespèrent définitivement de la voir un jour remariée. Ils n’ont peut-être pas tort.
Oumouba commence tout juste à se remettre des deux rudes épreuves qu’elle a traversées : celle d’amante battue et celle d’épouse délaissée". Mâh, elle, continuait de s’en vouloir de n’avoir pas pu protéger Oumouba d’une erreur fatale : "En devenant l’amante régulière d’un homme avant le mariage, une femme perd beaucoup de son objectivité de jugement. Je m’étais douté un peu de l’attachement charnel de Oumouba à Idrissa, même si elle ne m’en avait pas parlé. Une femme comblée au lit réussit difficilement à cacher son rayonnement intérieur. Je l’ai sentie, voilà pourquoi je l’ai dissuadée d’épouser Idrissa. J’aurais du lui dire sans prendre de gants qu’elle n’était plus elle-même, qu’elle était incapable de lucidité. Quand je pense qu’à trente-sept ans, la vie sentimentale de Oumouba n’a été qu’un désastre de bout en bout, je me dis que quelque part il finira bien par y avoir une justice pour qu’elle connaisse enfin le bonheur".
Un beau père humilié ? Notre petit groupe philosopha longuement sur le cas de Oumouba. Un cas qui rappelait que ce n’était pas seulement les "générations sacrifiées", les femmes données en mariage sans leur consentement, qui souffraient du poids des préjugés des us et coutumes, qui donnaient raison à l’homme dans presque toutes les situations. Oumouba, l’intellectuelle, avait payé cher son amour-propre qui l’avait empêché de repentir immédiatement. Elle avait surtout payé cher son réflexe de rendre à son mari la gifle de celui-ci. Toutes ses amies le lui avaient d’ailleurs reproché. Une gifle, disaient-elles, n’avait jamais tué personne.
Par contre sa réaction lui avait valu la réputation de : "tiè bogo muso" (une femme qui frappe l’homme). La rumeur avait amplifié son geste et maintenant elle était étiquetée à vie dans une société qui acceptait mal ce genre de comportement. Qui se risquerait à se lier à une : "muso kulusi tigi" (une femme portant culotte). Quand on veut tuer son chien on l’accuse de rage. Comme Oumou se suffit largement à elle-même, les méchantes langues ont dit que c’est justement son statut de privilégiée, qui lui permet de se montrer aussi effrontée. Dans le petit groupe de mes interlocutrices, on se montrait solidaire des malheurs de la jeune femme en affirmant "Baa mana dégun a bè kinii kè" (Mettez une chèvre aux abois, elle pourrait alors mordre).
Notre parenthèse philosophique menaçait de se prolonger, Mâh se chargea donc de nous ramener à nos moutons en donnant la parole à la seconde jeune femme, Nènè, pas très belle mais bien faite physiquement. "J’ai connu, commença-t-elle, mon mari Bamo, très jeune il y a près de vingt ans. Nous nous sommes mariés presque aussitôt, mais quand il a perdu son emploi, sept ans plus tard, il demanda ma bénédiction pour aller à l’aventure tenter sa chance, tout en me promettant de me faire venir avec mes deux enfants si tout marchait bien là-bas. J’ai attendu cinq longues années dans sa famille avant qu’il daigne se manifester.
Il revenait de l’Afrique de l’est avec un pécule, qui lui permit de nous acheter un toit et surtout de mettre de l’argent en banque pour nous, afin que nous ne soyons plus à la charge des autres. Il resta cinq mois, le temps que tout cela s’arrange comme il le voulait. Je tombais en état de grossesse durant la période. Mais avant mon accouchement, Bamo me dit qu’il devait repartir. Je fus désappointée d’apprendre qu’il avait laissé deux noms à ses parents selon que mon enfant serait une fille ou un garçon.
Pour moi, cela ne présageait rien de bon. J’eus une fille, ce qui, après les deux premiers garçons, fut accueilli avec joie dans la famille. Quatre années passèrent sans que Bamo ne se manifeste. Notre trésor en banque, vous l’imaginez, s’était épuisé. J’entrepris un petit commerce pour faire vivre mes enfants au lieu d’aller solliciter toujours de l’argent dans sa famille. J’expliquai mes projets à ma belle-mère dont je reçus l’aval pour mes activités. Quelle ne fut ma surprise un jour d’apprendre que Bamo était venu entre deux avions dire bonjour à ses parents. Il s’était rendu à l’école pour voir les enfants et aux dires de sa mère, il avait laissé de l’argent à son frère pour que celui-ci me le remette. J’étais morte de rage et de honte, surtout que dans mon entourage tout le monde apprit ma mésaventure. Mon beau-frère vint à la maison me donner trois millions en liquide. Mais l’argent pour moi à ce moment-là importait moins que de voir mon époux, ne serait-ce que quelques secondes. J’essayais de me consoler en me disant que ses deux fils l’avaient vu.
Mais les larmes me revenaient aux yeux dès que je me rappelais qu’il était reparti sans venir voir ma fille de quatre ans, sa "batogoma" (l’homonyme de sa mère). Quelques mois après, j’appris que c’était cinq millions qu’il avait laissés à son frère pour moi, et non trois. Fort heureusement, je ne m’étais pas contentée de dépenser mon argent jusqu’à épuisement des fonds. J’avais ouvert une boutique au grand marché et je la tenais avec un de mes frères.
Comme mon commerce prospérait, je m’abstins de faire du scandale à propos des deux millions escamotés. Ma belle-mère d’ailleurs m’en dissuada en invoquant la nécessité de préserver l’unité de la famille. Je savais que dans son intervention entrait une grande part de faiblesse pour son fils fautif, mais je ne poussai pas plus loin l’affaire. J’en fus mal récompensée. J’appris un peu plus tard que les gens jasaient sur mon compte et liaient la relative prospérité de mes affaires aux supposées faveurs que j’accorderais à certains grossistes et même à des clients. Ma belle-mère, que j’allais voir chaque matin de bonne heure, s’était gardée de me rapporter ces ragots, mais elle y prêtait attention. Je constatais qu’elle n’était plus aussi chaleureuse avec moi qu’auparavant.
Le jour où je lui fis gentiment la remarque, elle se limita à me dire que : « les temps ne sont plus pareils pour la même personne". Le sous-entendu me révolta et ma première impulsion fut d’espacer mes visites dans ma belle-famille. Mais après m’être calmée, je me rendis compte que cela aurait été une terrible erreur de ma part. Je poursuivais donc mon commerce et avec mes bénéfices j’achetais une bâchée pour faire du transport. Là encore, Dieu merci, cela marchait bien. Mais mon principal problème restait intact. Un jour mon beau-père me fit appeler et sans prendre de gants, il critiqua ma manière de vivre, allant jusqu’à sous-entendre que j’étais une épouse légère.
Les hurlements que je laissai échapper ameutèrent le voisinage. Je pris à témoin les gens accourus de ma bonne foi et jurai que Bamo était le seul homme que j’avais connu dans ma vie et qu’il resterait le seul. Mes protestations d’innocence laissèrent mes beaux-parents entièrement insensibles. Alors je décidai de débrider une bonne fois l’abcès. Le lendemain je me fis accompagner par l’imam du quartier et en présence de mon beau-père, je demandai à la personnalité religieuse au nom de Dieu qui nous voyait tous, d’être le témoin de ma fidélité et de la fausseté des accusations que ma belle-famille laissait courir sur moi. Je crois que ma sincérité toucha l’homme de Dieu. Mais mon beau-père prit très mal le fait que je l’avais : « fait asseoir dans le djô ». Il ne me le pardonna pas jusqu’à sa mort qui interviendra quelques mois après. Mon mari arriva pour les obsèques et je le sentis distant quand nous nous sommes trouvés face à face. Je mis cela au compte du deuil qui le frappait, mais huit mois plus tard son comportement n’avait pas changé. Nous dormions dans le même lit, mais il se gardait de me toucher. Je n’osais démentir mes amies, qui me chahutaient gentiment en disant que j’avais repris les habitudes de la chambre nuptiale. Si elles savaient la vérité ! J’eus beau me plier en quatre pour faire plaisir à Bamo, je ne percevais rien d’amical dans son comportement. Au départ je passais mon temps à lui faire un compte-rendu par le menu de mes affaires. Il m’écoutait d’une oreille distraite et j’arrêtai assez vite ces monologues qui semblaient l’ennuyer. Plusieurs fois je lui posais et reposais la question de savoir ce qui n’allait pas entre nous. "Rien", se bornait-il de répondre. Mais la situation pour moi devenait de moins en moins tenable.
Mon époux en était arrivé à me rendre mes salutations sur le bout des lèvres. Comme je ne lui connaissais pas d’amis intimes à qui je puisse me confier, je ne savais pas par quel moyen rétablir la communication entre nous. Un jour il me demanda à brûle-pourpoint si j’avais les papiers de la maison établis à l’époque à mon nom.
Cette question me fit comprendre que je n’avais plus de mari. Bamo était devenu un simple étranger qui dormait dans mon lit. Un de mes clients vint un jour me demander si ça marchait bien dans notre couple. Comme sa question me prenait au dépourvu, il avoua savoir que depuis quelques mois mon époux menait dans mon dos sa petite enquête. Bizarrement la nouvelle me soulagea. Pour moi, le soupçon était la chose la plus difficile à supporter et je savais qu’au bout de ses investigations Bamo ne trouverait absolument rien à me reprocher. Mes espoirs de voir notre couple se rapprocher s’estompèrent assez vite. Je m’aperçus que l’absence de preuves au lieu de rassurer mon mari l’exaspérait. Il voulait que je sois coupable et seul l’intéressait ce qui allait dans le sens de sa conviction. Il resta environ un an et demi avant de s’en aller.
Une cruelle bouderie- Je peux vous dire que j’ai plus souffert pendant ce laps de temps que durant les neuf précédentes années de son absence. Il m’arrivait de me réveiller en sueur certaines nuits au sortir de rêves érotiques très intenses. A ces moments je regardais l’homme, qui était mon mari mais qui dormait à mes côtés, plus inerte qu’un morceau de bois. Ma frustration était si intense que j’en avais des douleurs au bas-ventre. Le plus dur était qu’à l’époque j’espérais toujours que le déclic entre nous se produirait à l’improviste une nuit et qu’il fallait alors que Bamo me trouve dans les meilleures dispositions. Donc avant de me coucher, je buvais beaucoup d’eau chaude au "babili" ou au "gongolili", histoire d’être accueillante pour mon mari si l’envie lui venait. Mais Bamo par son détachement tuait ma libido et l’attente non récompensée a fait de moi une femme comme desséchée de l’intérieur, sans élan et presque sans appétit.
Je ne sais pas si un jour je pourrai retrouver mon ardeur entre les bras d’un homme. Bamo est revenu l’année dernière et nous avons conclu un divorce à l’amiable. Le jour où fut prononcée notre séparation, il passa aux aveux. Mais ce fut devant Mâh qu’il fit ces révélations. Il lui confia qu’il s’était marié deux ans après être parti. Sa femme de "là-bas" lui avait donné une fille. La fortune de la seconde épouse était considérable, suffisamment en tous les cas pour qu’il ait fait le choix de se fixer en exil. Bamo avoua aussi qu’il m’avait longtemps tenu rigueur pour avoir fait prendre son père en flagrant délit de diffamation. Le vieux qui l’avait fait venir un peu avant sa mort s’était plaint de ma démarche auprès de l’Imam. Bamo lui jura de me faire payer mon outrecuidance et de me "maudire". En quelque sorte le vieux en mourant m’avait enterrée et son fils restait prisonnier du serment qu’il avait fait au défunt. Des érudits auraient pu lui indiquer par quelle voie il aurait pu se délier d’un engagement qui n’était pas irréversible. Mais Bamo lui-même reconnaissait avoir accumulé beaucoup trop de torts à mon égard pour que nous puissions reprendre notre vie commune.
Mon ex-mari avait ce jour-là soulagé sa conscience. Il me souhaita de bien prendre soin de nos enfants et pour cela il m’épaulerait autant que je le voudrais. Il savait qu’en partant cette fois-ci il y avait peu de chance qu’il revienne un jour, et il avait pris soin de garnir mon compte en banque. Quand ma grande sœur me rapporta cette longue confession, je l’envoyais à mon tour pour le supplier de venir me redire son repentir dans notre lit malgré que le divorce ait été prononcé. Bamo promit de le faire, mais il ne vint pas, sans doute pour une question de fierté. J’ai souffert du détachement de Bamo, mais il restera toujours mon mari et je ne désespère pas de le revoir un jour. Car j’ai la conviction que notre histoire ne peut s’achever ainsi.
Un homme n’a pas le droit de tirer de la sorte un trait sur sa vie", acheva Nènè, les larmes aux yeux. Mâh lui vint en aide en l’amenant dans sa chambre. Quand elles revinrent s’installer, tout le petit groupe s’employa à remonter le moral de Nènè. Bien que nous tous nous lui conseillions de garder courage car Dieu veille sur les innocentes, Nènè fut incapable de se détendre. Personnellement, en tant qu’homme, je ne me sentais pas très fier après avoir entendu le récit des malheurs de la jeune femme. Mâh sentit mon malaise et elle s’engouffra sans hésiter dans la brèche. Pendant cinq bonnes minutes elle se défoula en critiquant "ces hommes" briseurs de bonheur et dont les femmes sont obligées de subir en silence les colères, les caprices et les trahisons.
Dans notre société, dit-elle, la liberté est une notion qui fonctionne à deux vitesses. Au mâle, la liberté de disposer. A la femme, la liberté de subir. Certains mâles ne vont-ils pas jusqu’à dire qu’en s’engageant dans le mariage, une épouse abdique de ses droits en faveur de son époux ? Ces mêmes présentent le plaisir comme un luxe dans la vie en ménage. Pas étonnant, conclut Mâh, que la famille se dégrade et que les mœurs soient de plus en plus dissolues. Car lorsque la femme frustrée découvre des horizons dont elle ne se doutait pas, elle les explore avec ravissement. Exactement comme un aveugle à qui sont révélées les couleurs. A ce moment le glas sonne pour les brutaux, les égoïstes et les mollassons. Mâh était sans doute trop véhémente dans son diagnostic, mais elle n’avait pas tout à fait tort.
(à suivre)
vendredi 7 octobre 2011
 Il faut le reconnaître, l’homme est par essence égoïste lorsque son plaisir est en jeu. Il sait aussi se montrer ingrat, même avec celles qui lui ont donné les plus beaux moments de sa vie. Il est très souvent prompt à jeter la pierre à sa compagne dès lors que disparaît l’attrait physique et que chancelle l’entente dans le couple. Très souvent par sa faute naissent des situations conflictuelles alors qu’un brin de délicatesse, un soupçon de compréhension, un grain de tendresse auraient suffi pour réparer les déchirures de l’amour blessé.
Les femmes font elles aussi des écarts, mais elles sont en général plus victimes que coupables. Cependant lorsqu’elles jugent avoir suffisamment encaissé, il leur arrive de se venger de la manière la plus impitoyable qui soit et le retour de flamme est souvent dévastateur pour l’homme. Les cas que nous allons aborder aujourd’hui offrent des situations très diverses de femmes traumatisées. Ils me furent donnés lors d’une rencontre chez ma vieille amie (et votre vieille connaissance) Mâh. C
e jour là, je l’avais trouvée en compagnie de deux jeunes femmes. La première, Oumouba, ne m’était pas totalement inconnue. Nous nous étions déjà rencontrés dans des cérémonies sociales, mais sans avoir eu le temps de vraiment bavarder. C’était une belle femme d’une quarantaine d’années et sa robe largement décolletée laissait suggérer un corps agréablement épanoui.
En outre son teint soigneusement entretenu et son allure élégamment nonchalante en disaient long sur la peine qu’elle prenait pour bien paraître. Mâh mit fin à mes supputations intérieures en me la présentant comme une amie à sa petite sœur. Elle enchaîna sur le récit des mésaventures de cette dame. Oumouba avait fait de solides études en Belgique et possédait une maîtrise en gestion d’entreprise. Elle avait également travaillé dans une société en Europe pour se constituer son trousseau. Mais si professionnellement elle avait su bien mener sa barque, sur le plan sentimental, ce fut tout autre chose.
La jeune femme s’était d’abord mise en ménage avec un Camerounais dont elle s’aperçut bien vite de l’insupportable brutalité. Oumouba tint pourtant trois longues années et elle finit par se séparer de son compagnon, ne pouvant plus accepter d’être le défouloir d’un incorrigible buveur. M’Bikap, c’était son nom, n’était pas un homme foncièrement méchant, mais il était impossible de le faire renoncer à l’alcool, qui était à la base de ses déchaînements de violence. Quand Oumouba rompit avec son bourreau, elle envisagea de rentrer au pays.
Les appuis dont jouissait un de ses beaux-frères lui ouvrirent des perspectives intéressantes dans la fonction publique. Mais habituée aux salaires européens, la jeune femme ne pouvait se faire à la maigreur des rétributions maliennes. L’insistance de ses parents et la déception née de sa séparation avec M’Bikap l’incitèrent pourtant à "faire le saut" et à fermer les yeux sur le niveau désespérément bas des revenus qui l’attendaient. Au départ Oumouba voulut garder une indépendance totale vis-à-vis de sa famille. Pour y parvenir elle s’acheta une villa derrière le fleuve qu’elle meubla à son goût, fit venir sa petite voiture et commença à travailler dans un service financier où elle occupa très vite des fonctions de chef de personnel. Une compétition de grossesse- Oumouba s’était donnée comme ligne de conduite de maintenir une certaine réserve vis-à-vis des hommes. Pour elle, la distance ainsi marquée lui assurerait le respect de ses collègues et de ses interlocuteurs administratifs. En outre, mis à part cet argument "professionnel", la jeune femme encore échaudée par sa première expérience de vie commune, gardait de très forts préjugés contre les hommes.
Elle ne se rendait pas compte que la cuirasse qu’elle s’était forgée effarouchait même les prétendants animés de bonnes intentions à son égard. Elle était devenue la "muso kalan né" (femme instruite) pour laquelle le mâle malien n’a habituellement pas beaucoup de sympathie. Trois années passèrent et la solitude commença à peser sur Oumouba, sans compter que sa mère et ses tantes se désolaient de la voir devenir petit à petit vieille fille. "Ce fut à cette époque que ma petite sœur me l’amena, poursuivit Mâh. J’entrepris de lui permettre d’avoir une vision moins négative des hommes. Au départ Oumouba voulait un mari à elle seule, un homme courtois, doux, attachant et très instruit. Je lui dis sans ambages que cet oiseau-là ne courait pas les rues dans notre pays et qu’elle devait accepter de laisser tomber ses critères de "toubabesse".
Oumouba me fréquentait assidûment et je sentais qu’elle me faisait confiance pour lui trouver un compagnon, qui se rapprocherait de son idéal. Pour cela, je lui conseillais de commencer par ressembler d’abord à une Malienne. Elle devait notamment varier sa garde-robe, celle-ci était en effet constituée uniquement d’habits européens. En prenant le style local, elle intimiderait moins les hommes qui voulaient faire sa connaissance. Ensuite, je lui conseillai de trouver un peu de temps à consacrer au social. Cérémonies de mariage, baptêmes, sans compter les décès. Ce serait en allant aux gens qu’elle avait le plus de chance de trouver le mari qu’il lui fallait. L’effet de sa transformation ne tarda pas à se manifester. Elle eut un, puis deux vrais amis dans le milieu masculin, ce qui contribua à la rendre moins rigide avec les hommes.
Dans son service beaucoup lui avouèrent qu’ils ne la croyaient pas capable de s’humaniser. Oumouba devenait de plus en plus sociable et par conséquent, je la voyais moins. Je ne lui en tenais pas rigueur car cela prouvait qu’elle s’adaptait. Un jour cependant elle vint me voir pour me révéler qu’elle pensait être amoureuse d’un homme. Seul inconvénient, il était marié. Mais, et cela Oumouba le dit avec un air triomphant, sa femme n’avait pas d’enfant. Je douchais l’enthousiasme de ma jeune amie en lui disant que ce n’était pas ce qu’il lui fallait, surtout après qu’elle m’eut dit le nom de son élu. J’entrepris de la convaincre. Je lui dis d’abord de ne pas faire la bêtise de tomber enceinte des œuvres de son amant. Un enfant ne l’aiderait pas à s’attacher cet homme et ne pousserait pas ce dernier au divorce. Oumouba sursauta en entendant cela et je compris que j’avais mis dans le doigt sur son plan secret. Ensuite, je la dissuadais d’entrer en concurrence avec la femme de son amant. Cela ne lui amènerait que des tourments. Elle se torturerait chaque jour en imaginant "son" homme dans les bras d’une autre. Enfin je lui exposai le dossier de Idrissa, l’homme qu’elle aimait et que tout Bamako connaissait. C’était un bourreau de cœur sans scrupules et un homme qui nourrissait en outre une très haute opinion de lui-même.
Au bout de ma démonstration, je commis la maladresse de suggérer à Oumouba le nom d’un ingénieur géologue, un brave type qui s’appelait Zoumana et que j’avais repéré pour elle. Ma maladresse fut de le proposer alors que je n’avais pas du tout convaincu Oumouba de renoncer à Idrissa. Je crois que ce fut de cette conversation que naquit la distance que Oumouba prit vis-à-vis de moi. Elle cessa en effet de me fréquenter, jugeant que je n’étais pas de son côté. Deux mois après, ma sœur Aïnana vint me faire part du mariage de sa copine. La nouvelle me fit mal, car je restais persuadée que Oumouba avait fait le mauvais choix.
Trois ans après, toute fierté bue, elle vint me trouver pour me relater le calvaire qu’elle avait vécu pendant plus d’un an, mais ça je préfère que ce soit elle-même qui le raconte". Comme l’assistance tournait le regard vers Oumouba, cette dernière entama d’une voix hésitante son récit. "Mâh a bien posé le problème et je dois avouer que je me suis complètement trompée sur le compte de Idrissa. Au moment où nous nous marions mon amant m’avait caché que, contrairement à ce qu’il m’avait raconté au début de nos relations, sa femme était enceinte d’un mois. Si bien que j’étais ridicule de considérer mon mariage comme un défi à ma coépouse. Mais Idrissa de toutes façons me comblait comme amant d’abord, puis comme époux. J’avais volontairement omis de dire à Mâh que nous vivions déjà une grande passion charnelle au moment où je vins l’entretenir de mon problème. Je crois que ce fut de cette passion que naquit mon esprit de compétition. J’étais égoïste, mais en amour qui ne l’est pas ? Le fait de vivre sous des toits différents exacerbait davantage mes appétits sexuels. Quand je n’étais pas de nuitée, mon humeur massacrante se ressentait au service. Mon planton se risqua à me faire la remarque et au lieu de le punir pour son impertinence, je pris l’homme comme confident. Lorsque je tombais en état de grossesse ce fut le même planton qui me révéla que j’aurai une fille.
Quelques mois après, il me dit que ma coépouse aurait un garçon. J’étais si anéantie que ce jour-là je restai tard au bureau à pleurer sur mon sort. J’ignorais en effet à ce moment-là que ma rivale était en état de grossesse. Mon époux me le confirma sans sourciller le lendemain, en ajoutant cyniquement que Assa (ma coépouse) était "en avance d’un mois" sur moi. Je mesurai alors toute sa duplicité et je me reprochais amèrement d’avoir été aveuglée à ce point. Assa accoucha comme prévu d’un garçon et le jour du baptême, mes belles-mères et mes belles-sœurs m’exhortèrent à suivre son exemple. Quand ma fille vint au monde, ces mégères ne se privèrent pas de me faire part de leur déception, et cela de la manière la plus méchante qui soit. Mon mari, comme attendu, se rapprocha davantage de Assa. Ses passages chez moi étaient toujours prétextes à dispute et le ton montait de plus en plus entre nous sans que je ne me rende compte.
Le boycott au lit- Un soir il me gifla et par réflexe je répliquai. Alors il entreprit en représailles de me bouder au lit. J’étais mortifiée, mais ma fierté ne me permit pas de lui présenter des excuses. Moi, je voulais qu’on s’explique et qu’on se demande pardon réciproquement. Idrissa n’était pas prêt à cela. Il jugeait que c’était lui l’offensé. Sa bouderie vira au boycott total. Je subis cette situation d’indifférence conjugale pendant quatorze mois avant de craquer. Je vins voir Mâh qui me conseilla le divorce. Mais pour moi, quitter mon ménage était une sorte de capitulation. J’essayai donc de reculer cette échéance.
Après avoir rassemblé mon courage je fis appel à un oncle de Drissa et à un Imam pour prier mon époux de m’excuser. Ce qu’il fit du bout des lèvres, mais son comportement ne changea guère. Mon travail se ressentait du délaissement de celui, qui n’était mon mari que de nom depuis vingt mois. Finalement au bout de deux ans et trois mois je me résolus à demander le divorce, que je n’eu aucun mal à obtenir. Inutile de vous dire que c’est une femme vexée et sans doute marquée à jamais par le détachement de son mari que vous avez devant vous". Sa voix se brisa en prononçant cette dernière phrase.
La troisième femme qui était avec nous lui vint en aide et traita Idrissa de "criminel". La gifle, dira-t-elle, n’a été qu’un prétexte pour faire ses quatre volontés. "En homme responsable, fulmina-t-elle, Idrissa aurait du le lendemain divorcer de Oumouba au lieu de la garder pendant deux ans et lui faire connaître les affres du détachement. Ce que notre amie n’ose pas dire, c’est qu’au début le manque de rapports conjugaux a perturbé son équilibre physiologique. Il lui était arrivé durant ces premiers mois d’avoir des rêves humides. Son mari se doutait bien qu’elle n’avait pas un caractère volage, sinon il se serait comporté différemment. Oumouba fut obligée de demander une mutation dans un autre service. Heureusement qu’on le lui accorda, car comment aurait-elle pu supporter jour après jour les regards inquisiteurs des agents qu’elles contrôlaient ? En tout cas, voilà cinq ans qu’elle vit encore divorcée, pas du tout prête à recommencer malgré les sollicitations de certains prétendants. Ses parents eux désespèrent définitivement de la voir un jour remariée. Ils n’ont peut-être pas tort.
Oumouba commence tout juste à se remettre des deux rudes épreuves qu’elle a traversées : celle d’amante battue et celle d’épouse délaissée". Mâh, elle, continuait de s’en vouloir de n’avoir pas pu protéger Oumouba d’une erreur fatale : "En devenant l’amante régulière d’un homme avant le mariage, une femme perd beaucoup de son objectivité de jugement. Je m’étais douté un peu de l’attachement charnel de Oumouba à Idrissa, même si elle ne m’en avait pas parlé. Une femme comblée au lit réussit difficilement à cacher son rayonnement intérieur. Je l’ai sentie, voilà pourquoi je l’ai dissuadée d’épouser Idrissa. J’aurais du lui dire sans prendre de gants qu’elle n’était plus elle-même, qu’elle était incapable de lucidité. Quand je pense qu’à trente-sept ans, la vie sentimentale de Oumouba n’a été qu’un désastre de bout en bout, je me dis que quelque part il finira bien par y avoir une justice pour qu’elle connaisse enfin le bonheur".
Un beau père humilié ? Notre petit groupe philosopha longuement sur le cas de Oumouba. Un cas qui rappelait que ce n’était pas seulement les "générations sacrifiées", les femmes données en mariage sans leur consentement, qui souffraient du poids des préjugés des us et coutumes, qui donnaient raison à l’homme dans presque toutes les situations. Oumouba, l’intellectuelle, avait payé cher son amour-propre qui l’avait empêché de repentir immédiatement. Elle avait surtout payé cher son réflexe de rendre à son mari la gifle de celui-ci. Toutes ses amies le lui avaient d’ailleurs reproché. Une gifle, disaient-elles, n’avait jamais tué personne.
Par contre sa réaction lui avait valu la réputation de : "tiè bogo muso" (une femme qui frappe l’homme). La rumeur avait amplifié son geste et maintenant elle était étiquetée à vie dans une société qui acceptait mal ce genre de comportement. Qui se risquerait à se lier à une : "muso kulusi tigi" (une femme portant culotte). Quand on veut tuer son chien on l’accuse de rage. Comme Oumou se suffit largement à elle-même, les méchantes langues ont dit que c’est justement son statut de privilégiée, qui lui permet de se montrer aussi effrontée. Dans le petit groupe de mes interlocutrices, on se montrait solidaire des malheurs de la jeune femme en affirmant "Baa mana dégun a bè kinii kè" (Mettez une chèvre aux abois, elle pourrait alors mordre).
Notre parenthèse philosophique menaçait de se prolonger, Mâh se chargea donc de nous ramener à nos moutons en donnant la parole à la seconde jeune femme, Nènè, pas très belle mais bien faite physiquement. "J’ai connu, commença-t-elle, mon mari Bamo, très jeune il y a près de vingt ans. Nous nous sommes mariés presque aussitôt, mais quand il a perdu son emploi, sept ans plus tard, il demanda ma bénédiction pour aller à l’aventure tenter sa chance, tout en me promettant de me faire venir avec mes deux enfants si tout marchait bien là-bas. J’ai attendu cinq longues années dans sa famille avant qu’il daigne se manifester.
Il revenait de l’Afrique de l’est avec un pécule, qui lui permit de nous acheter un toit et surtout de mettre de l’argent en banque pour nous, afin que nous ne soyons plus à la charge des autres. Il resta cinq mois, le temps que tout cela s’arrange comme il le voulait. Je tombais en état de grossesse durant la période. Mais avant mon accouchement, Bamo me dit qu’il devait repartir. Je fus désappointée d’apprendre qu’il avait laissé deux noms à ses parents selon que mon enfant serait une fille ou un garçon.
Pour moi, cela ne présageait rien de bon. J’eus une fille, ce qui, après les deux premiers garçons, fut accueilli avec joie dans la famille. Quatre années passèrent sans que Bamo ne se manifeste. Notre trésor en banque, vous l’imaginez, s’était épuisé. J’entrepris un petit commerce pour faire vivre mes enfants au lieu d’aller solliciter toujours de l’argent dans sa famille. J’expliquai mes projets à ma belle-mère dont je reçus l’aval pour mes activités. Quelle ne fut ma surprise un jour d’apprendre que Bamo était venu entre deux avions dire bonjour à ses parents. Il s’était rendu à l’école pour voir les enfants et aux dires de sa mère, il avait laissé de l’argent à son frère pour que celui-ci me le remette. J’étais morte de rage et de honte, surtout que dans mon entourage tout le monde apprit ma mésaventure. Mon beau-frère vint à la maison me donner trois millions en liquide. Mais l’argent pour moi à ce moment-là importait moins que de voir mon époux, ne serait-ce que quelques secondes. J’essayais de me consoler en me disant que ses deux fils l’avaient vu.
Mais les larmes me revenaient aux yeux dès que je me rappelais qu’il était reparti sans venir voir ma fille de quatre ans, sa "batogoma" (l’homonyme de sa mère). Quelques mois après, j’appris que c’était cinq millions qu’il avait laissés à son frère pour moi, et non trois. Fort heureusement, je ne m’étais pas contentée de dépenser mon argent jusqu’à épuisement des fonds. J’avais ouvert une boutique au grand marché et je la tenais avec un de mes frères.
Comme mon commerce prospérait, je m’abstins de faire du scandale à propos des deux millions escamotés. Ma belle-mère d’ailleurs m’en dissuada en invoquant la nécessité de préserver l’unité de la famille. Je savais que dans son intervention entrait une grande part de faiblesse pour son fils fautif, mais je ne poussai pas plus loin l’affaire. J’en fus mal récompensée. J’appris un peu plus tard que les gens jasaient sur mon compte et liaient la relative prospérité de mes affaires aux supposées faveurs que j’accorderais à certains grossistes et même à des clients. Ma belle-mère, que j’allais voir chaque matin de bonne heure, s’était gardée de me rapporter ces ragots, mais elle y prêtait attention. Je constatais qu’elle n’était plus aussi chaleureuse avec moi qu’auparavant.
Le jour où je lui fis gentiment la remarque, elle se limita à me dire que : « les temps ne sont plus pareils pour la même personne". Le sous-entendu me révolta et ma première impulsion fut d’espacer mes visites dans ma belle-famille. Mais après m’être calmée, je me rendis compte que cela aurait été une terrible erreur de ma part. Je poursuivais donc mon commerce et avec mes bénéfices j’achetais une bâchée pour faire du transport. Là encore, Dieu merci, cela marchait bien. Mais mon principal problème restait intact. Un jour mon beau-père me fit appeler et sans prendre de gants, il critiqua ma manière de vivre, allant jusqu’à sous-entendre que j’étais une épouse légère.
Les hurlements que je laissai échapper ameutèrent le voisinage. Je pris à témoin les gens accourus de ma bonne foi et jurai que Bamo était le seul homme que j’avais connu dans ma vie et qu’il resterait le seul. Mes protestations d’innocence laissèrent mes beaux-parents entièrement insensibles. Alors je décidai de débrider une bonne fois l’abcès. Le lendemain je me fis accompagner par l’imam du quartier et en présence de mon beau-père, je demandai à la personnalité religieuse au nom de Dieu qui nous voyait tous, d’être le témoin de ma fidélité et de la fausseté des accusations que ma belle-famille laissait courir sur moi. Je crois que ma sincérité toucha l’homme de Dieu. Mais mon beau-père prit très mal le fait que je l’avais : « fait asseoir dans le djô ». Il ne me le pardonna pas jusqu’à sa mort qui interviendra quelques mois après. Mon mari arriva pour les obsèques et je le sentis distant quand nous nous sommes trouvés face à face. Je mis cela au compte du deuil qui le frappait, mais huit mois plus tard son comportement n’avait pas changé. Nous dormions dans le même lit, mais il se gardait de me toucher. Je n’osais démentir mes amies, qui me chahutaient gentiment en disant que j’avais repris les habitudes de la chambre nuptiale. Si elles savaient la vérité ! J’eus beau me plier en quatre pour faire plaisir à Bamo, je ne percevais rien d’amical dans son comportement. Au départ je passais mon temps à lui faire un compte-rendu par le menu de mes affaires. Il m’écoutait d’une oreille distraite et j’arrêtai assez vite ces monologues qui semblaient l’ennuyer. Plusieurs fois je lui posais et reposais la question de savoir ce qui n’allait pas entre nous. "Rien", se bornait-il de répondre. Mais la situation pour moi devenait de moins en moins tenable.
Mon époux en était arrivé à me rendre mes salutations sur le bout des lèvres. Comme je ne lui connaissais pas d’amis intimes à qui je puisse me confier, je ne savais pas par quel moyen rétablir la communication entre nous. Un jour il me demanda à brûle-pourpoint si j’avais les papiers de la maison établis à l’époque à mon nom.
Cette question me fit comprendre que je n’avais plus de mari. Bamo était devenu un simple étranger qui dormait dans mon lit. Un de mes clients vint un jour me demander si ça marchait bien dans notre couple. Comme sa question me prenait au dépourvu, il avoua savoir que depuis quelques mois mon époux menait dans mon dos sa petite enquête. Bizarrement la nouvelle me soulagea. Pour moi, le soupçon était la chose la plus difficile à supporter et je savais qu’au bout de ses investigations Bamo ne trouverait absolument rien à me reprocher. Mes espoirs de voir notre couple se rapprocher s’estompèrent assez vite. Je m’aperçus que l’absence de preuves au lieu de rassurer mon mari l’exaspérait. Il voulait que je sois coupable et seul l’intéressait ce qui allait dans le sens de sa conviction. Il resta environ un an et demi avant de s’en aller.
Une cruelle bouderie- Je peux vous dire que j’ai plus souffert pendant ce laps de temps que durant les neuf précédentes années de son absence. Il m’arrivait de me réveiller en sueur certaines nuits au sortir de rêves érotiques très intenses. A ces moments je regardais l’homme, qui était mon mari mais qui dormait à mes côtés, plus inerte qu’un morceau de bois. Ma frustration était si intense que j’en avais des douleurs au bas-ventre. Le plus dur était qu’à l’époque j’espérais toujours que le déclic entre nous se produirait à l’improviste une nuit et qu’il fallait alors que Bamo me trouve dans les meilleures dispositions. Donc avant de me coucher, je buvais beaucoup d’eau chaude au "babili" ou au "gongolili", histoire d’être accueillante pour mon mari si l’envie lui venait. Mais Bamo par son détachement tuait ma libido et l’attente non récompensée a fait de moi une femme comme desséchée de l’intérieur, sans élan et presque sans appétit.
Je ne sais pas si un jour je pourrai retrouver mon ardeur entre les bras d’un homme. Bamo est revenu l’année dernière et nous avons conclu un divorce à l’amiable. Le jour où fut prononcée notre séparation, il passa aux aveux. Mais ce fut devant Mâh qu’il fit ces révélations. Il lui confia qu’il s’était marié deux ans après être parti. Sa femme de "là-bas" lui avait donné une fille. La fortune de la seconde épouse était considérable, suffisamment en tous les cas pour qu’il ait fait le choix de se fixer en exil. Bamo avoua aussi qu’il m’avait longtemps tenu rigueur pour avoir fait prendre son père en flagrant délit de diffamation. Le vieux qui l’avait fait venir un peu avant sa mort s’était plaint de ma démarche auprès de l’Imam. Bamo lui jura de me faire payer mon outrecuidance et de me "maudire". En quelque sorte le vieux en mourant m’avait enterrée et son fils restait prisonnier du serment qu’il avait fait au défunt. Des érudits auraient pu lui indiquer par quelle voie il aurait pu se délier d’un engagement qui n’était pas irréversible. Mais Bamo lui-même reconnaissait avoir accumulé beaucoup trop de torts à mon égard pour que nous puissions reprendre notre vie commune.
Mon ex-mari avait ce jour-là soulagé sa conscience. Il me souhaita de bien prendre soin de nos enfants et pour cela il m’épaulerait autant que je le voudrais. Il savait qu’en partant cette fois-ci il y avait peu de chance qu’il revienne un jour, et il avait pris soin de garnir mon compte en banque. Quand ma grande sœur me rapporta cette longue confession, je l’envoyais à mon tour pour le supplier de venir me redire son repentir dans notre lit malgré que le divorce ait été prononcé. Bamo promit de le faire, mais il ne vint pas, sans doute pour une question de fierté. J’ai souffert du détachement de Bamo, mais il restera toujours mon mari et je ne désespère pas de le revoir un jour. Car j’ai la conviction que notre histoire ne peut s’achever ainsi.
Un homme n’a pas le droit de tirer de la sorte un trait sur sa vie", acheva Nènè, les larmes aux yeux. Mâh lui vint en aide en l’amenant dans sa chambre. Quand elles revinrent s’installer, tout le petit groupe s’employa à remonter le moral de Nènè. Bien que nous tous nous lui conseillions de garder courage car Dieu veille sur les innocentes, Nènè fut incapable de se détendre. Personnellement, en tant qu’homme, je ne me sentais pas très fier après avoir entendu le récit des malheurs de la jeune femme. Mâh sentit mon malaise et elle s’engouffra sans hésiter dans la brèche. Pendant cinq bonnes minutes elle se défoula en critiquant "ces hommes" briseurs de bonheur et dont les femmes sont obligées de subir en silence les colères, les caprices et les trahisons.
Dans notre société, dit-elle, la liberté est une notion qui fonctionne à deux vitesses. Au mâle, la liberté de disposer. A la femme, la liberté de subir. Certains mâles ne vont-ils pas jusqu’à dire qu’en s’engageant dans le mariage, une épouse abdique de ses droits en faveur de son époux ? Ces mêmes présentent le plaisir comme un luxe dans la vie en ménage. Pas étonnant, conclut Mâh, que la famille se dégrade et que les mœurs soient de plus en plus dissolues. Car lorsque la femme frustrée découvre des horizons dont elle ne se doutait pas, elle les explore avec ravissement. Exactement comme un aveugle à qui sont révélées les couleurs. A ce moment le glas sonne pour les brutaux, les égoïstes et les mollassons. Mâh était sans doute trop véhémente dans son diagnostic, mais elle n’avait pas tout à fait tort.
(à suivre)
vendredi 7 octobre 2011
Il faut le reconnaître, l’homme est par essence égoïste lorsque son plaisir est en jeu. Il sait aussi se montrer ingrat, même avec celles qui lui ont donné les plus beaux moments de sa vie. Il est très souvent prompt à jeter la pierre à sa compagne dès lors que disparaît l’attrait physique et que chancelle l’entente dans le couple. Très souvent par sa faute naissent des situations conflictuelles alors qu’un brin de délicatesse, un soupçon de compréhension, un grain de tendresse auraient suffi pour réparer les déchirures de l’amour blessé.
Les femmes font elles aussi des écarts, mais elles sont en général plus victimes que coupables. Cependant lorsqu’elles jugent avoir suffisamment encaissé, il leur arrive de se venger de la manière la plus impitoyable qui soit et le retour de flamme est souvent dévastateur pour l’homme. Les cas que nous allons aborder aujourd’hui offrent des situations très diverses de femmes traumatisées. Ils me furent donnés lors d’une rencontre chez ma vieille amie (et votre vieille connaissance) Mâh. C
e jour là, je l’avais trouvée en compagnie de deux jeunes femmes. La première, Oumouba, ne m’était pas totalement inconnue. Nous nous étions déjà rencontrés dans des cérémonies sociales, mais sans avoir eu le temps de vraiment bavarder. C’était une belle femme d’une quarantaine d’années et sa robe largement décolletée laissait suggérer un corps agréablement épanoui.
En outre son teint soigneusement entretenu et son allure élégamment nonchalante en disaient long sur la peine qu’elle prenait pour bien paraître. Mâh mit fin à mes supputations intérieures en me la présentant comme une amie à sa petite sœur. Elle enchaîna sur le récit des mésaventures de cette dame. Oumouba avait fait de solides études en Belgique et possédait une maîtrise en gestion d’entreprise. Elle avait également travaillé dans une société en Europe pour se constituer son trousseau. Mais si professionnellement elle avait su bien mener sa barque, sur le plan sentimental, ce fut tout autre chose.
La jeune femme s’était d’abord mise en ménage avec un Camerounais dont elle s’aperçut bien vite de l’insupportable brutalité. Oumouba tint pourtant trois longues années et elle finit par se séparer de son compagnon, ne pouvant plus accepter d’être le défouloir d’un incorrigible buveur. M’Bikap, c’était son nom, n’était pas un homme foncièrement méchant, mais il était impossible de le faire renoncer à l’alcool, qui était à la base de ses déchaînements de violence. Quand Oumouba rompit avec son bourreau, elle envisagea de rentrer au pays.
Les appuis dont jouissait un de ses beaux-frères lui ouvrirent des perspectives intéressantes dans la fonction publique. Mais habituée aux salaires européens, la jeune femme ne pouvait se faire à la maigreur des rétributions maliennes. L’insistance de ses parents et la déception née de sa séparation avec M’Bikap l’incitèrent pourtant à "faire le saut" et à fermer les yeux sur le niveau désespérément bas des revenus qui l’attendaient. Au départ Oumouba voulut garder une indépendance totale vis-à-vis de sa famille. Pour y parvenir elle s’acheta une villa derrière le fleuve qu’elle meubla à son goût, fit venir sa petite voiture et commença à travailler dans un service financier où elle occupa très vite des fonctions de chef de personnel. Une compétition de grossesse- Oumouba s’était donnée comme ligne de conduite de maintenir une certaine réserve vis-à-vis des hommes. Pour elle, la distance ainsi marquée lui assurerait le respect de ses collègues et de ses interlocuteurs administratifs. En outre, mis à part cet argument "professionnel", la jeune femme encore échaudée par sa première expérience de vie commune, gardait de très forts préjugés contre les hommes.
Elle ne se rendait pas compte que la cuirasse qu’elle s’était forgée effarouchait même les prétendants animés de bonnes intentions à son égard. Elle était devenue la "muso kalan né" (femme instruite) pour laquelle le mâle malien n’a habituellement pas beaucoup de sympathie. Trois années passèrent et la solitude commença à peser sur Oumouba, sans compter que sa mère et ses tantes se désolaient de la voir devenir petit à petit vieille fille. "Ce fut à cette époque que ma petite sœur me l’amena, poursuivit Mâh. J’entrepris de lui permettre d’avoir une vision moins négative des hommes. Au départ Oumouba voulait un mari à elle seule, un homme courtois, doux, attachant et très instruit. Je lui dis sans ambages que cet oiseau-là ne courait pas les rues dans notre pays et qu’elle devait accepter de laisser tomber ses critères de "toubabesse".
Oumouba me fréquentait assidûment et je sentais qu’elle me faisait confiance pour lui trouver un compagnon, qui se rapprocherait de son idéal. Pour cela, je lui conseillais de commencer par ressembler d’abord à une Malienne. Elle devait notamment varier sa garde-robe, celle-ci était en effet constituée uniquement d’habits européens. En prenant le style local, elle intimiderait moins les hommes qui voulaient faire sa connaissance. Ensuite, je lui conseillai de trouver un peu de temps à consacrer au social. Cérémonies de mariage, baptêmes, sans compter les décès. Ce serait en allant aux gens qu’elle avait le plus de chance de trouver le mari qu’il lui fallait. L’effet de sa transformation ne tarda pas à se manifester. Elle eut un, puis deux vrais amis dans le milieu masculin, ce qui contribua à la rendre moins rigide avec les hommes.
Dans son service beaucoup lui avouèrent qu’ils ne la croyaient pas capable de s’humaniser. Oumouba devenait de plus en plus sociable et par conséquent, je la voyais moins. Je ne lui en tenais pas rigueur car cela prouvait qu’elle s’adaptait. Un jour cependant elle vint me voir pour me révéler qu’elle pensait être amoureuse d’un homme. Seul inconvénient, il était marié. Mais, et cela Oumouba le dit avec un air triomphant, sa femme n’avait pas d’enfant. Je douchais l’enthousiasme de ma jeune amie en lui disant que ce n’était pas ce qu’il lui fallait, surtout après qu’elle m’eut dit le nom de son élu. J’entrepris de la convaincre. Je lui dis d’abord de ne pas faire la bêtise de tomber enceinte des œuvres de son amant. Un enfant ne l’aiderait pas à s’attacher cet homme et ne pousserait pas ce dernier au divorce. Oumouba sursauta en entendant cela et je compris que j’avais mis dans le doigt sur son plan secret. Ensuite, je la dissuadais d’entrer en concurrence avec la femme de son amant. Cela ne lui amènerait que des tourments. Elle se torturerait chaque jour en imaginant "son" homme dans les bras d’une autre. Enfin je lui exposai le dossier de Idrissa, l’homme qu’elle aimait et que tout Bamako connaissait. C’était un bourreau de cœur sans scrupules et un homme qui nourrissait en outre une très haute opinion de lui-même.
Au bout de ma démonstration, je commis la maladresse de suggérer à Oumouba le nom d’un ingénieur géologue, un brave type qui s’appelait Zoumana et que j’avais repéré pour elle. Ma maladresse fut de le proposer alors que je n’avais pas du tout convaincu Oumouba de renoncer à Idrissa. Je crois que ce fut de cette conversation que naquit la distance que Oumouba prit vis-à-vis de moi. Elle cessa en effet de me fréquenter, jugeant que je n’étais pas de son côté. Deux mois après, ma sœur Aïnana vint me faire part du mariage de sa copine. La nouvelle me fit mal, car je restais persuadée que Oumouba avait fait le mauvais choix.
Trois ans après, toute fierté bue, elle vint me trouver pour me relater le calvaire qu’elle avait vécu pendant plus d’un an, mais ça je préfère que ce soit elle-même qui le raconte". Comme l’assistance tournait le regard vers Oumouba, cette dernière entama d’une voix hésitante son récit. "Mâh a bien posé le problème et je dois avouer que je me suis complètement trompée sur le compte de Idrissa. Au moment où nous nous marions mon amant m’avait caché que, contrairement à ce qu’il m’avait raconté au début de nos relations, sa femme était enceinte d’un mois. Si bien que j’étais ridicule de considérer mon mariage comme un défi à ma coépouse. Mais Idrissa de toutes façons me comblait comme amant d’abord, puis comme époux. J’avais volontairement omis de dire à Mâh que nous vivions déjà une grande passion charnelle au moment où je vins l’entretenir de mon problème. Je crois que ce fut de cette passion que naquit mon esprit de compétition. J’étais égoïste, mais en amour qui ne l’est pas ? Le fait de vivre sous des toits différents exacerbait davantage mes appétits sexuels. Quand je n’étais pas de nuitée, mon humeur massacrante se ressentait au service. Mon planton se risqua à me faire la remarque et au lieu de le punir pour son impertinence, je pris l’homme comme confident. Lorsque je tombais en état de grossesse ce fut le même planton qui me révéla que j’aurai une fille.
Quelques mois après, il me dit que ma coépouse aurait un garçon. J’étais si anéantie que ce jour-là je restai tard au bureau à pleurer sur mon sort. J’ignorais en effet à ce moment-là que ma rivale était en état de grossesse. Mon époux me le confirma sans sourciller le lendemain, en ajoutant cyniquement que Assa (ma coépouse) était "en avance d’un mois" sur moi. Je mesurai alors toute sa duplicité et je me reprochais amèrement d’avoir été aveuglée à ce point. Assa accoucha comme prévu d’un garçon et le jour du baptême, mes belles-mères et mes belles-sœurs m’exhortèrent à suivre son exemple. Quand ma fille vint au monde, ces mégères ne se privèrent pas de me faire part de leur déception, et cela de la manière la plus méchante qui soit. Mon mari, comme attendu, se rapprocha davantage de Assa. Ses passages chez moi étaient toujours prétextes à dispute et le ton montait de plus en plus entre nous sans que je ne me rende compte.
Le boycott au lit- Un soir il me gifla et par réflexe je répliquai. Alors il entreprit en représailles de me bouder au lit. J’étais mortifiée, mais ma fierté ne me permit pas de lui présenter des excuses. Moi, je voulais qu’on s’explique et qu’on se demande pardon réciproquement. Idrissa n’était pas prêt à cela. Il jugeait que c’était lui l’offensé. Sa bouderie vira au boycott total. Je subis cette situation d’indifférence conjugale pendant quatorze mois avant de craquer. Je vins voir Mâh qui me conseilla le divorce. Mais pour moi, quitter mon ménage était une sorte de capitulation. J’essayai donc de reculer cette échéance.
Après avoir rassemblé mon courage je fis appel à un oncle de Drissa et à un Imam pour prier mon époux de m’excuser. Ce qu’il fit du bout des lèvres, mais son comportement ne changea guère. Mon travail se ressentait du délaissement de celui, qui n’était mon mari que de nom depuis vingt mois. Finalement au bout de deux ans et trois mois je me résolus à demander le divorce, que je n’eu aucun mal à obtenir. Inutile de vous dire que c’est une femme vexée et sans doute marquée à jamais par le détachement de son mari que vous avez devant vous". Sa voix se brisa en prononçant cette dernière phrase.
La troisième femme qui était avec nous lui vint en aide et traita Idrissa de "criminel". La gifle, dira-t-elle, n’a été qu’un prétexte pour faire ses quatre volontés. "En homme responsable, fulmina-t-elle, Idrissa aurait du le lendemain divorcer de Oumouba au lieu de la garder pendant deux ans et lui faire connaître les affres du détachement. Ce que notre amie n’ose pas dire, c’est qu’au début le manque de rapports conjugaux a perturbé son équilibre physiologique. Il lui était arrivé durant ces premiers mois d’avoir des rêves humides. Son mari se doutait bien qu’elle n’avait pas un caractère volage, sinon il se serait comporté différemment. Oumouba fut obligée de demander une mutation dans un autre service. Heureusement qu’on le lui accorda, car comment aurait-elle pu supporter jour après jour les regards inquisiteurs des agents qu’elles contrôlaient ? En tout cas, voilà cinq ans qu’elle vit encore divorcée, pas du tout prête à recommencer malgré les sollicitations de certains prétendants. Ses parents eux désespèrent définitivement de la voir un jour remariée. Ils n’ont peut-être pas tort.
Oumouba commence tout juste à se remettre des deux rudes épreuves qu’elle a traversées : celle d’amante battue et celle d’épouse délaissée". Mâh, elle, continuait de s’en vouloir de n’avoir pas pu protéger Oumouba d’une erreur fatale : "En devenant l’amante régulière d’un homme avant le mariage, une femme perd beaucoup de son objectivité de jugement. Je m’étais douté un peu de l’attachement charnel de Oumouba à Idrissa, même si elle ne m’en avait pas parlé. Une femme comblée au lit réussit difficilement à cacher son rayonnement intérieur. Je l’ai sentie, voilà pourquoi je l’ai dissuadée d’épouser Idrissa. J’aurais du lui dire sans prendre de gants qu’elle n’était plus elle-même, qu’elle était incapable de lucidité. Quand je pense qu’à trente-sept ans, la vie sentimentale de Oumouba n’a été qu’un désastre de bout en bout, je me dis que quelque part il finira bien par y avoir une justice pour qu’elle connaisse enfin le bonheur".
Un beau père humilié ? Notre petit groupe philosopha longuement sur le cas de Oumouba. Un cas qui rappelait que ce n’était pas seulement les "générations sacrifiées", les femmes données en mariage sans leur consentement, qui souffraient du poids des préjugés des us et coutumes, qui donnaient raison à l’homme dans presque toutes les situations. Oumouba, l’intellectuelle, avait payé cher son amour-propre qui l’avait empêché de repentir immédiatement. Elle avait surtout payé cher son réflexe de rendre à son mari la gifle de celui-ci. Toutes ses amies le lui avaient d’ailleurs reproché. Une gifle, disaient-elles, n’avait jamais tué personne.
Par contre sa réaction lui avait valu la réputation de : "tiè bogo muso" (une femme qui frappe l’homme). La rumeur avait amplifié son geste et maintenant elle était étiquetée à vie dans une société qui acceptait mal ce genre de comportement. Qui se risquerait à se lier à une : "muso kulusi tigi" (une femme portant culotte). Quand on veut tuer son chien on l’accuse de rage. Comme Oumou se suffit largement à elle-même, les méchantes langues ont dit que c’est justement son statut de privilégiée, qui lui permet de se montrer aussi effrontée. Dans le petit groupe de mes interlocutrices, on se montrait solidaire des malheurs de la jeune femme en affirmant "Baa mana dégun a bè kinii kè" (Mettez une chèvre aux abois, elle pourrait alors mordre).
Notre parenthèse philosophique menaçait de se prolonger, Mâh se chargea donc de nous ramener à nos moutons en donnant la parole à la seconde jeune femme, Nènè, pas très belle mais bien faite physiquement. "J’ai connu, commença-t-elle, mon mari Bamo, très jeune il y a près de vingt ans. Nous nous sommes mariés presque aussitôt, mais quand il a perdu son emploi, sept ans plus tard, il demanda ma bénédiction pour aller à l’aventure tenter sa chance, tout en me promettant de me faire venir avec mes deux enfants si tout marchait bien là-bas. J’ai attendu cinq longues années dans sa famille avant qu’il daigne se manifester.
Il revenait de l’Afrique de l’est avec un pécule, qui lui permit de nous acheter un toit et surtout de mettre de l’argent en banque pour nous, afin que nous ne soyons plus à la charge des autres. Il resta cinq mois, le temps que tout cela s’arrange comme il le voulait. Je tombais en état de grossesse durant la période. Mais avant mon accouchement, Bamo me dit qu’il devait repartir. Je fus désappointée d’apprendre qu’il avait laissé deux noms à ses parents selon que mon enfant serait une fille ou un garçon.
Pour moi, cela ne présageait rien de bon. J’eus une fille, ce qui, après les deux premiers garçons, fut accueilli avec joie dans la famille. Quatre années passèrent sans que Bamo ne se manifeste. Notre trésor en banque, vous l’imaginez, s’était épuisé. J’entrepris un petit commerce pour faire vivre mes enfants au lieu d’aller solliciter toujours de l’argent dans sa famille. J’expliquai mes projets à ma belle-mère dont je reçus l’aval pour mes activités. Quelle ne fut ma surprise un jour d’apprendre que Bamo était venu entre deux avions dire bonjour à ses parents. Il s’était rendu à l’école pour voir les enfants et aux dires de sa mère, il avait laissé de l’argent à son frère pour que celui-ci me le remette. J’étais morte de rage et de honte, surtout que dans mon entourage tout le monde apprit ma mésaventure. Mon beau-frère vint à la maison me donner trois millions en liquide. Mais l’argent pour moi à ce moment-là importait moins que de voir mon époux, ne serait-ce que quelques secondes. J’essayais de me consoler en me disant que ses deux fils l’avaient vu.
Mais les larmes me revenaient aux yeux dès que je me rappelais qu’il était reparti sans venir voir ma fille de quatre ans, sa "batogoma" (l’homonyme de sa mère). Quelques mois après, j’appris que c’était cinq millions qu’il avait laissés à son frère pour moi, et non trois. Fort heureusement, je ne m’étais pas contentée de dépenser mon argent jusqu’à épuisement des fonds. J’avais ouvert une boutique au grand marché et je la tenais avec un de mes frères.
Comme mon commerce prospérait, je m’abstins de faire du scandale à propos des deux millions escamotés. Ma belle-mère d’ailleurs m’en dissuada en invoquant la nécessité de préserver l’unité de la famille. Je savais que dans son intervention entrait une grande part de faiblesse pour son fils fautif, mais je ne poussai pas plus loin l’affaire. J’en fus mal récompensée. J’appris un peu plus tard que les gens jasaient sur mon compte et liaient la relative prospérité de mes affaires aux supposées faveurs que j’accorderais à certains grossistes et même à des clients. Ma belle-mère, que j’allais voir chaque matin de bonne heure, s’était gardée de me rapporter ces ragots, mais elle y prêtait attention. Je constatais qu’elle n’était plus aussi chaleureuse avec moi qu’auparavant.
Le jour où je lui fis gentiment la remarque, elle se limita à me dire que : « les temps ne sont plus pareils pour la même personne". Le sous-entendu me révolta et ma première impulsion fut d’espacer mes visites dans ma belle-famille. Mais après m’être calmée, je me rendis compte que cela aurait été une terrible erreur de ma part. Je poursuivais donc mon commerce et avec mes bénéfices j’achetais une bâchée pour faire du transport. Là encore, Dieu merci, cela marchait bien. Mais mon principal problème restait intact. Un jour mon beau-père me fit appeler et sans prendre de gants, il critiqua ma manière de vivre, allant jusqu’à sous-entendre que j’étais une épouse légère.
Les hurlements que je laissai échapper ameutèrent le voisinage. Je pris à témoin les gens accourus de ma bonne foi et jurai que Bamo était le seul homme que j’avais connu dans ma vie et qu’il resterait le seul. Mes protestations d’innocence laissèrent mes beaux-parents entièrement insensibles. Alors je décidai de débrider une bonne fois l’abcès. Le lendemain je me fis accompagner par l’imam du quartier et en présence de mon beau-père, je demandai à la personnalité religieuse au nom de Dieu qui nous voyait tous, d’être le témoin de ma fidélité et de la fausseté des accusations que ma belle-famille laissait courir sur moi. Je crois que ma sincérité toucha l’homme de Dieu. Mais mon beau-père prit très mal le fait que je l’avais : « fait asseoir dans le djô ». Il ne me le pardonna pas jusqu’à sa mort qui interviendra quelques mois après. Mon mari arriva pour les obsèques et je le sentis distant quand nous nous sommes trouvés face à face. Je mis cela au compte du deuil qui le frappait, mais huit mois plus tard son comportement n’avait pas changé. Nous dormions dans le même lit, mais il se gardait de me toucher. Je n’osais démentir mes amies, qui me chahutaient gentiment en disant que j’avais repris les habitudes de la chambre nuptiale. Si elles savaient la vérité ! J’eus beau me plier en quatre pour faire plaisir à Bamo, je ne percevais rien d’amical dans son comportement. Au départ je passais mon temps à lui faire un compte-rendu par le menu de mes affaires. Il m’écoutait d’une oreille distraite et j’arrêtai assez vite ces monologues qui semblaient l’ennuyer. Plusieurs fois je lui posais et reposais la question de savoir ce qui n’allait pas entre nous. "Rien", se bornait-il de répondre. Mais la situation pour moi devenait de moins en moins tenable.
Mon époux en était arrivé à me rendre mes salutations sur le bout des lèvres. Comme je ne lui connaissais pas d’amis intimes à qui je puisse me confier, je ne savais pas par quel moyen rétablir la communication entre nous. Un jour il me demanda à brûle-pourpoint si j’avais les papiers de la maison établis à l’époque à mon nom.
Cette question me fit comprendre que je n’avais plus de mari. Bamo était devenu un simple étranger qui dormait dans mon lit. Un de mes clients vint un jour me demander si ça marchait bien dans notre couple. Comme sa question me prenait au dépourvu, il avoua savoir que depuis quelques mois mon époux menait dans mon dos sa petite enquête. Bizarrement la nouvelle me soulagea. Pour moi, le soupçon était la chose la plus difficile à supporter et je savais qu’au bout de ses investigations Bamo ne trouverait absolument rien à me reprocher. Mes espoirs de voir notre couple se rapprocher s’estompèrent assez vite. Je m’aperçus que l’absence de preuves au lieu de rassurer mon mari l’exaspérait. Il voulait que je sois coupable et seul l’intéressait ce qui allait dans le sens de sa conviction. Il resta environ un an et demi avant de s’en aller.
Une cruelle bouderie- Je peux vous dire que j’ai plus souffert pendant ce laps de temps que durant les neuf précédentes années de son absence. Il m’arrivait de me réveiller en sueur certaines nuits au sortir de rêves érotiques très intenses. A ces moments je regardais l’homme, qui était mon mari mais qui dormait à mes côtés, plus inerte qu’un morceau de bois. Ma frustration était si intense que j’en avais des douleurs au bas-ventre. Le plus dur était qu’à l’époque j’espérais toujours que le déclic entre nous se produirait à l’improviste une nuit et qu’il fallait alors que Bamo me trouve dans les meilleures dispositions. Donc avant de me coucher, je buvais beaucoup d’eau chaude au "babili" ou au "gongolili", histoire d’être accueillante pour mon mari si l’envie lui venait. Mais Bamo par son détachement tuait ma libido et l’attente non récompensée a fait de moi une femme comme desséchée de l’intérieur, sans élan et presque sans appétit.
Je ne sais pas si un jour je pourrai retrouver mon ardeur entre les bras d’un homme. Bamo est revenu l’année dernière et nous avons conclu un divorce à l’amiable. Le jour où fut prononcée notre séparation, il passa aux aveux. Mais ce fut devant Mâh qu’il fit ces révélations. Il lui confia qu’il s’était marié deux ans après être parti. Sa femme de "là-bas" lui avait donné une fille. La fortune de la seconde épouse était considérable, suffisamment en tous les cas pour qu’il ait fait le choix de se fixer en exil. Bamo avoua aussi qu’il m’avait longtemps tenu rigueur pour avoir fait prendre son père en flagrant délit de diffamation. Le vieux qui l’avait fait venir un peu avant sa mort s’était plaint de ma démarche auprès de l’Imam. Bamo lui jura de me faire payer mon outrecuidance et de me "maudire". En quelque sorte le vieux en mourant m’avait enterrée et son fils restait prisonnier du serment qu’il avait fait au défunt. Des érudits auraient pu lui indiquer par quelle voie il aurait pu se délier d’un engagement qui n’était pas irréversible. Mais Bamo lui-même reconnaissait avoir accumulé beaucoup trop de torts à mon égard pour que nous puissions reprendre notre vie commune.
Mon ex-mari avait ce jour-là soulagé sa conscience. Il me souhaita de bien prendre soin de nos enfants et pour cela il m’épaulerait autant que je le voudrais. Il savait qu’en partant cette fois-ci il y avait peu de chance qu’il revienne un jour, et il avait pris soin de garnir mon compte en banque. Quand ma grande sœur me rapporta cette longue confession, je l’envoyais à mon tour pour le supplier de venir me redire son repentir dans notre lit malgré que le divorce ait été prononcé. Bamo promit de le faire, mais il ne vint pas, sans doute pour une question de fierté. J’ai souffert du détachement de Bamo, mais il restera toujours mon mari et je ne désespère pas de le revoir un jour. Car j’ai la conviction que notre histoire ne peut s’achever ainsi.
Un homme n’a pas le droit de tirer de la sorte un trait sur sa vie", acheva Nènè, les larmes aux yeux. Mâh lui vint en aide en l’amenant dans sa chambre. Quand elles revinrent s’installer, tout le petit groupe s’employa à remonter le moral de Nènè. Bien que nous tous nous lui conseillions de garder courage car Dieu veille sur les innocentes, Nènè fut incapable de se détendre. Personnellement, en tant qu’homme, je ne me sentais pas très fier après avoir entendu le récit des malheurs de la jeune femme. Mâh sentit mon malaise et elle s’engouffra sans hésiter dans la brèche. Pendant cinq bonnes minutes elle se défoula en critiquant "ces hommes" briseurs de bonheur et dont les femmes sont obligées de subir en silence les colères, les caprices et les trahisons.
Dans notre société, dit-elle, la liberté est une notion qui fonctionne à deux vitesses. Au mâle, la liberté de disposer. A la femme, la liberté de subir. Certains mâles ne vont-ils pas jusqu’à dire qu’en s’engageant dans le mariage, une épouse abdique de ses droits en faveur de son époux ? Ces mêmes présentent le plaisir comme un luxe dans la vie en ménage. Pas étonnant, conclut Mâh, que la famille se dégrade et que les mœurs soient de plus en plus dissolues. Car lorsque la femme frustrée découvre des horizons dont elle ne se doutait pas, elle les explore avec ravissement. Exactement comme un aveugle à qui sont révélées les couleurs. A ce moment le glas sonne pour les brutaux, les égoïstes et les mollassons. Mâh était sans doute trop véhémente dans son diagnostic, mais elle n’avait pas tout à fait tort.
(à suivre)
vendredi 7 octobre 2011
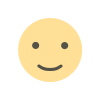 Like
0
Like
0
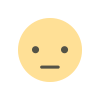 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
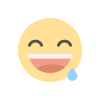 Drôle
0
Drôle
0
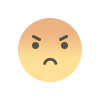 Hmmm
0
Hmmm
0
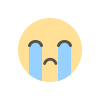 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0