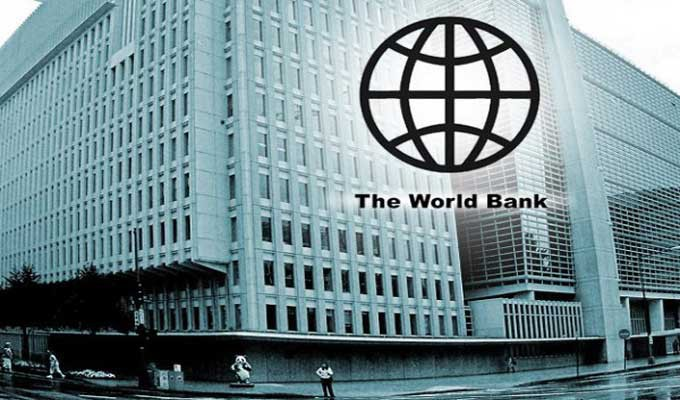Seconde guerre mondiale, 80 ans : Le monde toujours en guerre
Le 2 septembre 1945, le Japon capitulait face aux Alliés, mettant officiellement fin à la Seconde guerre mondiale. Ce jour-là, l’humanité espérait tourner la page d’un conflit qui avait coûté la vie à plus de 50 millions de personnes.

Dans la foulée, les Nations unies voyaient le jour, porteuses d’un idéal : instaurer un ordre mondial fondé sur la paix, la coopération et la souveraineté des peuples. Mais 80 ans plus tard, cette promesse semble s’éloigner.
Loin d’un apaisement global, le XXIe siècle s’est ouvert sur une prolifération de conflits inter et intracommunautaires : guerres civiles, affrontements ethniques, insurrections armées, et violences transfrontalières. Du Moyen-Orient à l’Afrique centrale, de l’Ukraine à la Birmanie, les foyers de tension se multiplient, nourris par des rivalités géopolitiques, des injustices historiques et des fractures sociales non résolues.
Au Sahel, la lutte contre le terrorisme a justifié une décennie d’interventions militaires occidentales, notamment françaises, à travers les opérations Serval et Barkhane. Pourtant, malgré les moyens déployés, les groupes djihadistes se sont enracinés, les États se sont fragilisés, et les populations locales ont payé le prix fort.
Selon les statistiques, en 2023, les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 443 milliards de dollars, soit plus de 6,6 milliards de dollars par jour.
A en croire les mêmes statistiques, les États-Unis ont dépensé 916 milliards de dollars à eux seuls, la Chine a investi 296 milliards de dollars dans son armée, la Russie, en pleine guerre en Ukraine, a consacré 109 milliards de dollars à sa défense.
Face à ces chiffres vertigineux, les fonds alloués au maintien de la paix paraissent dérisoires. Le budget approuvé des opérations de paix des Nations unies pour l’exercice 2021–2022 s’élevait à 6,38 milliards de dollars, soit moins de 0,3 % des dépenses militaires mondiales.
Ce budget finance 12 missions de paix à travers le monde, dont plusieurs en Afrique (Mali, RDC, Soudan du Sud), et couvre les salaires, la logistique, le transport et les technologies nécessaires à la protection des civils et à la stabilisation des zones de conflit.
Depuis la fin de la guerre froide en 1991, avec la dislocation de l’Union soviétique, les puissances occidentales ont multiplié les interventions militaires sous des motifs variés : protection des civils, lutte contre le terrorisme ou défense d’intérêts stratégiques.
L’Irak (2003), la Libye (2011), la Syrie, et même le Nicaragua dans les années 1980, ont vu leurs régimes renversés ou affaiblis par des coalitions internationales, souvent sans mandat clair des Nations unies. Ces interventions, bien que parfois justifiées par des violations des droits humains ou des menaces sécuritaires, ont souvent laissé derrière elles des États en ruines, des sociétés fragmentées et des ressentiments durables.
La question d’une troisième guerre mondiale peut sembler alarmiste, mais elle n’est plus taboue. Des scénarios militaires évoquent une escalade possible entre l’Otan et la Russie, sur fond de guerre en Ukraine, Les États-Unis et la Chine, autour de Taïwan, les États-Unis, la Corée du Nord et l’Iran, autour de l’arme nucléaire ou encore les deux Corées, dont la tension reste vive.
La militarisation de l’intelligence artificielle, de l’espace et des technologies autonomes ajoute une couche d’incertitude à ce paysage déjà instable.
Pourtant, une guerre mondiale n’est pas une fatalité. Elle peut être évitée par une diplomatie multilatérale renforcée, qui dépasse les logiques de blocs, une réforme des institutions internationales, pour mieux représenter les pays du Sud et un une mobilisation citoyenne mondiale, pour exiger des dirigeants qu’ils privilégient la paix à la puissance.
Le 2 septembre 1945 devait être un point final. Il est devenu une virgule dans une histoire toujours en mouvement.
Commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, c’est aussi interroger notre présent pourquoi, malgré les leçons du passé, continuons-nous à reproduire les mêmes erreurs ? Et surtout, que pouvons-nous faire, collectivement, pour que le XXIe siècle ne soit pas celui d’une nouvelle conflagration
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0