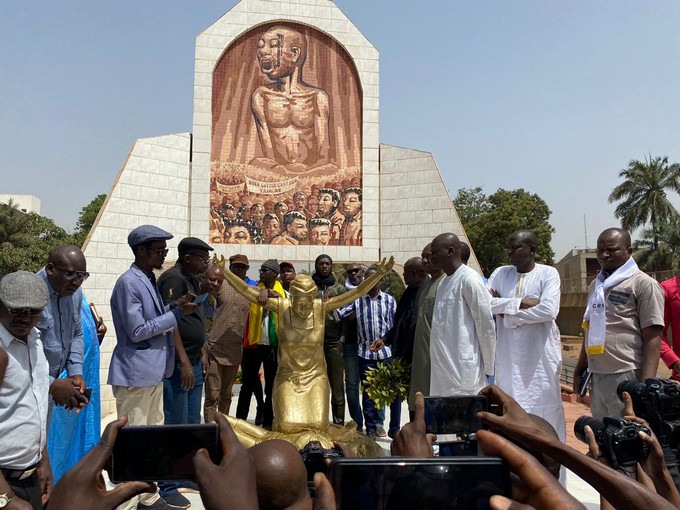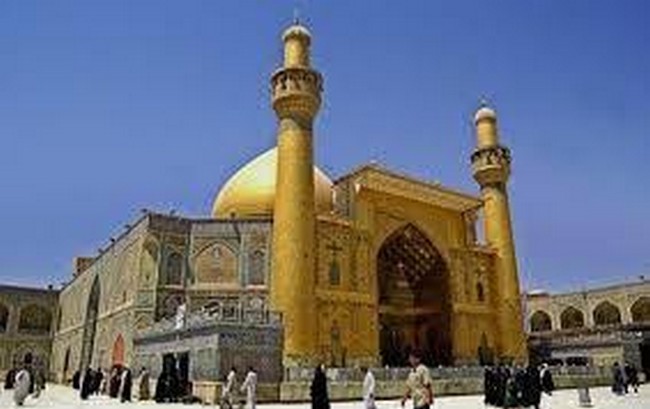Le Maya, pilier oublié de la dignité bamanan
Dans la culture bamanan ou mandingue, le Maya incarne bien plus qu’une simple règle morale : il est l’âme même de l’humanisme, le socle de la civilisation.

Être « humain » n’est pas qu’une question biologique ; c’est une vocation spirituelle, une responsabilité sociale, une exigence de dignité.
Le Maya exige de chacun respect, compassion, retenue dans l’adversité. Il impose à l’homme de traiter sa famille, ses voisins, ses semblables avec amabilité et considération. C’est en vivant selon ces valeurs qu’un individu se montre véritablement digne. La dignité n’est donc pas un ornement, elle est un droit qui se mérite et qui se protège.
Chez les Bamanans, préserver sa dignité signifie préserver aussi celle de sa famille et de sa communauté. C’est refuser les actes qui rabaissent, qui humilient, qui salissent la mémoire des ancêtres. C’est se tenir à la hauteur des attentes que la société place en chacun. Ainsi, la dignité ne se pense-t-elle pas en vase clos : se définit-elle toujours par rapport aux autres, tout comme le Maya.
On peut dire sans exagération que le Maya est la traduction vivante de la dignité humaine dans la tradition bamanan — et au-delà, dans l’ensemble mandingue. Celui qui manque de Maya perd sa dignité ; et celui qui perd sa dignité ne peut plus respecter celle des autres. Alors il s’enfonce dans la spirale de l’individualisme, de l’arrogance et de l’égoïsme.
Or, que voyons-nous aujourd’hui ? Trop souvent, le Malien moderne s’éloigne du Maya. Les valeurs ancestrales de solidarité et d’humanité cèdent la place à l’individualisme, au mépris, à la recherche effrénée du gain personnel. L’égo l’emporte sur l’esprit communautaire. La dignité, jadis sacrée, se dilue dans les calculs matériels et les rivalités futiles.
Mais sans Maya, nous perdons l’essentiel : notre respectabilité devant nos ancêtres et devant l’humanité tout entière. Sans Maya, nous perdons ce qui faisait la grandeur de notre civilisation.
Le défi du Malien d’aujourd’hui n’est pas seulement économique, politique ou sécuritaire : il est moral et culturel. Il nous faut réapprendre le Maya, le vivre au quotidien, en faire le ciment de nos relations et la boussole de notre avenir. Car une société qui se détourne de sa dignité finit par perdre sa liberté et son âme.
Le Maya est la natte sur laquelle repose la communauté : quand elle se déchire, tout le monde s’écroule. Tel est actuellement le triste tableau du Maliba.
Réapprendre le Maya, c’est retrouver le chemin de la dignité. Réapprendre la dignité, c’est préparer la renaissance du Mali.
Enfin, qu'on se le tienne pour dit: Un peuple sans Maya se perd ; un peuple de Maya se relève.
Par Dr. Mahamadou KONATE. Centre Kurukanfuga-BGCP
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0