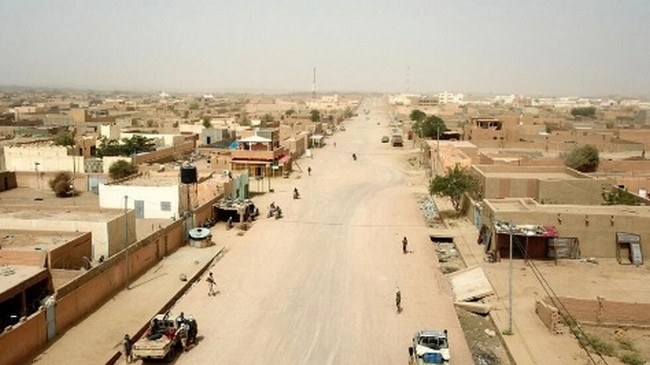L’Algérie vient de connaitre l’une des pages les plus sombres de son histoire à l’issue de la tragique prise d’otages sur le site gazier d’In Amenas avec un dénouement tragique et effroyable.

Le bilan est lourd et révoltant. Toutes les sources concordent à faire état de plusieurs dizaines de morts (otages et ravisseurs confondus). Le décompte macabre se poursuit.
Malgré la promptitude et la fermeté de la réaction des autorités algériennes, jugée « adaptée à la circonstance », selon le Président François Hollande, le monde découvre chaque jour un peu plus l’horreur infligée aux otages par leurs ravisseurs. Des corps calcinés, certains froidement abattus ou sommairement exécutés pendant que d’autres manquent encore à l’appel, voilà le triste décor laissé par « les fous de Dieu » dans leur basse et répugnante besogne.
Cet acte démontre, si besoin est, que l’Algérie a forcément une communauté de destins avec l’ensemble des pays de la sous-région, voire la communauté internationale, dans le combat contre le terrorisme.
Pourrait-il en être autrement lorsqu’on sait le lourd tribut payé par ce pays depuis pratiquement deux décennies du fait du fanatisme religieux et terrorisme ? Les victimes innocentes (algériennes et étrangères) se comptent par milliers depuis le déclenchement de cette autre forme d’expression de la barbarie humaine au début des années 90.
Malgré la détermination constante et sans relâche des autorités algériennes à détruire « le mal du siècle », la menace demeure toujours forte et permanente.
En effet, du Groupe Islamique Armé (GIA) à Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI) en passant par le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Coran (GSPC), Alger a été généralement en première ligne dans la guerre contre l’islamo-terrorisme. Le pays s’en est également donné les moyens appropriés, à travers notamment une politique des plus rigoureuses en la matière, des capacités logistiques sans commune mesure dans toute la sous–région ainsi qu’une constance dans la méthode de traitement et de réponse à tout chantage émanant des terroristes.
Cependant, la prise d’otages d’In Amenas marque incontestablement un tournant décisif par rapport à tout ce qui était fait jusque-là dans ce sens. En effet, jamais auparavant le terrorisme ne s’était attaqué avec autant de « courage » à l’industrie pétrolière du pays qui demeure le secteur clé de l’économie nationale. Il va de soi donc qu’à partir d’In Amenas, la menace montre désormais d’un cran et doit être analysée et traitée comme telle.
Cela a été dit et redit, aucun pays, surtout en Afrique, ne peut à lui seul combattre un phénomène aussi pernicieux et complexe que le terrorisme international, encore moins le vaincre efficacement.
La guerre contre le terrorisme, le narcotrafic et le crime organisé, actuellement en cours dans le nord du Mali, fait qu’aucun pays voisin, encore moins limitrophe, ne peut raisonnablement ne pas se sentir concerné aujourd’hui par la menace. Car, avec des communautés reparties de part et d’autres des frontières, l’immensité des territoires, la porosité des frontières et le manque de moyens adéquats pour faire face aux missions régaliennes des Etats en matière de défense et de sécurisation de leurs territoires, l’Afrique ne saurait gagner seule cette guerre qui se doit « implacable » contre le terrorisme et le narcotrafic habillés en pseudo Djihad pour un islam rigoriste et moyenâgeux n’ayant absolument rien à voir avec la religion musulmane prônée par le Prophète Mohammad (PSL).
De par cette communauté de destins, les pays sont condamnés à plus de solidarité, d’engagement et de détermination à travers des actions concertées et conjointement menées pour vaincre cette menace récurrente à la paix et la stabilité dans le monde, pire que la bombe atomique.
Bréhima SIDIBE
 Le bilan est lourd et révoltant. Toutes les sources concordent à faire état de plusieurs dizaines de morts (otages et ravisseurs confondus). Le décompte macabre se poursuit.
Malgré la promptitude et la fermeté de la réaction des autorités algériennes, jugée « adaptée à la circonstance », selon le Président François Hollande, le monde découvre chaque jour un peu plus l’horreur infligée aux otages par leurs ravisseurs. Des corps calcinés, certains froidement abattus ou sommairement exécutés pendant que d’autres manquent encore à l’appel, voilà le triste décor laissé par « les fous de Dieu » dans leur basse et répugnante besogne.
Cet acte démontre, si besoin est, que l’Algérie a forcément une communauté de destins avec l’ensemble des pays de la sous-région, voire la communauté internationale, dans le combat contre le terrorisme.
Pourrait-il en être autrement lorsqu’on sait le lourd tribut payé par ce pays depuis pratiquement deux décennies du fait du fanatisme religieux et terrorisme ? Les victimes innocentes (algériennes et étrangères) se comptent par milliers depuis le déclenchement de cette autre forme d’expression de la barbarie humaine au début des années 90.
Malgré la détermination constante et sans relâche des autorités algériennes à détruire « le mal du siècle », la menace demeure toujours forte et permanente.
En effet, du Groupe Islamique Armé (GIA) à Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI) en passant par le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Coran (GSPC), Alger a été généralement en première ligne dans la guerre contre l’islamo-terrorisme. Le pays s’en est également donné les moyens appropriés, à travers notamment une politique des plus rigoureuses en la matière, des capacités logistiques sans commune mesure dans toute la sous–région ainsi qu’une constance dans la méthode de traitement et de réponse à tout chantage émanant des terroristes.
Cependant, la prise d’otages d’In Amenas marque incontestablement un tournant décisif par rapport à tout ce qui était fait jusque-là dans ce sens. En effet, jamais auparavant le terrorisme ne s’était attaqué avec autant de « courage » à l’industrie pétrolière du pays qui demeure le secteur clé de l’économie nationale. Il va de soi donc qu’à partir d’In Amenas, la menace montre désormais d’un cran et doit être analysée et traitée comme telle.
Cela a été dit et redit, aucun pays, surtout en Afrique, ne peut à lui seul combattre un phénomène aussi pernicieux et complexe que le terrorisme international, encore moins le vaincre efficacement.
La guerre contre le terrorisme, le narcotrafic et le crime organisé, actuellement en cours dans le nord du Mali, fait qu’aucun pays voisin, encore moins limitrophe, ne peut raisonnablement ne pas se sentir concerné aujourd’hui par la menace. Car, avec des communautés reparties de part et d’autres des frontières, l’immensité des territoires, la porosité des frontières et le manque de moyens adéquats pour faire face aux missions régaliennes des Etats en matière de défense et de sécurisation de leurs territoires, l’Afrique ne saurait gagner seule cette guerre qui se doit « implacable » contre le terrorisme et le narcotrafic habillés en pseudo Djihad pour un islam rigoriste et moyenâgeux n’ayant absolument rien à voir avec la religion musulmane prônée par le Prophète Mohammad (PSL).
De par cette communauté de destins, les pays sont condamnés à plus de solidarité, d’engagement et de détermination à travers des actions concertées et conjointement menées pour vaincre cette menace récurrente à la paix et la stabilité dans le monde, pire que la bombe atomique.
Bréhima SIDIBE
Le bilan est lourd et révoltant. Toutes les sources concordent à faire état de plusieurs dizaines de morts (otages et ravisseurs confondus). Le décompte macabre se poursuit.
Malgré la promptitude et la fermeté de la réaction des autorités algériennes, jugée « adaptée à la circonstance », selon le Président François Hollande, le monde découvre chaque jour un peu plus l’horreur infligée aux otages par leurs ravisseurs. Des corps calcinés, certains froidement abattus ou sommairement exécutés pendant que d’autres manquent encore à l’appel, voilà le triste décor laissé par « les fous de Dieu » dans leur basse et répugnante besogne.
Cet acte démontre, si besoin est, que l’Algérie a forcément une communauté de destins avec l’ensemble des pays de la sous-région, voire la communauté internationale, dans le combat contre le terrorisme.
Pourrait-il en être autrement lorsqu’on sait le lourd tribut payé par ce pays depuis pratiquement deux décennies du fait du fanatisme religieux et terrorisme ? Les victimes innocentes (algériennes et étrangères) se comptent par milliers depuis le déclenchement de cette autre forme d’expression de la barbarie humaine au début des années 90.
Malgré la détermination constante et sans relâche des autorités algériennes à détruire « le mal du siècle », la menace demeure toujours forte et permanente.
En effet, du Groupe Islamique Armé (GIA) à Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI) en passant par le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Coran (GSPC), Alger a été généralement en première ligne dans la guerre contre l’islamo-terrorisme. Le pays s’en est également donné les moyens appropriés, à travers notamment une politique des plus rigoureuses en la matière, des capacités logistiques sans commune mesure dans toute la sous–région ainsi qu’une constance dans la méthode de traitement et de réponse à tout chantage émanant des terroristes.
Cependant, la prise d’otages d’In Amenas marque incontestablement un tournant décisif par rapport à tout ce qui était fait jusque-là dans ce sens. En effet, jamais auparavant le terrorisme ne s’était attaqué avec autant de « courage » à l’industrie pétrolière du pays qui demeure le secteur clé de l’économie nationale. Il va de soi donc qu’à partir d’In Amenas, la menace montre désormais d’un cran et doit être analysée et traitée comme telle.
Cela a été dit et redit, aucun pays, surtout en Afrique, ne peut à lui seul combattre un phénomène aussi pernicieux et complexe que le terrorisme international, encore moins le vaincre efficacement.
La guerre contre le terrorisme, le narcotrafic et le crime organisé, actuellement en cours dans le nord du Mali, fait qu’aucun pays voisin, encore moins limitrophe, ne peut raisonnablement ne pas se sentir concerné aujourd’hui par la menace. Car, avec des communautés reparties de part et d’autres des frontières, l’immensité des territoires, la porosité des frontières et le manque de moyens adéquats pour faire face aux missions régaliennes des Etats en matière de défense et de sécurisation de leurs territoires, l’Afrique ne saurait gagner seule cette guerre qui se doit « implacable » contre le terrorisme et le narcotrafic habillés en pseudo Djihad pour un islam rigoriste et moyenâgeux n’ayant absolument rien à voir avec la religion musulmane prônée par le Prophète Mohammad (PSL).
De par cette communauté de destins, les pays sont condamnés à plus de solidarité, d’engagement et de détermination à travers des actions concertées et conjointement menées pour vaincre cette menace récurrente à la paix et la stabilité dans le monde, pire que la bombe atomique.
Bréhima SIDIBE  Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0