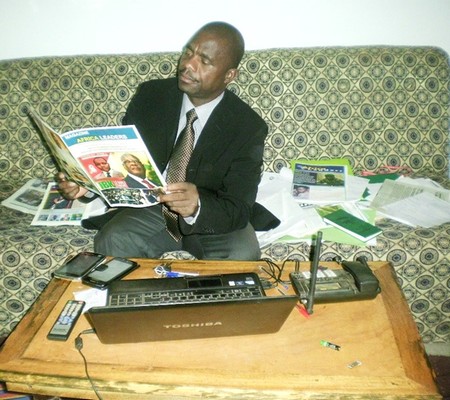Après de multiples protestations et consultations houleuses, le gouvernement d’union nationale vient d’être formé au Mali. Son effectif a été élargi de 11 nouveaux membres dont 13 rentrants sont nommés dans les rangs des partis politiques et diverses associations. Ainsi donc, en dépit de la création d’un ministère des affaires religieuses et des cultes, le Haut conseil islamique a pu bénéficier d’un poste au sein de la nouvelle équipe dont la mission primordiale devrait être la consolidation, l’entente et l’unité nationale en vue de lancer la grande reconquête des régions occupées au nord du pays par les groupements extrémistes religieux que sont MUJAO, BOKO HARAM et Ançar Eddine.
[caption id="attachment_49057" align="alignleft" width="180"]

Mr Sékou K. Diallo[/caption]
La CEDEAO, un appareil qui amplifie les sons émis depuis Paris, avait brandi des menaces d’embargo sur le Mali sans la formation d’un gouvernement qui représente l’ensemble des couches sociales. Même sans cette menace aussi ridicule que curieuse à la fois, il était clair que la résolution de la crise au nord ne passait que par celle de la crise politique au sud, notamment à Bamako ou les querelles mesquines entre différents clans se renforçaient davantage en plus de perdurer des mois, faisant perdre le temps précieux pour libérer nos compatriotes des atrocités qu’ils subissent au jour le jour sur leur sol natal malien. Depuis que la nouvelle est tombée le lundi 20 aout, revient l’espoir que c’est au nom des intérêts du Mali, de la stabilité que les forces vives de la nation ont accepté de se défaire, fut-il un bout de moment, de leurs ambitions personnelles et jeux politiques privés pour s’attaquer à l’essentiel dont rêve le peuple : bouter les bandits narcotrafiquants hors des frontières, nettoyer la maison des parasites. Car le dialogue n’y apportera aucun changement selon toute évidence. La logique des choses voudrait avant tout qu’ensemble, nous chassions les prédateurs du pays. Ensuite, nous pouvons nous livrer à nos querelles qui sont aussi l’un des fondements d’une même famille.
Revenons au fait du jour. Il ne fait pas de doute que la classe politique malienne a capitulé, qu’elle s’est défaite de ses taches principales qui doivent être la réalisation de ses projets et de celle des vœux des électeurs. Ce constat n’étonne guère. La plupart des 172 partis politiques du pays, pour ne pas dire tous, ne sont en vérité que des entreprises commerciales privées ou familiales quasiment voilées qui sont en quête d’intérêts personnels n’ayant rien à voir avec ceux du Mali. Privées parce que le président en est le pivot central unique et omnipotent. Familiales parce que qu’ils sont constitués essentiellement d’amis, de parents proches et de connaissances qui se livrent, tels des griots, aux louanges du chef, même en tombant parfois dans une subjectivité inouïe, excluant toute critique et autocritique à l’adresse de leur leader. Une sorte de culte de la personnalité, d’idolâtrie ou même un « Dieu personnifié ». C’est fou de penser que le chef peut ne pas avoir raison selon eux. On ne les voit jamais formuler la moindre objection, peut-être à cause des séquelles de la démocratie de consensus qui a conduit le Mali droit au mur. Le président du parti et ses fans réclament en permanence un changement au niveau de la direction du pays, l’entrée des jeunes sur scène pour « changer d’atmosphère », alors que le chef lui-même est toujours sur son fauteuil, durant des années parfois, oubliant ainsi que l’essence de la démocratie, c’est le changement, que les cimetières sont pleins d’indispensables comme le diront d’autres. Ces formations politiques ne bénéficient d’aucun soutien véritable au sein de la population de laquelle ils sont très éloignés d’ailleurs. Le diplomate français Bigot avait raison qui se demandait : quel parti peut bien remplir un stade au Mali ? Aucun!
Le Haut conseil islamique du Mali (HCIM) en est capable. La défaite des partis politiques due à leur opportunisme et le désespoir qu’ils ont créé chez les Maliens par leur irresponsabilité, a permis à cette organisation religieuse d’être un pion d’une très grande importance sur l’arène nationale. Aujourd’hui face à l’incapacité de la classe dirigeante, le HCIM est devenu l’acteur principal des négociations avec les groupements islamiques qui occupent le nord du pays. Son président, Mahmoud Dicko en est conscient, et son heure semble sonner déjà. Même s’ils sont qualifiés d’extrémistes, Ançar Eddine, BOKO HARAM et MUJAO sont néanmoins des frères musulmans… Une sorte de solidarité peut être sous entendue.
Au sein du nouveau gouvernement, le HCIM a obtenu un poste ministériel. En guise de récompense pour les efforts déployés par Mahmoud Dicko quant à la résolution de la crise, disent certains. Mais il faut plutôt reconnaitre que c’est au nom de l’union nationale, et au nom de la force réelle que constitue cette organisation, car les formations politiques n’ont plus de crédit dans le pays. Les citoyens s’en sont remis à Dieu, le Tout puissant et le miséricordieux. Pour paraphraser les propos de Mr Dicko : « 95% des Maliens sont musulmans, je n’ai pas l’intention de faire de la politique, mais si le peuple me le demande, je ne saurai refuser de jouer mon rôle. » Comme pour dire : nous sommes la majorité, personne ne peut nous contenir si nous nous levons! Certes, en ces moments de crise profonde que traverse le pays, compte tenu du fait que la classe politique est très discréditée, la présence du HCIM au sein du gouvernement est à saluer. Pour apaiser les esprits et dégonfler la tension sociale. L’autorité dont jouit à présent le HCIM pourrait empêcher des débordements et permettre l’amorce rapide d’un règlement du ou des conflits.
Mais il y a l’autre revers de la médaille cependant. Mr Dicko a oublié d’ajouter que les 95% de musulmans maliens sont en grande majorité des analphabètes qui ne savent pas grand-chose, qui souffrent de faim et de soif, qui ne comprennent même pas assez bien la langue dans laquelle ils prient. De ce point de vue, avec la poussée islamique au Mali, ils constituent un terrain propice aux manipulations de tous genres, aux enrôlements dans les rangs armés des « fous de Dieu » qui espèrent accéder au Paradis en mourant pour la foi. Cela pourrait faciliter la tâche à certaines personnes aux mauvaises intentions, qui pourront obtenir ce qu’ils souhaitent grâce au chantage. La religion est l’opium du peuple, a-t-on dit. L’honorable Cherif Ousmane Madani Haidara avait déclaré à son tour que les islamistes ont des complices au sein du HCIM. Donc, la menace extrémiste est une réalité dans notre pays qui pourrait perdre son caractère laïc, voire sa Constitution qui serait remplacée par la charia.
Que dire des 5% des Maliens qui ne sont pas musulmans ? Donc, ils ne sont plus pris en compte dans un pays qui se dit laïc! Si les chrétiens, les athéistes ou même les détenteurs de « Komo » et de « Tomo » demandaient à entrer aussi dans le gouvernement, que trouverons-nous à leur dire, allons-nous élargir encore l’effectif en créant un nouveau ministère « des affaires païennes » ?
Après le règlement de la crise que tout le Mali entier souhaite (sans exception, on espère bien), nous devons songer à ne pas glisser sur la piste d’une islamisation du pays. Comme l’appétit vient en mangeant, il n’est pas à exclure que certains veuillent le maintien du fameux ministère des affaires religieuses et des cultes afin de pouvoir continuer à se maintenir sur scène désormais. Notre erreur fatale sera celle de fermer les yeux dessus, de ne pas vouloir effectivement séparer la politique de la religion, de contourner ou de taire cette question religieuse qui mérite bien d’être débattue dans émotions ni passions. Le Mali doit briser le tabou! Quoi qu’on dise, religion et politique sont incompatibles. Ceux qui soutiennent que le Qatar par exemple (encore un pays qui aide nos rebelles!) et l’Arabie Saoudite sont des pays islamiques et que tout s’y passe bien oublient que dans ces républiques musulmanes le taux d’illettrés est bien inferieur!
Il n’est pas forcement dit que les religieux ne doivent pas faire de politique au Mali. S’il est admis qu’un militaire doit quitter les rangs de l’armée pour s’y lancer, les religieux aussi se doivent de « quitter » la mosquée ou l’église pour pouvoir le faire. Il est très étrange de dire aux militaires de vider la scène politique et de rentrer dans les casernes, sans demander aux religieux de rester dans les mosquées! Une fois, le Mali a commis l’erreur de politiser le milieu scolaire. Le résultat est connu de tous avec la tristement célèbre AEEM…
Nous devons agir si nous ne voulons pas des lapidations à mort, des procès judiciaires « CHARIAtiques » qui rappellent plutôt des inquisitions, des décès suite aux mains amputées dans des conditions atroces, ou voir des femmes soupçonnées d’adultère abattues publiquement par des rafales de balles comme en Afghanistan.
Quoi qu’il en soit, notre rêve premier au Mali, c’est de trouver à boire et à manger à notre faim. D’ailleurs un adage malien dit que la cuisine est plus vieille que la mosquée.
Une contribution de Mr SEKOU DIALLO (Alma Ata, Kazakhstan)
 Mr Sékou K. Diallo[/caption]
La CEDEAO, un appareil qui amplifie les sons émis depuis Paris, avait brandi des menaces d’embargo sur le Mali sans la formation d’un gouvernement qui représente l’ensemble des couches sociales. Même sans cette menace aussi ridicule que curieuse à la fois, il était clair que la résolution de la crise au nord ne passait que par celle de la crise politique au sud, notamment à Bamako ou les querelles mesquines entre différents clans se renforçaient davantage en plus de perdurer des mois, faisant perdre le temps précieux pour libérer nos compatriotes des atrocités qu’ils subissent au jour le jour sur leur sol natal malien. Depuis que la nouvelle est tombée le lundi 20 aout, revient l’espoir que c’est au nom des intérêts du Mali, de la stabilité que les forces vives de la nation ont accepté de se défaire, fut-il un bout de moment, de leurs ambitions personnelles et jeux politiques privés pour s’attaquer à l’essentiel dont rêve le peuple : bouter les bandits narcotrafiquants hors des frontières, nettoyer la maison des parasites. Car le dialogue n’y apportera aucun changement selon toute évidence. La logique des choses voudrait avant tout qu’ensemble, nous chassions les prédateurs du pays. Ensuite, nous pouvons nous livrer à nos querelles qui sont aussi l’un des fondements d’une même famille.
Revenons au fait du jour. Il ne fait pas de doute que la classe politique malienne a capitulé, qu’elle s’est défaite de ses taches principales qui doivent être la réalisation de ses projets et de celle des vœux des électeurs. Ce constat n’étonne guère. La plupart des 172 partis politiques du pays, pour ne pas dire tous, ne sont en vérité que des entreprises commerciales privées ou familiales quasiment voilées qui sont en quête d’intérêts personnels n’ayant rien à voir avec ceux du Mali. Privées parce que le président en est le pivot central unique et omnipotent. Familiales parce que qu’ils sont constitués essentiellement d’amis, de parents proches et de connaissances qui se livrent, tels des griots, aux louanges du chef, même en tombant parfois dans une subjectivité inouïe, excluant toute critique et autocritique à l’adresse de leur leader. Une sorte de culte de la personnalité, d’idolâtrie ou même un « Dieu personnifié ». C’est fou de penser que le chef peut ne pas avoir raison selon eux. On ne les voit jamais formuler la moindre objection, peut-être à cause des séquelles de la démocratie de consensus qui a conduit le Mali droit au mur. Le président du parti et ses fans réclament en permanence un changement au niveau de la direction du pays, l’entrée des jeunes sur scène pour « changer d’atmosphère », alors que le chef lui-même est toujours sur son fauteuil, durant des années parfois, oubliant ainsi que l’essence de la démocratie, c’est le changement, que les cimetières sont pleins d’indispensables comme le diront d’autres. Ces formations politiques ne bénéficient d’aucun soutien véritable au sein de la population de laquelle ils sont très éloignés d’ailleurs. Le diplomate français Bigot avait raison qui se demandait : quel parti peut bien remplir un stade au Mali ? Aucun!
Le Haut conseil islamique du Mali (HCIM) en est capable. La défaite des partis politiques due à leur opportunisme et le désespoir qu’ils ont créé chez les Maliens par leur irresponsabilité, a permis à cette organisation religieuse d’être un pion d’une très grande importance sur l’arène nationale. Aujourd’hui face à l’incapacité de la classe dirigeante, le HCIM est devenu l’acteur principal des négociations avec les groupements islamiques qui occupent le nord du pays. Son président, Mahmoud Dicko en est conscient, et son heure semble sonner déjà. Même s’ils sont qualifiés d’extrémistes, Ançar Eddine, BOKO HARAM et MUJAO sont néanmoins des frères musulmans… Une sorte de solidarité peut être sous entendue.
Au sein du nouveau gouvernement, le HCIM a obtenu un poste ministériel. En guise de récompense pour les efforts déployés par Mahmoud Dicko quant à la résolution de la crise, disent certains. Mais il faut plutôt reconnaitre que c’est au nom de l’union nationale, et au nom de la force réelle que constitue cette organisation, car les formations politiques n’ont plus de crédit dans le pays. Les citoyens s’en sont remis à Dieu, le Tout puissant et le miséricordieux. Pour paraphraser les propos de Mr Dicko : « 95% des Maliens sont musulmans, je n’ai pas l’intention de faire de la politique, mais si le peuple me le demande, je ne saurai refuser de jouer mon rôle. » Comme pour dire : nous sommes la majorité, personne ne peut nous contenir si nous nous levons! Certes, en ces moments de crise profonde que traverse le pays, compte tenu du fait que la classe politique est très discréditée, la présence du HCIM au sein du gouvernement est à saluer. Pour apaiser les esprits et dégonfler la tension sociale. L’autorité dont jouit à présent le HCIM pourrait empêcher des débordements et permettre l’amorce rapide d’un règlement du ou des conflits.
Mais il y a l’autre revers de la médaille cependant. Mr Dicko a oublié d’ajouter que les 95% de musulmans maliens sont en grande majorité des analphabètes qui ne savent pas grand-chose, qui souffrent de faim et de soif, qui ne comprennent même pas assez bien la langue dans laquelle ils prient. De ce point de vue, avec la poussée islamique au Mali, ils constituent un terrain propice aux manipulations de tous genres, aux enrôlements dans les rangs armés des « fous de Dieu » qui espèrent accéder au Paradis en mourant pour la foi. Cela pourrait faciliter la tâche à certaines personnes aux mauvaises intentions, qui pourront obtenir ce qu’ils souhaitent grâce au chantage. La religion est l’opium du peuple, a-t-on dit. L’honorable Cherif Ousmane Madani Haidara avait déclaré à son tour que les islamistes ont des complices au sein du HCIM. Donc, la menace extrémiste est une réalité dans notre pays qui pourrait perdre son caractère laïc, voire sa Constitution qui serait remplacée par la charia.
Que dire des 5% des Maliens qui ne sont pas musulmans ? Donc, ils ne sont plus pris en compte dans un pays qui se dit laïc! Si les chrétiens, les athéistes ou même les détenteurs de « Komo » et de « Tomo » demandaient à entrer aussi dans le gouvernement, que trouverons-nous à leur dire, allons-nous élargir encore l’effectif en créant un nouveau ministère « des affaires païennes » ?
Après le règlement de la crise que tout le Mali entier souhaite (sans exception, on espère bien), nous devons songer à ne pas glisser sur la piste d’une islamisation du pays. Comme l’appétit vient en mangeant, il n’est pas à exclure que certains veuillent le maintien du fameux ministère des affaires religieuses et des cultes afin de pouvoir continuer à se maintenir sur scène désormais. Notre erreur fatale sera celle de fermer les yeux dessus, de ne pas vouloir effectivement séparer la politique de la religion, de contourner ou de taire cette question religieuse qui mérite bien d’être débattue dans émotions ni passions. Le Mali doit briser le tabou! Quoi qu’on dise, religion et politique sont incompatibles. Ceux qui soutiennent que le Qatar par exemple (encore un pays qui aide nos rebelles!) et l’Arabie Saoudite sont des pays islamiques et que tout s’y passe bien oublient que dans ces républiques musulmanes le taux d’illettrés est bien inferieur!
Il n’est pas forcement dit que les religieux ne doivent pas faire de politique au Mali. S’il est admis qu’un militaire doit quitter les rangs de l’armée pour s’y lancer, les religieux aussi se doivent de « quitter » la mosquée ou l’église pour pouvoir le faire. Il est très étrange de dire aux militaires de vider la scène politique et de rentrer dans les casernes, sans demander aux religieux de rester dans les mosquées! Une fois, le Mali a commis l’erreur de politiser le milieu scolaire. Le résultat est connu de tous avec la tristement célèbre AEEM…
Nous devons agir si nous ne voulons pas des lapidations à mort, des procès judiciaires « CHARIAtiques » qui rappellent plutôt des inquisitions, des décès suite aux mains amputées dans des conditions atroces, ou voir des femmes soupçonnées d’adultère abattues publiquement par des rafales de balles comme en Afghanistan.
Quoi qu’il en soit, notre rêve premier au Mali, c’est de trouver à boire et à manger à notre faim. D’ailleurs un adage malien dit que la cuisine est plus vieille que la mosquée.
Une contribution de Mr SEKOU DIALLO (Alma Ata, Kazakhstan)
Mr Sékou K. Diallo[/caption]
La CEDEAO, un appareil qui amplifie les sons émis depuis Paris, avait brandi des menaces d’embargo sur le Mali sans la formation d’un gouvernement qui représente l’ensemble des couches sociales. Même sans cette menace aussi ridicule que curieuse à la fois, il était clair que la résolution de la crise au nord ne passait que par celle de la crise politique au sud, notamment à Bamako ou les querelles mesquines entre différents clans se renforçaient davantage en plus de perdurer des mois, faisant perdre le temps précieux pour libérer nos compatriotes des atrocités qu’ils subissent au jour le jour sur leur sol natal malien. Depuis que la nouvelle est tombée le lundi 20 aout, revient l’espoir que c’est au nom des intérêts du Mali, de la stabilité que les forces vives de la nation ont accepté de se défaire, fut-il un bout de moment, de leurs ambitions personnelles et jeux politiques privés pour s’attaquer à l’essentiel dont rêve le peuple : bouter les bandits narcotrafiquants hors des frontières, nettoyer la maison des parasites. Car le dialogue n’y apportera aucun changement selon toute évidence. La logique des choses voudrait avant tout qu’ensemble, nous chassions les prédateurs du pays. Ensuite, nous pouvons nous livrer à nos querelles qui sont aussi l’un des fondements d’une même famille.
Revenons au fait du jour. Il ne fait pas de doute que la classe politique malienne a capitulé, qu’elle s’est défaite de ses taches principales qui doivent être la réalisation de ses projets et de celle des vœux des électeurs. Ce constat n’étonne guère. La plupart des 172 partis politiques du pays, pour ne pas dire tous, ne sont en vérité que des entreprises commerciales privées ou familiales quasiment voilées qui sont en quête d’intérêts personnels n’ayant rien à voir avec ceux du Mali. Privées parce que le président en est le pivot central unique et omnipotent. Familiales parce que qu’ils sont constitués essentiellement d’amis, de parents proches et de connaissances qui se livrent, tels des griots, aux louanges du chef, même en tombant parfois dans une subjectivité inouïe, excluant toute critique et autocritique à l’adresse de leur leader. Une sorte de culte de la personnalité, d’idolâtrie ou même un « Dieu personnifié ». C’est fou de penser que le chef peut ne pas avoir raison selon eux. On ne les voit jamais formuler la moindre objection, peut-être à cause des séquelles de la démocratie de consensus qui a conduit le Mali droit au mur. Le président du parti et ses fans réclament en permanence un changement au niveau de la direction du pays, l’entrée des jeunes sur scène pour « changer d’atmosphère », alors que le chef lui-même est toujours sur son fauteuil, durant des années parfois, oubliant ainsi que l’essence de la démocratie, c’est le changement, que les cimetières sont pleins d’indispensables comme le diront d’autres. Ces formations politiques ne bénéficient d’aucun soutien véritable au sein de la population de laquelle ils sont très éloignés d’ailleurs. Le diplomate français Bigot avait raison qui se demandait : quel parti peut bien remplir un stade au Mali ? Aucun!
Le Haut conseil islamique du Mali (HCIM) en est capable. La défaite des partis politiques due à leur opportunisme et le désespoir qu’ils ont créé chez les Maliens par leur irresponsabilité, a permis à cette organisation religieuse d’être un pion d’une très grande importance sur l’arène nationale. Aujourd’hui face à l’incapacité de la classe dirigeante, le HCIM est devenu l’acteur principal des négociations avec les groupements islamiques qui occupent le nord du pays. Son président, Mahmoud Dicko en est conscient, et son heure semble sonner déjà. Même s’ils sont qualifiés d’extrémistes, Ançar Eddine, BOKO HARAM et MUJAO sont néanmoins des frères musulmans… Une sorte de solidarité peut être sous entendue.
Au sein du nouveau gouvernement, le HCIM a obtenu un poste ministériel. En guise de récompense pour les efforts déployés par Mahmoud Dicko quant à la résolution de la crise, disent certains. Mais il faut plutôt reconnaitre que c’est au nom de l’union nationale, et au nom de la force réelle que constitue cette organisation, car les formations politiques n’ont plus de crédit dans le pays. Les citoyens s’en sont remis à Dieu, le Tout puissant et le miséricordieux. Pour paraphraser les propos de Mr Dicko : « 95% des Maliens sont musulmans, je n’ai pas l’intention de faire de la politique, mais si le peuple me le demande, je ne saurai refuser de jouer mon rôle. » Comme pour dire : nous sommes la majorité, personne ne peut nous contenir si nous nous levons! Certes, en ces moments de crise profonde que traverse le pays, compte tenu du fait que la classe politique est très discréditée, la présence du HCIM au sein du gouvernement est à saluer. Pour apaiser les esprits et dégonfler la tension sociale. L’autorité dont jouit à présent le HCIM pourrait empêcher des débordements et permettre l’amorce rapide d’un règlement du ou des conflits.
Mais il y a l’autre revers de la médaille cependant. Mr Dicko a oublié d’ajouter que les 95% de musulmans maliens sont en grande majorité des analphabètes qui ne savent pas grand-chose, qui souffrent de faim et de soif, qui ne comprennent même pas assez bien la langue dans laquelle ils prient. De ce point de vue, avec la poussée islamique au Mali, ils constituent un terrain propice aux manipulations de tous genres, aux enrôlements dans les rangs armés des « fous de Dieu » qui espèrent accéder au Paradis en mourant pour la foi. Cela pourrait faciliter la tâche à certaines personnes aux mauvaises intentions, qui pourront obtenir ce qu’ils souhaitent grâce au chantage. La religion est l’opium du peuple, a-t-on dit. L’honorable Cherif Ousmane Madani Haidara avait déclaré à son tour que les islamistes ont des complices au sein du HCIM. Donc, la menace extrémiste est une réalité dans notre pays qui pourrait perdre son caractère laïc, voire sa Constitution qui serait remplacée par la charia.
Que dire des 5% des Maliens qui ne sont pas musulmans ? Donc, ils ne sont plus pris en compte dans un pays qui se dit laïc! Si les chrétiens, les athéistes ou même les détenteurs de « Komo » et de « Tomo » demandaient à entrer aussi dans le gouvernement, que trouverons-nous à leur dire, allons-nous élargir encore l’effectif en créant un nouveau ministère « des affaires païennes » ?
Après le règlement de la crise que tout le Mali entier souhaite (sans exception, on espère bien), nous devons songer à ne pas glisser sur la piste d’une islamisation du pays. Comme l’appétit vient en mangeant, il n’est pas à exclure que certains veuillent le maintien du fameux ministère des affaires religieuses et des cultes afin de pouvoir continuer à se maintenir sur scène désormais. Notre erreur fatale sera celle de fermer les yeux dessus, de ne pas vouloir effectivement séparer la politique de la religion, de contourner ou de taire cette question religieuse qui mérite bien d’être débattue dans émotions ni passions. Le Mali doit briser le tabou! Quoi qu’on dise, religion et politique sont incompatibles. Ceux qui soutiennent que le Qatar par exemple (encore un pays qui aide nos rebelles!) et l’Arabie Saoudite sont des pays islamiques et que tout s’y passe bien oublient que dans ces républiques musulmanes le taux d’illettrés est bien inferieur!
Il n’est pas forcement dit que les religieux ne doivent pas faire de politique au Mali. S’il est admis qu’un militaire doit quitter les rangs de l’armée pour s’y lancer, les religieux aussi se doivent de « quitter » la mosquée ou l’église pour pouvoir le faire. Il est très étrange de dire aux militaires de vider la scène politique et de rentrer dans les casernes, sans demander aux religieux de rester dans les mosquées! Une fois, le Mali a commis l’erreur de politiser le milieu scolaire. Le résultat est connu de tous avec la tristement célèbre AEEM…
Nous devons agir si nous ne voulons pas des lapidations à mort, des procès judiciaires « CHARIAtiques » qui rappellent plutôt des inquisitions, des décès suite aux mains amputées dans des conditions atroces, ou voir des femmes soupçonnées d’adultère abattues publiquement par des rafales de balles comme en Afghanistan.
Quoi qu’il en soit, notre rêve premier au Mali, c’est de trouver à boire et à manger à notre faim. D’ailleurs un adage malien dit que la cuisine est plus vieille que la mosquée.
Une contribution de Mr SEKOU DIALLO (Alma Ata, Kazakhstan)
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0