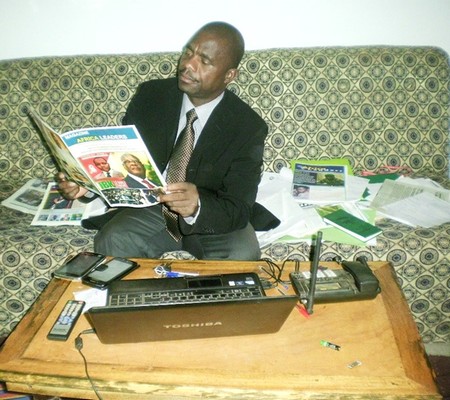Un défi majeur pour le marché céréalier malien : Concilier bénéfice et souveraineté alimentaire
A travers ces produits, le Mali compte à court et à moyens termes, dégager de substantiels surplus à exporter vers les pays voisins. L’augmentation de l’offre se traduit par une très forte réduction de la dépendance extérieure du pays en céréales. Le taux de couverture des besoins locaux par la production nationale du riz est le plus élevé de l’Afrique de l’ouest (plus de 80 %).
Diagnostic du marché céréalier Malien
Avec une offre qui atteint plus de 6 millions de tonnes en 2011 et une demande en pleine mutation, le marché céréalier du Mali est sans nul doute le second plus important de l’Afrique de l’ouest après celui du Nigeria. Il a subi de nombreuses reformes au cours des trente dernières années, réformes qui ont placé les acteurs privés au cœur du dispositif de commercialisation. Il reste cependant marqué par l’une des plus significatives caractéristiques des marchés des produits agricoles ouest africains : la double variation des prix, expression de la fluctuation de l’offre, de l’insuffisance des infrastructures de stockage et des difficultés d’accès à des financements adéquats par les principaux acteurs. Le système de l’offre comprend la production nationale, les exportations, les importations, le stockage et la transformation.Les cinq filières céréalières les plus importantes au Mali sont : le mil, le sorgho, le riz, le maïs et le blé ; l’offre de la dernière reposant en grande partie sur les importations. Parmi les quatre céréales dont l’offre est largement assurée par la production nationale, le riz et le maïs ont enregistré la croissance la plus dynamique ces vingt dernières années, la production de maïs ayant progressé chaque année de 8 % entre 1990 et 2011 et celle du riz de plus de 10 %. La production nationale brute du riz s’est chiffrée à 1,5 million de tonnes en 2009/10, à peu près 91 % de l’offre totale, les importations comptant pour 140.860 tonnes. Une partie importante de cette offre est destinée à l’autoconsommation. Il y a quelques exportations, destinées surtout à la Mauritanie et à la Guinée, mais les volumes sont mal connus. Les céréales sèches (mil, sorgho et maïs) Le surplus commercialisable des céréales sèches alimente le segment de la consommation des ménages à 50 % d’environ. L’autre moitié se repartie entre le segment transformation pour la consommation humaine et la bière locale et celui de la transformation pour l’alimentation animale et les exportations. Même si les circuits de commercialisation au niveau de la collecte sont similaires, la dynamique de l’offre diffère beaucoup entre le maïs dont la production est en rapide expansion et le mil/sorgho, où la production progresse plus lentement surtout à travers une expansion des surfaces cultivées au lieu d’une augmentation des rendements. Pour les céréales sèches, les importations commerciales et les aides alimentaires sont très modestes. Les importations commerciales concernent surtout du maïs de la Côte d’Ivoire qui arrive en période de soudure (juin-juillet) profitant d’une récolte plus précoce en Côte d’Ivoire qu’au Mali.
L’offre de blé repose essentiellement sur les importations (94 % pendant la période 2005/06 à 2008/10), la production nationale ayant évolué en dents de scies au cours de la période 2001/2002 à 2008/09. On note une légère augmentation de la production nationale en 2009/10, suite à l’initiative blé et aux investissements dans la production par les transformateurs industriels, notamment les Grands Moulins du Mali, GDCM et les Moulins du Sahel. Ces nouveaux investissements ouvrent de bonnes perspectives pour la production locale de blé qui, selon les spécialistes, devient de plus en plus compétitive par rapport à l’importation.
Principaux segments du marché On attend par segment de marché, un sous-groupe de consommateurs qui ont des caractéristiques similaires, exprimant des besoins et des désirs semblables et réagissent à la même stratégie de marketing. La compréhension de la segmentation des marchés concernés est donc très importante dans la mesure où elle nous permettra d’identifier pour chacun de ces produits une stratégie de marketing en fonction de ces segments. Pour le riz : on distingue quatre segments: le segment de riz entier ELB haute gamme, le segment de riz à 15% - 25% représentant une qualité intermédiaire, le segment du riz RM40, assimilé au 35% du marché mondial, et le segment du riz brisure parfumé. Pour le blé : Le blé est produit au Mali essentiellement dans la région de Tombouctou, on retient deux segments pour cette filière, à savoir le segment de la transformation artisanale par lequel près de 75% de la production nationale est utilisée et le segment des industries qui n’utilise que le quart de cette production et qui repose largement sur les importations. Pour le maïs : on distingue essentiellement trois segments de marché ; la consommation humaine représente la principale forme d’utilisation du maïs au Mali, le segment de la transformation artisanale qui est le mode dominant et l’exportation vers le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina… Pour le mil/sorgho : Les segments sont constitués de la consommation humaine et de la transformation. La consommation humaine constitue la principale forme d’utilisation du mil ; le mil et sorgho sous forme d’aliments précuits qui sont exportés vers les pays de l’Afrique de l’Ouest, la transformation du mil et sorgho en bière locale surtout dans les zones de production
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0