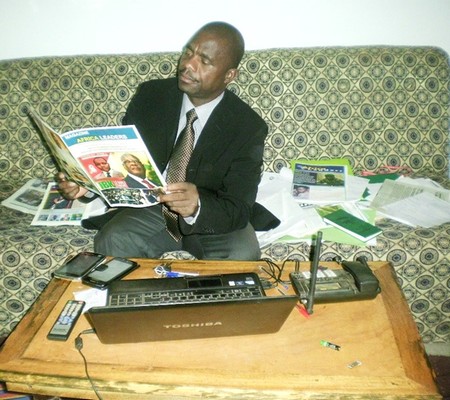Googan Tan : Lutte contre les djihadistes : la carotte et le bâton, une voie pour vaincre le terrorisme au Mali
Les récentes évolutions survenues le samedi 28 juin 2025 illustrent de manière éclatante les avancées tangibles de l'État malien dans sa lutte multiforme contre le djihadisme.

Deux événements majeurs sur le front sécuritaire témoignent non seulement de l'efficacité militaire croissante des Forces armées maliennes (FAMa), mais aussi de la pertinence de leur stratégie inclusive qui combine pression armée et politique d'ouverture envers les repentis. Les dernières attaques djihadistes ( Kayes. Nioro, Bafoulabé), du reste circonscrites, ne changent rien à mon analyse.
D'une part, une opération menée dans la localité de Cha-Mane, à 38 km au nord de Ménaka, a permis de neutraliser un chef terroriste étranger affilié à l'État islamique au grand Sahara (ÉIGS), ainsi que son garde du corps. Cette action décisive est un coup dur porté à l'organisation djihadiste, illustrant l'efficacité du renseignement et la réactivité de l'armée malienne sur le terrain. Ce type d'intervention ciblée, assimilable à celui du drone abattu à Tinzawaten, est une preuve manifeste du savoir-faire des FAMA et vient battre en brèche la thèse algérienne d'un drone menaçant sa sécurité. Il est aussi crucial pour affaiblir les chaînes de commandement des groupes extrémistes et pour démanteler leur capacité de nuisance.
D'autre part, dans une dynamique complémentaire, un autre front s'est ouvert, celui de la réintégration des combattants désireux de tourner la page de la violence. Le même jour, Boubacar Ibrahim, alias "Oubel", un chef de bande notoire actif dans le cercle d'Ansongo, s'est rendu avec une dizaine de ses hommes aux FAMa dans la zone de Lellehoye. Arrivés à moto, ces ex-combattants ont remis leurs armes et leurs équipements, avant de se diriger vers la ville d'Ansongo. Ce geste de reddition, symbole de renoncement à la violence, ouvre la voie à un processus de réhabilitation et de réintégration dans la communauté nationale.
Ces deux actions, offensive militaire et accueil des repentis, ne sont pas antagonistes, mais au contraire, profondément complémentaires. Une lutte uniquement répressive risque de générer un cycle sans fin de radicalisation et de représailles. À l'inverse, la réconciliation sans la maîtrise du terrain peut être perçue comme une faiblesse. C'est pourquoi la stratégie la plus prometteuse réside dans un équilibre subtil entre fermeté militaire et main tendue.
Cette approche, je ne me lasserai jamais de le dire, a été éprouvée ailleurs.
Des exemples internationaux viennent, en effet, renforcer la légitimité de cette double approche. En Algérie, après une décennie noire marquée par la violence islamiste des années 1990, le gouvernement a mis en œuvre une politique de "concorde civile" à partir de 1999. Cette loi a permis la réintégration de milliers d'anciens combattants islamistes dans la société, sous condition de déposer les armes et de renoncer à la violence. Si cette politique n'a pas éradiqué totalement le terrorisme, elle a nettement réduit son emprise et permis à une grande partie du pays de retrouver la stabilité.
De manière encore plus marquante, le processus de paix en Colombie avec les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) constitue une référence mondiale. Ce groupe de guérilla marxiste, actif pendant plus de cinquante ans, a finalement signé un accord de paix avec l'État en 2016. En échange de la démobilisation et de la reddition, des garanties juridiques, économiques et politiques ont été accordées aux ex-combattants. Le processus reste imparfait, mais il a permis une nette décrue des violences et une réinsertion progressive de milliers d'ex-combattants.
Au Nigeria, le programme de réhabilitation "Operation safe corridor" lancé en 2016 a pour but de réintégrer les anciens membres de Boko Haram. Grâce à une combinaison de soutien psychologique, de formation professionnelle et de médiation communautaire, des centaines de repentis ont pu retrouver une place dans la société, limitant ainsi le potentiel de recrutement de nouveaux djihadistes.
Notre pays, confronté à une crise sécuritaire persistante depuis plus d'une décennie, a tout à gagner à renforcer cette stratégie intégrée. Les succès militaires doivent être consolidés par un dispositif clair de traitement des repentis : encadrement juridique, accompagnement social, suivi communautaire, mécanismes de vérité et de réparation. Le retour d'anciens combattants comme "Oubel" doit être accompagné de messages simples pour la population et d'actions pour regagner la confiance.
En conjuguant la force de la loi et la sagesse de la réconciliation, le Mali peut non seulement affaiblir l'appareil militaire djihadiste, mais aussi tarir son vivier de recrutement.
Ce double pari, à la fois audacieux et réaliste, pourrait être l'élément clé d'une paix durable chez nous et, par conséquent, dans le Sahel.
Seidina Oumar DICKO
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0