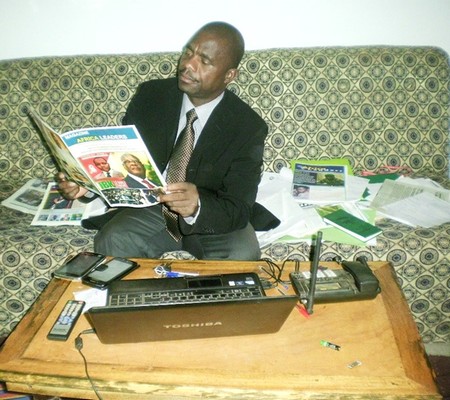Boom minier au Mali : Comment déminer le partage du butin ?
Assurément, le soleil des mines brille dans le ciel Malien. Le secteur mobilise désormais toutes les attentions et les passions au regard des potentialités qu’il recèle. Et bien entendu, le partage des fruits ne se fait pas sans heurts.
Depuis quelques années, les lancements des nouvelles mines «à ciel ouvert » se succèdent à un rythme soutenu. Confirmant de plus la bonne teneur du sous-sol malien en minerais.
L’annonce d’une intensification prochaine des activités, avec un certain empressement, en dit long d’ailleurs sur la volonté des groupes intéressés à jouer à fond la carte de la concurrence. D’où cette manière parfois grossière de vouloir immédiatement marquer son territoire. Quitte à se donner plus tard les moyens de la mise en œuvre d’une véritable politique d’exploitation.
La potion congrue de l’Etat
Du reste, dans la guerre des chiffres qui oppose les uns et les autres, ce sont les milliards qui pleuvent et viennent à chaque fois alimenter les discours. Vrai ou faux, toujours est-il que personne dans ce business très lucratif et appétissant sous nos cieux n’est prêt à se vendre à vil prix sur le marché de ses propres ambitions.
Pendant ce temps, l’arbitre, lui, en tant qu’Etat, du haut de son estrade, se tient soigneusement à l’écart de la bagarre. Du moins, officiellement. Préférant, dans un élan de religiosité dont lui seul a le secret, prier Allah le Tout-Puissant pour que les lingots coulent à flot.
C’est, en tout cas, le souhait publiquement exprimé par les compagnies minières au moment de la signature de leur contrat d’exploitation dans notre pays. Car l’on sait depuis quelques temps que l’envolée des cours mondiaux, notamment ceux de l’or, a inversé la tendance au niveau des différents pays qui se sont lancés dans le domaine.
Au Mali, le coton qui est le premier produit d’exportation, a relativement perdu de la blancheur par rapport au métal jaune. En 2010, l’activité minière a généré 640 milliards de francs CFA. Un montant encore bien trop modeste, certes, mais qui témoigne d’une rentabilité qui reste à mieux encadrer.
En effet, dans la majeure partie des cas, seuls 10% au maximum de ces fonds reviennent à la partie nationale. Le reste étant, bien évidemment, récupéré par les investisseurs qui, on l’oublie trop souvent hélas, sont loin d’être des philanthropes. Par conséquent, ils sont fort logiquement intéressés par l’essor rapide de leurs investissements sur le terrain. Dans certains pays voisins du Mali, les négociations entre l’Etat et les exploitants miniers ont parfois accouché d’une part comprise en moyenne entre 23 et 30%; en plus d’autres avantages sociaux consentis aux bénéfices des populations locales. Ce qui permet d’avoir une base de répartition qui minimise les déséquilibres flagrants. Au Mali, l’on est encore très loin du nec plus ultra. Pour un économiste du ministère du commerce, plusieurs raisons expliquent cela.
La première raison étant que «l’investissement minier coûte cher» dans son ensemble. En particulier, pour les Etats aux ressources limitées. Ce qui conduit, selon lui, d’une part, à une faiblesse d’un point de vue organisationnel et financier et, d’autre part, à une faiblesse technique à travers le manque ou l’insuffisance de personnel en quantité et en qualité pour servir à tous les niveaux de développement requis par le secteur minier.
Il appartient donc aux autorités maliennes de savoir donner de l’épaisseur à leurs ambitions. Mais aussi et surtout elles devront, estime-t-il, accorder la priorité à l’éducation et à la formation de cadres performants. Ces derniers devant avoir la priorité en termes d’embauche par les entreprises intéressées par leurs qualifications. Or, tout semble indiquer que le Mali et son secteur éducatif ont manifestement été surpris par le boom minier. Alors même que la puissance publique est censée fonctionner sur ce modèle dit de la prospective, elle s’est plutôt laissé dicter sa conduite. Parfois d’une manière incompréhensible. Donnant ainsi l’impression que les intérêts des investisseurs étaient sa principale motivation.
Difficile en effet d’opiner autrement, lorsque l’on constate avec quelle passion émotive Amadou Cissé, le ministre des Mines, s’emploie régulièrement à jouer l’avocat défenseur pour les sociétés minières. Du reste, depuis sa nomination au gouvernement, l’Homme n’a de cesse de multiplier les sorties. Proche du régime, sa présence à la tête des mines a été perçue comme le signe de l’attention que le pouvoir entend désormais accorder à la question. Et manifestement, Amadou Cissé a, de toute évidence, bien enfilé son «costard». Une visite au pas de course ici, un coup de gueule par là, ou encore un plaidoyer, bref, le ministre s’emploie à rassurer son petit monde. A tel point qu’on a parfois l’impression d’avoir affaire au ministre des Finances et de l’Economie ou à un autre de ses collègues.
Il y a de l’or dans notre pays, admet Amadou Cissé. Mais l’industrie minière au Mali ne génère pas suffisamment de recette pour l’Etat face aux ressources encaissé par les multinationales. Pendant que ces dernières emmagasinent des profits record, l’Etat malien reçoit une portion congrue. Une attitude qui se joue très souvent de l’expertise locale ou de ses manquements.
Comme il fallait s’y attendre, la grogne et le ressentiment se sont installés dans le milieu aurifère. C’est le cas avec les exploitants traditionnels communément appelés orpailleurs, et qui s’inscrivent dans un registre officieux de travail. Celui d’un artisanat dont le rudimentaire le dispute très souvent au goût immodéré pour le risque.
En dépit des campagnes de sensibilisation, ce sont des milliers de «chercheurs» qui descendent toujours plus bas dans les galeries souterraines malgré le mauvais temps et les risques d’éboulement, pour tenter d’y trouver une réponse adéquate à leurs préoccupations. Très peu intimidés par la présence policière sur les lieux, encore moins par les récurrents faits divers tragiques qui leur sont révélés, les orpailleurs sont toujours prêts à en découdre avec la nature. Pour ce faire, rien n’est de trop pour certains d’entre eux pour assouvir leur passion de l’argent. La récente condamnation d’un trafiquant d’organes humains sur les sites d’orpaillages en est la parfaite illustration.
Pour tenter de limiter les dégâts et minimiser les risques « d’incendie », la FDIH a mené des enquêtes au niveau des sites miniers du Mali pour la transparence. Ensuite, des cadres de concertation ont rapidement émergé, avec pour objectif de tenter de déminer les relations entre toutes les parties concernées. Il reste à souhaiter alors que tout le monde joue effectivement le jeu de la transparence pour que la confiance s’installe enfin autour de l’épineuse question de la redistribution des dividendes.
Jean pierre James
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0