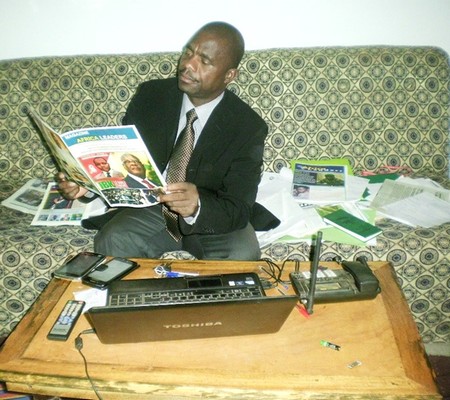Intellectuels, hommes et femmes de culture du Mali ont partagé avec la presse, jeudi 9 février 2012 à Bamako, leur analyse et leur vision de la crise qui secoue le pays depuis quelques temps. Dans une déclaration rendue publique à cette occasion, ils ont réaffirmé leur volonté de faire cause commune pour sauver la nation en péril...
C'est en éveilleurs de conscience, soucieux d'éclairer les opinions publiques nationale et internationale sur «les vrais enjeux» de la rébellion qui crée, depuis le 17 janvier dernier, «une situation de guerre civile» au Mali que des intellectuels et hommes et femmes de culture sont montés au créneau ce jeudi à Bamako. Et s'ils se font forts de dénoncer et de condamner, ils ne prennent pas moins l'engagement de travailler à un agenda d'actions concertées pour préserver l'intégrité du territoire national ainsi que la cohésion sociale. Aussi remontent-ils aux sources de l'histoire pour comprendre et faire comprendre les facteurs endogènes et exogènes de ces crises récurrentes ayant conduit aujourd'hui à une situation gravissime.
Il s'agit, pour les intellectuels et hommes et femmes de culture du Mali, signataires de la déclaration de ce jour au nombre desquels l'essayiste Aminata Dramane Traoré, les socio-économistes Abdoulaye Niang et Hamidou Magassa, les historiens Jean-Bosco Konaré et Mohamédou Dicko, l'anthropologue Filifing Sako ou encore le juriste Ousmane Traoré et le peintre Ismaïl Diabaté, d'œuvrer à la constitution d'«un véritable front de résistance au dépérissement de l'Etat». En interpelant ainsi les responsables politiques et la «communauté internationale», le groupe d'intellectuels, d'hommes et de femmes de culture initiateur de la présente déclaration entend s'ouvrir à tous et rassembler large pour contribuer plus efficacement, par la pertinence de son diagnostic et l'élégance de ses propositions et éclairages, à des prises de décisions salutaires.
«Nous sommes dans un processus programmé de désintégration de l'Etat et de cristallisation des identités ethniques et régionales», indique la déclaration, qui s'inquiète d'une nouvelle balkanisation du continent. «Après le découpage du Soudan, nous sommes en droit de nous interroger sur l'intention des pays de l'Otan (Organisation du traité Nord Atlantique, Ndlr) de procéder à une nouvelle balkanisation de l'Afrique. Ne sommes-nous pas de fait en présence d'un processus de dépossession des ressources agricoles et minières africaines, qui constituent aujourd'hui une partie importante des réserves mondiales pour la relance de la croissance économique globale?»
S'inscrivant résolument dans une dynamique de défense de l'intégrité du territoire national, pour laquelle il invite à une union sacrée, le groupe des intellectuels et hommes et femmes de culture du Mali, promoteur de cette déclaration, souligne avec force que: «Nous sommes un seul peuple et même peuple, uni par une longue histoire». Une histoire vieille de plus de 3 500 ans, qui a tout le potentiel pour «fédérer les initiatives et les synergies».
En posant le postulat inattaquable selon lequel «le septentrion n'est pas une planète à part, mais bel et bien une région du Mali, particulièrement vulnérable, qui n'en a pas moins subi les politiques néolibérales qui ont aggravé les inégalités, les injustices, la corruption et l'impunité», les auteurs de la déclaration de ce 9 février invitent assurément à l'émergence de nouveaux cercles vertueux susceptibles de panser les plaies en allant aux sources du mal. Car, et il faut que cela cesse enfin, «de Kayes à Kidal, les Maliens paient cher pour le dépérissement de l'Etat que nous voulons plus responsable, comptable et souverain».
Cela vaut pour le Mali aujourd'hui, mais aussi pour chacun de nos Etats plus que jamais fragiles, et sous le rouleau compresseur d'enjeux géopolitiques, économiques et stratégiques complexes, «sans la compréhension desquels aucune paix durable n'est envisageable». Et c'est là, justement, qu'intellectuels ainsi qu'hommes et femmes de culture du Mali montrent déjà la voie, bien décidés à jouer leur note jusqu'au bout.
La Rédaction
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0