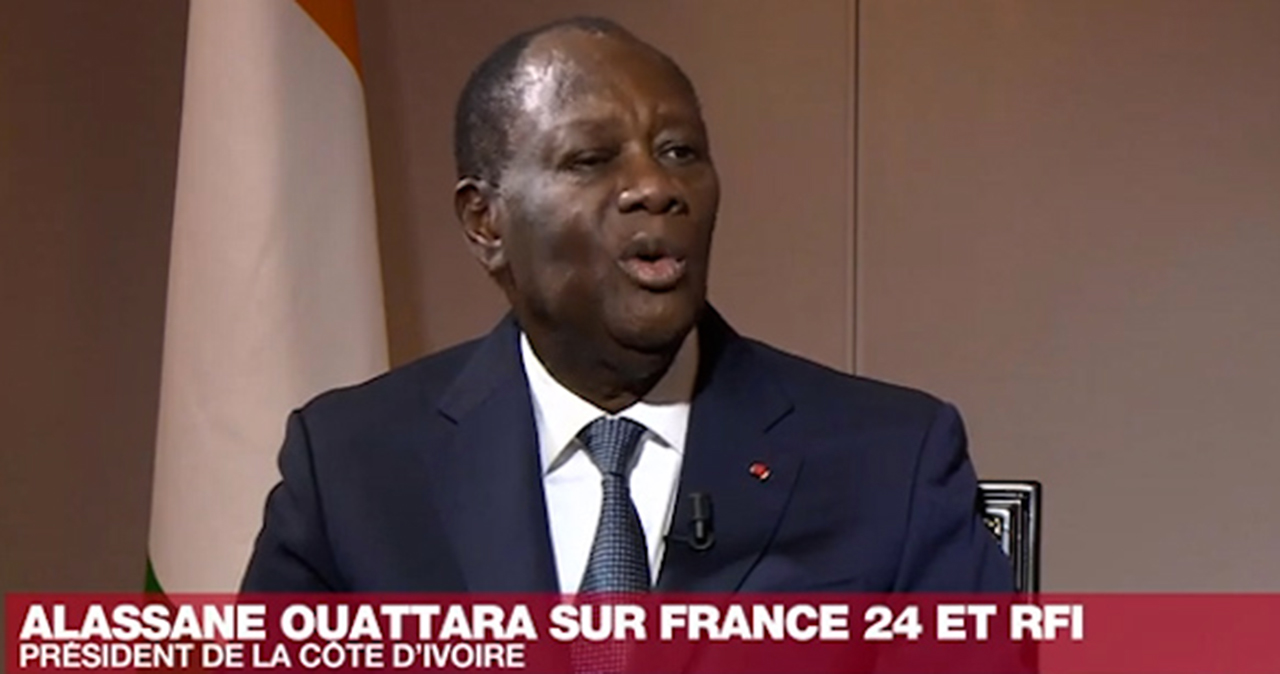Focus : Sanctuaire des GAT
Depuis plus de quinze ans, la Mauritanie n’a pas connu la moindre attaque terroriste sur son sol. Une performance en apparence remarquable dans une région ravagée par les incursions djihadistes. Mais derrière cette tranquillité se cache une réalité plus sombre : celle d’un État qui, loin d’être un bastion de stabilité, serait devenu un refuge discret pour les groupes armés terroristes.

Alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger luttent à armes inégales contre des factions violentes et transnationales, la Mauritanie semble avoir trouvé une formule d’immunité. Non pas par la force, mais par le compromis. Des documents déclassifiés en 2010 évoquaient déjà un pacte de non-agression entre le régime mauritanien et AQMI. En échange de la paix sur son territoire, Nouakchott aurait offert aux combattants un accès libre à ses infrastructures : soins médicaux, ravitaillement, entretien logistique. Une entente tacite qui, selon plusieurs analystes, n’a jamais été rompue.
Les révélations récentes de la diplomatie russe devant le Conseil de sécurité de l’ONU viennent raviver ces soupçons. Moscou accuse la Mauritanie de servir de couloir pour des armes ukrainiennes à destination de groupes terroristes opérant au Sahel. Des drones et équipements militaires transiteraient par son territoire, échappant à tout contrôle. Ces accusations, loin d’être isolées, s’ajoutent à une série d’enquêtes qui pointent l’Est du pays comme une zone d’implantation active de cellules djihadistes.
La Mauritanie, tout en affichant une posture de neutralité, semble jouer un double jeu. Officiellement partenaire de l’OTAN, elle bénéficie d’une image diplomatique lisse. Mais sur le terrain, sa frontière avec le Mali reste poreuse, et ses vastes étendues désertiques offrent un abri idéal aux combattants. Le silence prolongé sur les activités de ces groupes, l’absence de frappes ciblées, et la rareté des opérations militaires dans ces zones interrogent. Ce pays voisin serait-il devenu le sanctuaire des Groupes armés terroristes ?
Pendant ce temps, le Mali déploie ses forces, sécurise ses frontières, et paie le prix fort pour sa souveraineté. Les autorités de la Transition incarnent cette farouche volonté de rompre avec les anciennes dépendances. Mais cette option résolue ne pourra tenir que si les menaces périphériques sont contenues. Et la Mauritanie, aujourd’hui, représente l’une des plus préoccupantes.
Il ne s’agit plus de diplomatie, mais de sécurité collective. Le Sahel ne peut tolérer qu’un État voisin serve de base arrière aux ennemis de la paix. La Mauritanie doit être mise face à ses responsabilités. Car dans cette guerre, l’inaction est une forme d’assistance. Et l’absence d’attaques sur son sol ne prouve pas sa force, mais révèle son «pacte».
La Rédaction
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0