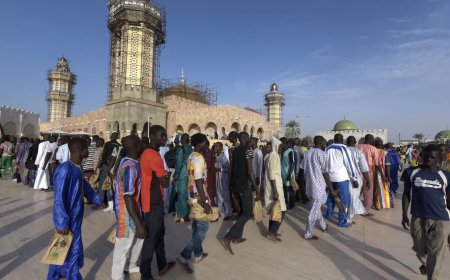Heure malienne : Quand le retard devient une norme sociale
Au Mali, arriver en retard n’est pas une exception, c’est souvent la règle. Derrière cette pratique banalisée se cache une logique collective, culturelle et psychologique qui façonne les interactions quotidiennes. Mais à quel prix ?

Ce reportage explore les racines du phénomène, ses conséquences sur la vie sociale et professionnelle, et les pistes pour réconcilier chaleur humaine et rigueur temporelle.
Il n’est pas rare qu’une réunion prévue à 14 h débute à 15 h passées. Pour comprendre les ressorts de cette pratique, nous avons recueilli l’analyse de Daouda Guindo, psychologue spécialisé en dynamique sociale, ainsi que plusieurs témoignages de citoyens.
Selon M. Guindo, le retard n’est pas une question de personnalité individuelle, mais de conformité sociale. "Le retard au Mali s’explique par le conformisme. Les gens s’adaptent aux pratiques collectives. Même une personne ponctuelle finit par se caler sur l’horaire réel du groupe, parce que c’est la norme implicite", explique-t-il.
Ce constat est partagé par Mariam, habituée des événements associatifs. "Si tu arrives à l’heure ici, tu finis seule. On sait que ça ne commencera pas tout de suite, alors pourquoi se presser ?", s’interroge-t-elle.
Bassékou Sidibé, lui, dénonce une absence de rigueur généralisée. "On banalise le retard parce qu’il n’y a jamais de conséquence. Si on veut changer, il faut que la ponctualité devienne une vraie valeur", affirme-t-il.
Une souplesse culturelle… aux effets pervers
Pour le psychologue, cette habitude s’enracine aussi dans une conception culturelle du temps.
"Il y a un rapport plus souple au temps dans certaines cultures africaines, où la priorité est donnée aux interactions humaines plutôt qu’à l’horloge. Mais quand cette souplesse devient systématique, elle peut freiner l’efficacité collective", ajoute M. Guindo.
Seydou Sissoko, cadre dans une ONG, partage une anecdote révélatrice. "Une fois, je suis arrivé pile à l’heure pour une réunion. Devine quoi ? Rien n’était prêt. J’ai attendu quarante minutes. Depuis, je prends mon temps".
Cette logique d’alignement sur la majorité crée un cercle vicieux : plus les gens arrivent en retard, plus ceux qui étaient ponctuels finissent par s’y conformer. Et les effets sont tangibles.
"Ce phénomène touche tous les secteurs : il réduit la productivité, complique les collaborations professionnelles, et donne une image peu fiable aux partenaires internationaux", souligne M. Guindo.
Habiba, étudiante, en rit jaune. "Si la personne n’est pas là au bout de trente minutes, je rentre chez moi. Flemme".
Vers une culture de la ponctualité
Pour sortir de cette spirale, le psychologue propose une approche collective. "Les organisateurs doivent montrer l’exemple en commençant à l’heure. Les institutions doivent sensibiliser au respect du temps, et la société doit valoriser la ponctualité comme signe de respect", recommande-t-il.
Il ne s’agit pas de renier la chaleur humaine propre aux interactions maliennes, mais de trouver un équilibre entre convivialité et efficacité. "Changer une norme sociale demande du courage et de la persistance. Mais si quelques groupes commencent à l’heure, ils peuvent inspirer les autres", conclut le psychologue.
Si "l’heure malienne" amuse parfois, elle reste un frein à l’efficacité collective. Pour inverser la tendance, il faudrait transformer la ponctualité en valeur sociale reconnue. Le défi est grand, mais pas insurmontable. Car l’heure malienne n’est pas une fatalité : c’est une habitude. Et les habitudes, elles, peuvent changer. Preuve qu’au Mali aussi, commencer à l’heure… c’est possible.
Nènè Mah Zasso Théra
(stagiaire)
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0