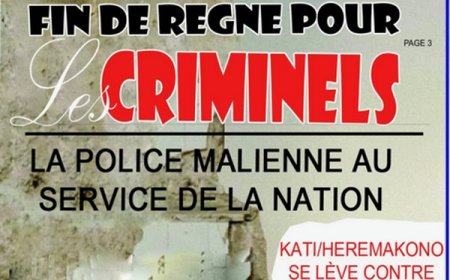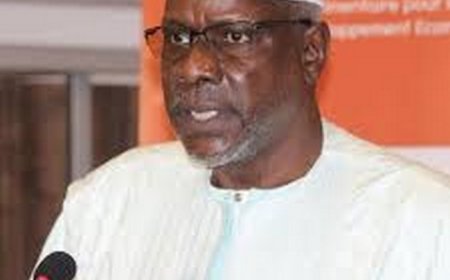La Gouvernance à l’Épreuve de la Dignité : Une Méditation pour les Peuples en Quête de Sens
Il est des temps où le silence devient complice et, l’attente, un luxe que l’Histoire ne pardonne pas.

Dans certaines terres, riches d’âme et de mémoire, le peuple continue de porter le poids d’un monde qui semble ne jamais tenir ses promesses. Et pourtant, ce peuple endure, espère, se lève… parfois dans la douleur, parfois dans l’oubli. Il est alors temps, non pas de juger, mais de penser. De penser avec profondeur, avec rigueur, et avec une foi inébranlable en la dignité humaine.
«Le prix de la liberté est une vigilance éternelle», disait Thomas Jefferson. Mais que vaut la vigilance dans un espace où le pouvoir devient une fin en soi, où l’État, au lieu de s’ériger en rempart contre la misère, s’efface, laissant place au chaos, à l’ombre des hommes ? Lorsque l’ordre devient désordre, lorsque la loi devient un instrument d’humiliation plutôt qu’un pacte de justice, alors la société n’est plus un corps vivant, mais un champ de ruines morales.
Il faut le dire sans détour : le problème n’est pas seulement dans les armes, dans les frontières ou dans les discours creux que l’on répète comme des litanies. Le problème est plus ancien, plus profond, presque métaphysique. Il est dans le contrat invisible entre ceux qui gouvernent et ceux qui obéissent. Un contrat rompu. Brisé par l’avidité, la peur, le cynisme.
Platon, dans La République, avertissait déjà : «Le prix que les bons paient pour leur indifférence à la politique, c’est d’être gouvernés par des hommes pires qu’eux.» Il ne s’agissait pas seulement d’une mise en garde contre l’apathie civique. C’était un cri, un avertissement prophétique sur le fait que la décadence naît toujours dans le cœur des justes, lorsqu’ils abandonnent le combat de la vérité par lassitude ou par résignation.
Là où l’État chancelle, où la justice vacille, où le mérite est inversé, où la trahison devient habitude et la compromission une vertu politique, l’homme n’est plus un citoyen : il devient une variable, un pion, un corps jeté dans le néant. On ne naît plus pour construire, mais pour survivre. Et pourtant, ce n’est pas la fatalité. Jamais. Car la grandeur d’un peuple ne réside pas dans le nombre de ses soldats ni dans la hauteur de ses murailles, mais dans la force morale de ses institutions et la clarté de son horizon.
«Gouverner, c’est servir, non se servir», enseignait Confucius. Mais combien s’en souviennent encore ? Le pouvoir, dans sa forme la plus noble, est une délégation sacrée. Il n’appartient pas à celui qui le détient, mais à ceux qui en subissent les effets. Un dirigeant digne est celui qui comprend que chaque décision engage non seulement le présent, mais aussi la mémoire des ancêtres et le regard des générations futures.
Alors, que faire ? Faut-il se taire ? Se contenter de demi-vérités et de compromis vides ? Certainement pas. Car «l’insoumission à l’injustice est un devoir sacré», disait Gandhi. Il ne s’agit pas de désobéir par haine, mais de résister par amour : amour de la vérité, amour de la justice, amour d’un peuple qui mérite mieux que ce qu’on lui inflige.
La gouvernance est une question de philosophie avant d’être une affaire de stratégie. Elle repose sur une vision claire de l’homme : est-il un sujet à dominer ou un être à libérer ? Tant que ceux qui prétendent gouverner n’auront pas médité sur cette question, il n’y aura ni paix véritable, ni prospérité durable. « Là où il n’y a pas de vision, le peuple périt », dit un ancien proverbe hébreu. Et en effet, sans vision, les peuples errent, tournent en rond, recommencent les mêmes erreurs, prisonniers d’un éternel retour du mal.
Mais espérer ne suffit pas. Il faut bâtir. Et pour bâtir, il faut d’abord assainir les fondations. Cela commence par l’éducation; non pas seulement l’apprentissage des lettres, mais l’éveil de la conscience. Car un peuple éduqué est un peuple libre. Et un peuple libre est un peuple exigeant. Il ne se contente plus de slogans, il demande des comptes. Il exige de ses élites non des promesses, mais des preuves.
Nietzsche disait : «Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment.» Le peuple a un pourquoi. Il a une histoire, une fierté, une culture. Ce qui lui manque, parfois, c’est une direction claire, une boussole morale, une main ferme mais juste. Le moment est venu pour chacun, du plus humble au plus puissant, de se demander : que laisserons-nous derrière nous ? Un héritage de peur ou une civilisation de justice ?
Ce texte n’est ni un réquisitoire, ni une supplique. C’est une offrande de pensée. Un miroir tendu à ceux qui osent encore réfléchir. Car penser, c’est déjà résister. Et résister, c’est préparer l’aurore. Loin des querelles éphémères, loin des manipulations de surface, il nous faut retrouver la profondeur. Celle des sages, celle des bâtisseurs de destin.
Le défi n’est pas dans l’ennemi extérieur, ni même dans le passé. Le défi est dans l’âme collective. Dans notre capacité à choisir, à dire non à la bassesse et oui à l’exigence. Dans notre aptitude à redevenir souverains, non seulement dans les mots, mais dans les actes, dans les rêves, dans la justice rendue à chacun.
Et pour cela, il faudra du courage. Beaucoup de courage. Le courage de ceux qui ne trahissent pas leur conscience, même lorsque la peur est grande. Le courage de ceux qui savent que gouverner un peuple, c’est d’abord l’aimer. Vraiment.
Car au bout du compte, ce n’est pas le pouvoir qui fait la grandeur d’un État, mais la manière dont il traite les plus vulnérables de ses enfants.
Usman Dede
Quelle est votre réaction ?
 Like
1
Like
1
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0