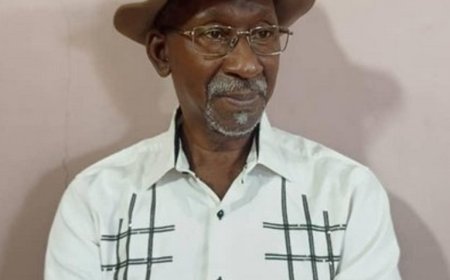Googan Tan ; "Dura Lex, Sed Lex [La loi est dure, mais c'est la loi]" : Sarkozy, face au fantôme de Kadhafi, paye la facture
Il est des séismes politiques qui ébranlent les certitudes et dépassent les frontières. La condamnation à une peine ferme de l'ancien président français Nicolas Sarkozy appartient à cette catégorie.
![Googan Tan ; "Dura Lex, Sed Lex [La loi est dure, mais c'est la loi]" : Sarkozy, face au fantôme de Kadhafi, paye la facture](https://www.maliweb.net/uploads/images/202504/SEIDINA-OUMAR-DICKO.jpg)
Inédite en France, exemplaire par sa portée universelle, connue au Mali comme ailleurs sur le continent, elle rappelle partout une vérité cardinale : nul, fût-il chef d'État, ne saurait se placer au-dessus des lois.
Concernant Sarkozy, dans le contexte français, la note est salée et l'affaire dépasse le simple cadre judiciaire. Elle fissure le mythe de l'immunité des puissants et met fin à cette illusion d'un privilège d'impunité réservé aux dirigeants. Pour la première fois, un ex-président français goûtera à la rigueur carcérale. Ironie tragique : celui qui aurait sollicité des fonds libyens pour financer sa campagne de 2007 est le même qui, quelques années plus tard, contribua à la chute sanglante de Mouammar Kadhafi et, indirectement, l'histoire dira si cela fut voulu, à l'expansion du djihadisme au Sahel et à l'entraînement de l'irrédentisme rebelle au Mali.
Comme si les fantômes de Tripoli lui présentaient aujourd'hui la facture, celui qui, jadis, promettait de " nettoyer la racaille au Karcher " dans les banlieues françaises, et présentait l'Afrique comme " peu entrée dans l'histoire ", y entre à son tour, mais à rebours : pris dans une association de malfaiteurs aux pratiques dignes, sinon pires, que celles qu'il dénonçait.
Au-delà de l'Hexagone, dis-je, ce verdict résonne avec d'autres épisodes où la justice a osé se dresser face aux géants. Le Mali, à sa manière, n'est pas étranger à cette exigence de responsabilité : Moussa Traoré comme Amadou Aya Sanogo, deux anciens présidents, ont comparu devant les juges, lesquels ont alors tranché avec un courage, à mon avis, insoupçonné. À cet égard, j'insiste dessus, notre pays a certes connu plusieurs coups d'État, mais aucun n'a conduit à l'exécution d'un ancien président ni à une décapitation, comme ailleurs. Signe que, malgré les errements, le sens de la mesure a prévalu au Mali.
Ailleurs, la même dialectique entre pouvoir et justice se déploie. En Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz, au Brésil, Lula puis Bolsonaro, tous ont expérimenté la rigueur judiciaire. Au Sénégal, les magistrats ont donné une leçon de droiture républicaine : le Conseil constitutionnel a contraint Macky Sall, alors président, à respecter le calendrier électoral de 2024, empêchant ainsi un glissement autoritaire, tandis que la Cour suprême du Sénégal a débouté récemment le Premier ministre Ousmane Sonko, refusant toute instrumentalisation politique du droit. Ces décisions, courageuses et lucides, ont réaffirmé que la justice n'est pas condamnée à demeurer un simple appendice de l'exécutif.
Ce n'est pas tout, en République centrafricaine, au Malawi, en Côte d'Ivoire également, des juges ont eu le courage, à un moment crucial de leur histoire, de dire non au pouvoir. Le magistrat ivoirien surnommé Épiphane Zoro dit "Zoro", qui osa délivrer un certificat de nationalité à Alassane Ouattara contre la volonté du régime d'alors, demeure à ce titre un symbole de cette insoumission éclairée. Et le Mali d'aujourd'hui, dans tout cela ? Il avance certes, à tâtons, sur une ligne de crête entre pressions et espérances. La semaine judiciaire qui vient de s'achever illustre la vitalité d'une institution en quête d'équilibre, avec deux affaires emblématiques : le procès de Moussa Mara et la bataille juridique pour la restauration des partis politiques.
Le 29 septembre, le Pôle national de lutte contre la cybercriminalité a jugé l'ancien Premier ministre, poursuivi pour un tweet jugé attentatoire à l'ordre public. Le parquet a requis une peine de prison ferme, tandis que la défense plaidait la relaxe. Le verdict est attendu pour le 27 octobre.
Sur un autre front, un collectif d'avocats s'emploie à faire annuler la dissolution des partis politiques. L'enjeu est clair : obtenir une décision de principe qui redéfinira la frontière entre le pouvoir exécutif et le droit fondamental des citoyens à l'expression politique.
Enfin, l'affaire impliquant deux membres du Conseil national de Transition (CNT), ajournée au 27 novembre, me paraît emblématique : elle a révélé une justice souvent freinée par des questions d'immunité et par des exigences financières, notamment une consignation fixée à 5,5 millions de francs CFA. Mais malgré ces obstacles, le mouvement est lancé. La justice malienne devra désormais se frayer un chemin entre volonté de contrôle et besoin de liberté, en gardant à l'esprit que le recours au droit demeure l'ultime espérance.
Ces affaires démontreront que la justice peut incarner un espoir. Elle ne sera plus seulement, aux yeux d'une opinion échaudée, un instrument punitif, mais le dernier rempart contre l'arbitraire, la garantie d'une société fondée sur le droit plutôt que sur la force.
À Paris, Dakar, Bamako ou Nouakchott, les robes noires ont rappelé, à un moment donné, que la grandeur d'une nation ne se mesure pas à la puissance de ses dirigeants, mais à la solidité de ses institutions. Et quand la justice ose, elle élève la République tout entière.
DICKO Seidina Oumar
Journaliste - Historien - Écrivain
Quelle est votre réaction ?
 Like
1
Like
1
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0