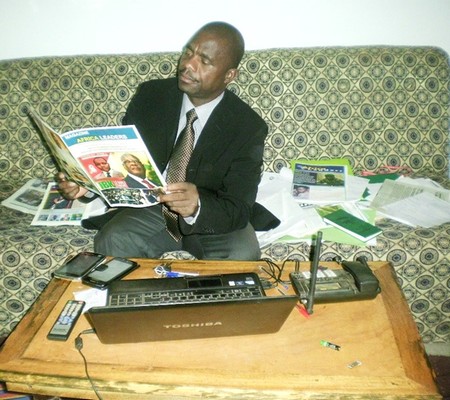Militantes de la promotion féminine au Mali : Un grand apport qui n’empêche pas la stigmatisation
Les femmes engagées dans la promotion des droits humains, particulièrement pour les droits de la femme, sont parfois victimes de violences et de stigmatisation, cela, malgré leur contribution significative à la protection humaine, à la stabilité sociale et économique des communautés dans notre pays.

Les acteurs évoluant dans le domaine des droits humains, en particulier les femmes, font face à d’énormes défis, notamment des préjugés et stéréotypes associés au concept « Droits humains » souvent perçu par méconnaissance ou par fausses informations comme « un instrument en déphasage avec les normes sociétales ».
Selon Bréhima Ballo, responsable des programmes de l’Association Malienne pour le Suivi et l’Orientation des Pratiques Traditionnelles (AMSPOT), « elles mènent un combat audacieux dans un contexte patriarcal où le pouvoir décisionnel est majoritairement masculin. Ces militantes sont souvent perçues négativement dans la communauté, particulièrement par des hommes, qui entretiennent des préjugés à leur égard. Elles sont souvent jugées à tort par ces derniers comme des insoumises voire des immorales ».
Un avis largement partagé par Maïmouna Dioncounda Dembélé, militante des Droits Humains. Selon elle, les femmes ne sont généralement pas attendues sur la scène publique, mais plutôt dans la sphère privée, où elles sont censées gérer la maison et se tenir derrière un mari, un père ou un frère. « Toutes femmes qui se retrouvent sur la scène publique, qu’il s’agisse de femmes politiques ou activistes des droits humains, sont systématiquement confrontées à de la stigmatisation », Maïmouna Dioncounda Dembélé, notant que les militantes pour la promotion féminine font face à une stigmatisation plus accrue. Maïmouna souligne que, parce qu’elles transmettent des informations à d’autres, on pense qu’elles les incitent à ne pas se soumettre, poussent les épouses à fuir ou à se « libérer » de leur foyer.
Préjugés et Stigmatisation
Parlant des préjugés, Bréhima Ballo déclare « certains hommes jugent ces militantes d’insoumises, d’aigries et d’acharnées contre les hommes, de frivoles ou d’infidèles, incapables de tenir un foyer, mais ceux qui les accusent n’ont souvent aucune preuve. La plupart du temps, ces accusations sont liées à la calomnie et à la médisance car ces femmes ne sont pas conformistes et n’acceptent d’être conformistes. Car elles ont choisi l’opportunité qu’offre le contexte législatif malien pour s’organiser et accompagner d’autres femmes à défendre leurs droits ».

Ces clichés péjoratifs sont repris par Maïmouna Dioncounda Dembélé, qui se joint à Ballo pour dire : « dans notre société, il existe tellement de stéréotypes liés au genre. Et comme les femmes défenseures des droits humains doivent s’exprimer, défendre leurs convictions et soutenir les autres. Et le fait qu’on ne les attende pas à ce statut, parce que ce n’est pas le rôle socialement attribué, peut amener les gens à les voir d’un mauvais œil ».
« Souvent les stigmatisations proviennent des collaborateurs, y compris d’autres femmes, et sont plus prononcées lorsque la femme ne répond pas à certaines attentes sociales, comme le fait de ne pas être mariée ou avoir d’enfants. Il existe tellement de stéréotypes autour des militantes, elles sont parfois vues comme des personnes sans valeur morale, « assimilées », trop « libérées », peu fréquentables, mœurs légères, incapables de tenir un foyer, de s’occuper d’un mari, ou avoir des enfants », a-t-elle ajouté.
Contribution Sociale et Economique

Brehima Ballo
Nonobstant les défis liés à leur engagement et à une certaine incompréhension de leurs actions, ces femmes contribuent beaucoup à la promotion et la protection des droits des femmes. « Ces femmes défenseures des droits humains ont sauvé de nombreuses vies, contribué à l’épanouissement de nombreuses femmes, ont réparé beaucoup d’injustices et empêché de nombreux mariages forcés et mariages précoces, ont lutté contre l’excision, les violences physiques », témoigne Bréhima Ballo, responsable des programmes de l’AMSPOT. Il souligne également que, grâce au combat de ces militantes, les violences basées sur le genre ont été prises en compte dans le nouveau Code pénal.
Des témoignages des bénéficiaires viennent renforcer les propos de M. Ballo. En effet, Awa Kébé, bénéficiaire de l’accompagnement de la Maison de la Femme de la Rive Gauche de Bamako, affirme : « j’ai eu des problèmes dans mon foyer, après mon mariage, à la perte de l’emploi de mon mari, j'ai été déclarée comme malchanceuse par ma belle-famille. Mise de côté sans aucune source de revenu et aucune aptitude professionnelle, j’étais laissée à moi-même avec mes enfants en instance de divorce. C’est grâce à la Maison de la Femme que j'ai appris de nouvelles compétences et je parviens maintenant à subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants ».
De même, Assétou Guindo, une veuve d’une quarantaine d’années résident à Ségou, soutient l’impact positif des structures de défense des droits humains. Elle raconte qu’après le décès de son mari, elle a été expulsée de son domicile avec ses enfants. Et c'est à travers l'intervention d’une militante de la Coordination des Associations et ONG Féminines (CAFO) qu'elle a pu retrouver son logement et reconstruire sa vie.
Meilleure compréhension des Droits Humains
Face à certains acharnements et à des agressions verbales dirigées contre des militantes de la promotion des droits humains, Maïmouna Dioncounda Dembélé déplore les commentaires sur les réseaux sociaux, ainsi que les mensonges et les rumeurs qui circulent à l’encontre des défenseurs des droits humains, simplement en raison de leurs convictions. Selon elle, ce phénomène entraîne un burn-out militant chez de nombreuses femmes, qui finissent par arrêter de militer pour préserver leur santé mentale et physique.
Aussi, elle invite à une démystification des droits humains afin de déconstruire l'idée selon laquelle que ceux sont des valeurs occidentales. Pour Maïmouna Dembélé, il faut puiser dans nos valeurs endogènes et amener les communautés et terroirs à montrer que les droits humains ne sont pas des valeurs occidentales, mais qu'ils s'alignent parfaitement avec nos valeurs traditionnelles, culturelles et religieuses. De plus, elle invite les leaders communautaires, religieux, ainsi que les politiques à tenir des discours plus sensibles aux questions de genre et aux droits humains, qui valorisent davantage le travail des acteurs du domaine.
Khadydiatou Sanogo/maliweb.net
Ce reportage est publié avec le soutien de Journalistes pour les Droits Humains ( JDH) et NED au Mali
Quelle est votre réaction ?
 Like
1
Like
1
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0