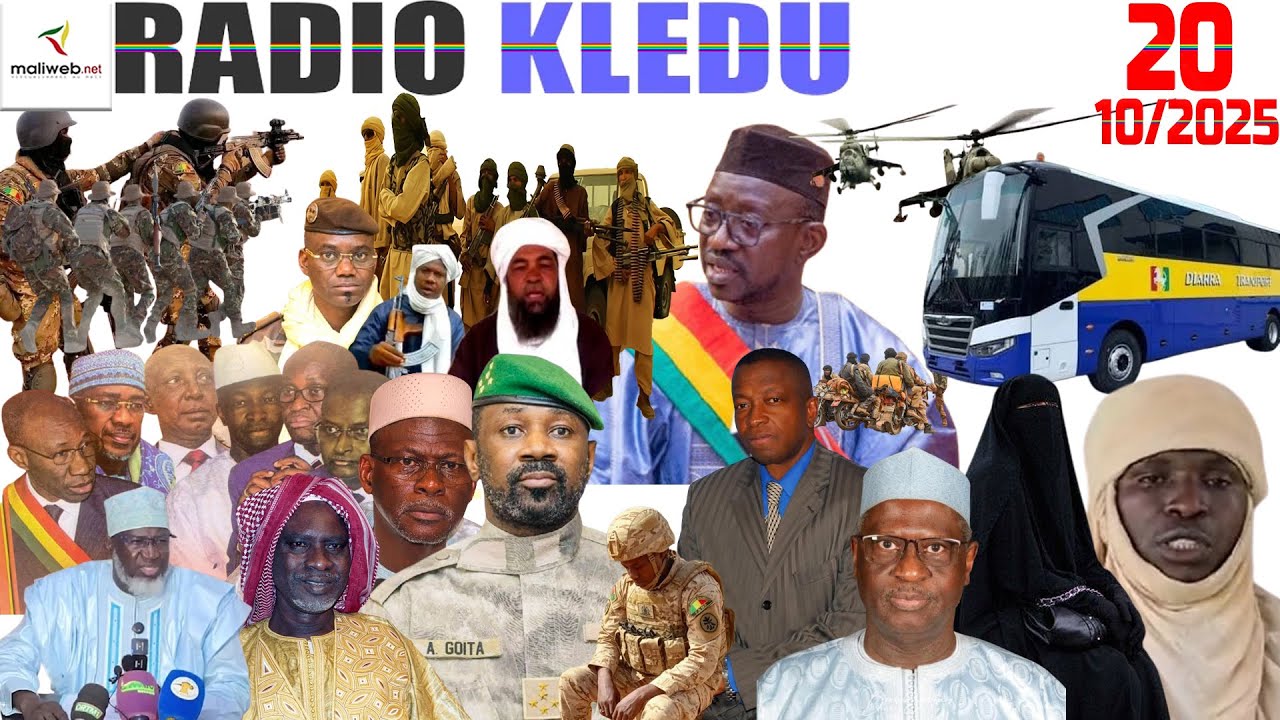Du franc cfa à la quête d'autonomie : Le Sahel face à un choix crucial
Dans les marchés vibrants de Bamako, les ports animés de Dakar et les champs de coton du Burkina Faso, une question résonne avec une intensité croissante: Et si le destin économique du Sahel ne dépendait plus de Paris ou de Bruxelles, mais d'une monnaie forgée par et pour les peuples de cette région ?

Longtemps arrimés au Franc CFA, symbole pour beaucoup d'une dépendance post-coloniale persistante, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, unis au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES), brandissent désormais l'étendard d'une monnaie commune. Cette ambition, portée par la volonté de briser les chaînes d'une intégration régionale jugée inéquitable, soulève un vent d'espoir mais aussi de profondes interrogations. Est-ce le chemin vers une véritable émancipation économique, ou un pari risqué aux conséquences imprévisibles pour des économies déjà fragiles ?
Les Fondements d'une Révolution Monétaire
L'idée d'une monnaie commune au Sahel n'est pas un simple caprice politique; elle est le fruit d'un profond sentiment d'injustice économique et d'une aspiration à la pleine souveraineté.
1. Mettre fin à la "Servitude Monétaire": Le Franc CFA, adossé à l'euro, garantit certes une stabilité louable, mais il prive les États de l'AES d'un levier essentiel: la politique monétaire. Imaginons un jeune entrepreneur malien, Fatoumata, qui peine à obtenir un prêt bancaire à des taux avantageux pour développer son entreprise de transformation de mangues séchées. Les critiques estiment que la politique de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), axée sur la stabilité des prix, ne favorise pas suffisamment le financement de l'économie locale. Une monnaie propre permettrait au Sahel de baisser les taux d'intérêt pour stimuler l'investissement national, ou d'injecter des liquidités pour soutenir des secteurs clés en période de crise, sans l'approbation d'une institution perçue comme "extérieure".
2. Stimuler le commerce intra-régional: Aujourd'hui, acheter des céréales du Niger pour les vendre au Burkina Faso implique des coûts de change et des tracasseries administratives. Une monnaie unique éliminerait ces frictions, rendant le commerce transfrontalier plus fluide et moins cher. Pensez à Amadou, un commerçant nigérien qui traverse régulièrement la frontière pour vendre ses produits agricoles. Avec une monnaie commune, il n'aurait plus à se soucier des taux de change fluctuants, ce qui augmenterait ses marges et encouragerait davantage d'échanges entre les pays de l'AES. C'est la promesse d'un marché intérieur sahélien plus vaste et plus dynamique, capable de concurrencer les importations et de renforcer la résilience économique face aux chocs externes.
3. Attirer des investissements ciblés: Un espace monétaire unifié et une politique monétaire autonome pourraient envoyer un signal fort aux investisseurs. La possibilité de contrôler leur monnaie permettrait aux États du Sahel de créer un environnement financier plus prévisible et potentiellement plus attractif pour les investissements directs étrangers qui soutiennent leurs priorités de développement, plutôt que de dépendre d'une monnaie dont la valeur est décidée à des milliers de kilomètres.
Les ombres au tableau: Un chemin semé d'embûches
Malgré ces aspirations légitimes, le passage à une monnaie commune est loin d'être une promenade de santé.
1. Le défi de la stabilité: Le Franc CFA a le mérite de la stabilité et de la convertibilité, des atouts non négligeables pour des économies dépendantes des importations et des marchés internationaux. Une nouvelle monnaie sahélienne serait confrontée au défi colossal d'établir sa crédibilité et de maintenir sa valeur. Sans des réserves de change suffisantes et une discipline budgétaire rigoureuse, elle pourrait être sujette à une dépréciation rapide et à l'inflation, minant le pouvoir d'achat des citoyens et la confiance des investisseurs.
2. Des économies disparates: Bien que voisins, le Mali, le Niger et le Burkina Faso présentent des structures économiques différentes, des niveaux de développement variés et des défis budgétaires propres. Harmoniser les politiques fiscales et budgétaires, condition sine qua non d'une monnaie commune réussie, s'annonce comme un véritable casse-tête. Comment concilier les besoins de financement du développement du Niger avec les impératifs de stabilité macroéconomique du Burkina Faso, par exemple ?
3. Le pari de la confiance: L'abandon du Franc CFA représente une rupture majeure, non seulement avec les anciennes puissances coloniales, mais aussi avec un système qui, malgré ses défauts, a offert une certaine stabilité pendant des décennies. Convaincre les citoyens, les entreprises et les partenaires internationaux de la fiabilité de cette nouvelle monnaie nécessitera une communication transparente et des résultats concrets rapides.
L'Avenir du Sahel: Entre audace et pragmatisme
La quête d'une monnaie commune au Sahel est un acte d'affirmation de la souveraineté économique. Elle témoigne d'une volonté farouche de prendre en main le destin d'une région confrontée à des défis immenses, allant de l'insécurité au changement climatique. Si les avantages potentiels sont séduisants, une meilleure allocation des ressources, un commerce régional stimulé, un financement accru des entreprises locales, les risques sont également considérables. La réussite de ce projet audacieux dépendra d'une planification méticuleuse, d'une coordination politique sans faille et d'un engagement inébranlable à la discipline économique. Le Sahel est à la croisée des chemins: va-t-il tracer une nouvelle voie vers la prospérité et l'autonomie, ou se perdre dans les méandres d'une transition trop rapide et mal préparée ? Le monde observe, attentif à cette audace qui pourrait redéfinir les équilibres économiques en Afrique de l'Ouest.
A.K. DRAMÉ, journaliste indépendant, analyste et chercheur en Stratégie de Croissance Accélérée, Enjeux et Innovations du Développement Durable
Encadré :
CEDEAO et UEMOA: Le revers de la médaille pour les économies locales ?
Dans le débat houleux autour de la monnaie et de l'intégration économique en Afrique de l'Ouest, une critique persistante émerge : celle de savoir si les structures régionales comme la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) ont réellement profité de manière équitable à tous les acteurs. Pour de nombreux analystes africains, la réponse est nuancée, pointant du doigt un déséquilibre flagrant en faveur de certaines entreprises étrangères, notamment françaises.
Un marché ouvert, des opportunités inégales
L'objectif affiché de la CEDEAO et de l'UEMOA est de créer un marché commun où biens, services et capitaux circulent librement, stimulant ainsi la croissance. Cependant, la réalité du terrain, selon certains, est que ce cadre a avant tout bénéficié aux grandes entreprises étrangères, déjà bien établies et capitalisées.
Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire, souvent présentée comme le moteur économique de l'UEMOA. Ici, des géants français comme Bolloré (logistique portuaire), Orange (télécommunications) ou des entreprises de grande distribution sont omniprésents. Leur capacité financière, leur expertise et leurs réseaux déjà constitués leur ont permis de tirer pleinement parti de la suppression des barrières douanières et de la libre circulation. De même au Sénégal, où des entreprises comme Eiffage (construction) ou TotalEnergies (distribution de carburants) maintiennent une forte emprise sur des secteurs clés.
Au Nigeria, géant anglophone de la CEDEAO, bien que le marché soit plus diversifié, les multinationales étrangères continuent de dominer des pans entiers de l'économie, notamment dans le pétrole et le gaz. Le reproche est que la compétition n'est pas équitable : les entreprises locales, souvent des PME, peinent à rivaliser avec ces mastodontes qui ont un accès privilégié aux financements et aux marchés.
La BCEAO, bouc émissaire du financement local ?
La critique est particulièrement virulente à l'égard de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), l'institution monétaire de l'UEMOA. Il lui est souvent reproché de privilégier la stabilité monétaire au détriment du financement du développement et des entreprises locales.
Pour de nombreux entrepreneurs sahéliens, obtenir un prêt bancaire est un parcours du combattant. Les banques, souvent filiales de groupes français ou internationaux, sont perçues comme frileuses à accorder des crédits aux PME africaines, jugées trop risquées ou manquant de garanties suffisantes. Au contraire, les grandes entreprises étrangères, avec leurs bilans solides et leurs maisons mères réputées, auraient un accès facilité aux financements, renforçant ainsi leur position dominante.
Un jeune agriculteur au Burkina Faso, cherchant à moderniser sa ferme, ou une femme entrepreneure au Mali voulant développer son activité artisanale, se heurtent souvent à des exigences bancaires inaccessibles, tandis que des multinationales peuvent mobiliser des capitaux importants pour étendre leurs opérations. Cette réalité nourrit le sentiment que les règles du jeu économique ne sont pas établies en faveur du développement endogène.
Conséquences et aspirations du Sahel
Cette perception, largement répandue, a contribué à alimenter la frustration et le désir d'autonomie des États du Sahel. Pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso, se désengager de ces structures n'est pas seulement une question politique, c'est aussi une aspiration à reprendre le contrôle de leviers économiques et monétaires qu'ils estiment aujourd'hui au service d'intérêts qui ne sont pas les leurs. Ils espèrent ainsi créer un environnement où les entreprises locales pourront enfin prospérer, loin de l'ombre des géants étrangers.
A.K. DRAMÉ
Quelle est votre réaction ?
 Like
6
Like
6
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0