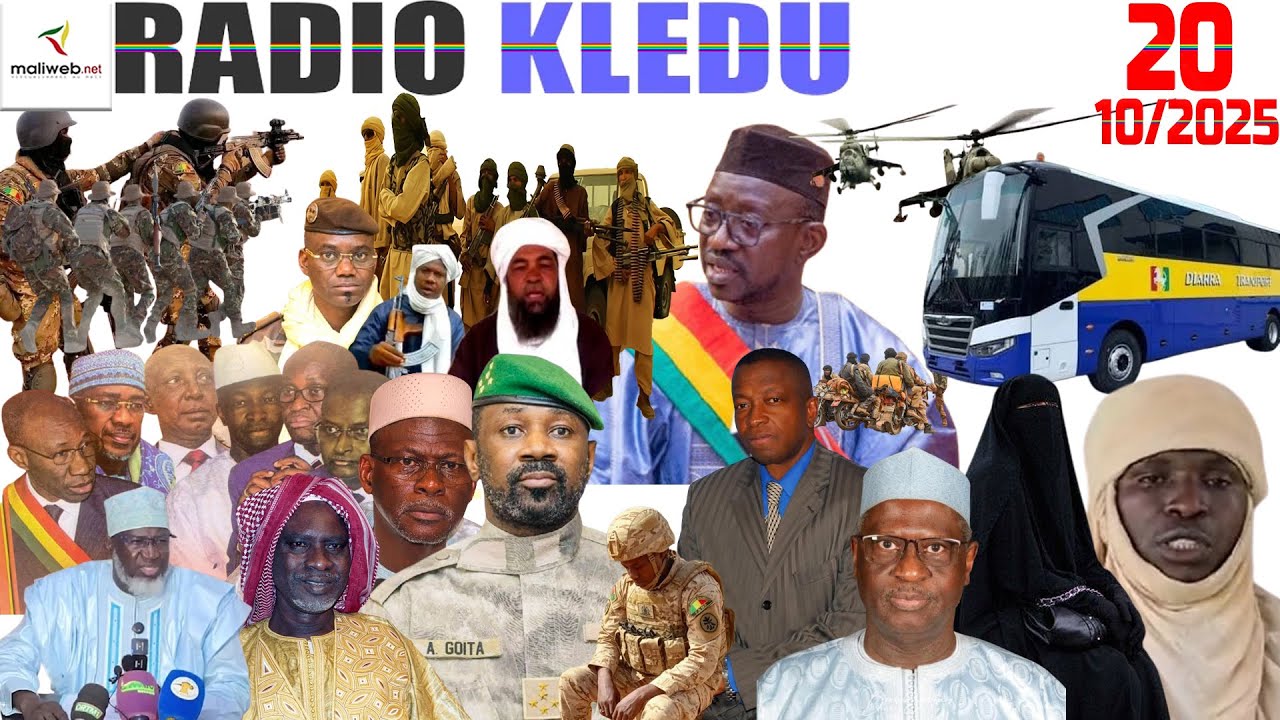Essai – les mines invisibles : ce qui ronge l’amé du Mali : « L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l’équation. », Averroès.
La tentation serait grande d’expliquer la crise malienne par des éléments visibles : les groupes armés, les ingérences étrangères, les rébellions récurrentes, la pauvreté endémique, ou l’instabilité institutionnelle.

Ces réalités sont certes indiscutables. Mais elles ne forment que la partie émergée d’un iceberg bien plus vaste et insidieux. La véritable crise qui secoue le Mali est d’abord une crise de pensée, une défaite intellectuelle, une résignation collective face à trois maux structurels et durables : l’ignorance, les superstitions et le fatalisme (voir Konaté, Des mines « antinational » à l’origine de la crise malienne, 2023, 94 pages).
Ce ne sont pas là des pathologies typiquement maliennes. Elles ont traversé l’histoire de tous les peuples. L’Europe elle-même, avant d’asseoir ses États modernes, a connu de longs siècles d’obscurantisme, marqués par le dogme religieux, l’exclusivisme du savoir, et la soumission aveugle à un ordre prétendument naturel. Des siècles de violence, de guerres civiles, de persécutions, de pauvreté chronique — jusqu’au jour où une rupture a eu lieu : non pas une révolution politique immédiate, mais une révolte du savoir, un soulèvement des consciences contre l’ignorance imposée.
Ce moment charnière a vu émerger des penseurs, des savants, des humanistes. Il a donné naissance à un projet politique fondé sur la raison, la science, la tolérance et la dignité humaine. C’est en brisant l’interdiction du libre-arbitre, en s’ouvrant à la critique, en démocratisant la connaissance, que l’Europe est progressivement sortie de l’ombre. Non sans heurts. Non sans rechutes. Mais avec une direction, une vision, un horizon.
L’héritage colonial et le piège du mimétisme
En Afrique, cette révolution du savoir n’a pas suivi le même chemin. Ce que les puissances coloniales combattaient chez elles, elles l’ont souvent semé dans leurs colonies. Là où elles brisaient les dogmes chez elles, elles en construisaient d’autres ailleurs : un savoir colonial, hiérarchisé, racialisé, où la science servait la domination et l’ignorance des masses était jugée fonctionnelle.
À l’indépendance, au lieu de décoloniser profondément les structures mentales, les élites africaines ont souvent reproduit les mécanismes de pouvoir et de contrôle appris sous le joug colonial. L’école est restée verticale et distante. Le savoir n’a pas été rendu à la société. La pensée critique n’a pas été encouragée. Et, pire encore, l’ignorance a parfois été organisée, entretenue, voire manipulée pour servir des intérêts politiques.
C’est ainsi que l’on a vu se répandre, dans de nombreux États africains, un pouvoir qui ne gouverne plus au nom d’une vision, mais au nom d’une habitude. Un pouvoir qui ne pense pas, qui réagit. Un pouvoir qui redoute l’intelligence, qui méprise le débat, qui instrumentalise la religion et déforme l’histoire. En un mot : un pouvoir qui cède au fatalisme.
Le Mali, entre résignation d’en haut et ignorance d’en bas
Le Mali est l’un des exemples les plus frappants de cette impasse. Depuis la crise de 2012, le pays est plongé dans une spirale de désagrégation politique, sécuritaire et institutionnelle. Les États se succèdent, les Constitutions se contredisent, les accords de paix s’enchaînent, les acteurs changent… mais les logiques de fond, elles, demeurent.
Le peuple malien n’est pas en cause. C’est la relation entre les gouvernants et le savoir qui pose le plus problème. Depuis fort longtemps, les élites n’ont jamais vraiment investi dans une culture politique de masse, dans l’éducation populaire, dans la formation de citoyens critiques et éclairés. L’université malienne, autrefois de grandes Ecoles moteur d’idées, ou devrais-je dire mer de courants de pensée, s’est appauvrie. Les chercheurs sont marginalisés. La justice est contestée. La parole est étouffée ou manipulée.
Dans un tel contexte, l’ignorance devient un outil de contrôle, et le fatalisme une stratégie d’adaptation collective. Des gouvernants se réfugient derrière le discours de la souveraineté, tout en sous-traitant des pans de la sécurité à des puissances étrangères ou à des groupes de sécurité mercantile. Les populations, privées de repères, oscillent entre résignation et colère. Et le pays tout entier s’enlise.
Une souveraineté sans pensée est une coquille vide
On parle beaucoup, depuis quelques années, de « souveraineté retrouvée », de « refondation », de « rupture ». Ces termes sont forts. Mais sans une véritable révolution intellectuelle, ils resteront des slogans. On ne bâtit pas un État solide sans institutions intelligentes, sans justice indépendante, sans éducation critique, sans presse libre, sans vision du monde.
Ce n’est pas un hasard si les grandes démocraties, malgré leurs contradictions, ont mis le savoir au cœur de leur édifice. Ce n’est pas un hasard si les dictatures commencent toujours par censurer, réécrire l’histoire, ou contrôler l’école. Le savoir est le seul vrai pouvoir libérateur. Et il n’est pas un luxe. Il est une nécessité vitale.
Pour sortir du piège : penser, encore et encore
Le Mali n’a pas besoin de sauveurs. Peut-être, si. Il a besoin de penseurs. De chercheurs. De pédagogues. De citoyens formés. Il a besoin de retrouver une relation saine au savoir. Cela suppose :
- Une école qui ne se contente pas d’enseigner, mais qui éduque et forme à penser.
- Une justice qui ne soit pas un instrument, mais une colonne vertébrale.
- Une élite qui ne gouverne pas par la ruse, mais par la vision.
- Une société qui ne se résigne pas, mais qui interroge, qui discute, qui conteste.
Car le vrai patriotisme commence par le refus de l’ignorance, et la vraie souveraineté commence dans l’esprit. Tant que le pouvoir restera déconnecté de l’intelligence, et tant que le savoir restera captif, aucune réforme ne tiendra. Aucune paix ne durera. Aucun État ne prospérera.
Il est temps de désamorcer les mines antinationales que sont l’ignorance cultivée, les superstitions exploitées, et le fatalisme organisé. Ce n’est pas seulement un impératif politique. C’est une exigence de survie. Pour le Mali. Et pour toute l’Afrique.
Par Dr. Mahamadou KONATE
Centre Kurukanfuga-BGCP & BEC-DK
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
0
Drôle
0
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0