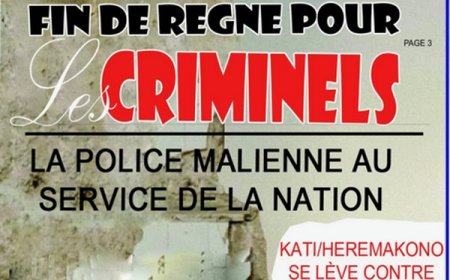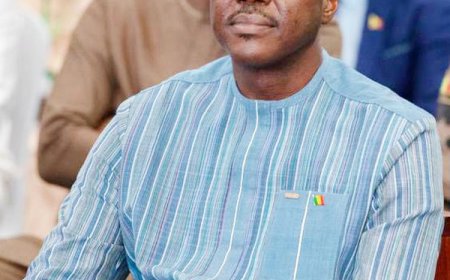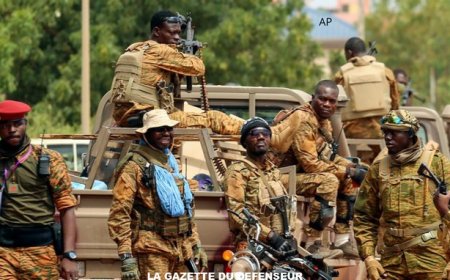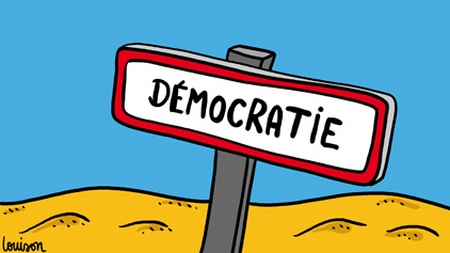Le Mandat de dépôt du Procureur de la République au Mali: un pouvoir encadré par la loi, mais entaché par des abus
Le mandat de dépôt du Procureur de la République au Mali, bien qu'il soit encadré de manière stricte par la loi, connaît malheureusement des dérives significatives, principalement provoquées par les abus de certains magistrats qui semblent aller au-delà des limites autorisées.

Avant appréhender les subtilités de cette situation complexe, il est crucial de remémorer que le Mali a adopté le 13 décembre 2024 un nouveau Code de procédure pénale, venant remplacer un ancien système judiciaire en place depuis trop longtemps. Ce texte législatif avait pour objectifs essentiels l'élimination des nombreuses lacunes qui affectaient le code précédent, en vigueur durant 24 longues années. Simultanément, il visait la consolidation de divers textes pénaux qui avaient vu le jour de façon disparate tout au long de cette période. Ce nouveau code, empreint d'une modernité nécessaire, intègre aussi des innovations indispensables qui sont le reflet de l'évolution sociétale constante du Mali, en quête de meilleurs outils légaux pour une administration plus équitable de la justice.
Pour faciliter la transition entre les deux régimes juridiques distincts, le dernier article du nouveau Code, spécifiquement le 1373-1, a prévu un délai de six mois avant sa mise en application concrète. Ce délai, qui était censé permettre l'adaptation des différents acteurs de la justice, a expiré récemment le 13 juin dernier. Toutefois, il convient de noter qu'en l'absence d'une mise en place effective du Collège des Libertés et de la Détention, qui représente l’une des innovations les plus significatives du nouveau cadre de procédure pénale, le code dispose explicitement que les Juges d'Instruction ainsi que les Procureurs de la République doivent continuer à exercer pleinement leurs fonctions concernant les mandats de Justice, tel qu'indiqué dans l'article 1371-1.
Cela implique que, pour l'instant, les dispositions pertinentes de l'ancien Code de procédure pénale datant de 2001 demeurent temporairement en vigueur tant que ledit Collège des Libertés n’est pas opérationnel.
En ce qui concerne spécifiquement les mandats de dépôt, l'ancien Code établit une distinction claire entre l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la détention provisoire en matière correctionnelle, conformément aux articles 123 à 133, et le mandat de dépôt lui-même, émis directement par le Procureur dans cette même matière, suivant les articles 83 et 387 à 390. La matière correctionnelle englobe tous les délits sanctionnés par une peine d'emprisonnement ne dépassant pas dix ans, selon l'article 131-3 du nouveau Code pénal de 2024.
Dans le cadre juridique des décisions du juge d'instruction, l'ordonnance de mise en détention provisoire doit impérativement être accompagnée d'une motivation rigoureuse, en conformité avec les critères stricts établis par l'article 123. Ce dernier impose au juge de n'exécuter un tel ordre que si la sanction envisagée pour le délit comprend une peine d'emprisonnement et qu'une telle détention s'avère le seul moyen efficace pour conserver les preuves nécessaires à l'avancement de l'affaire. Cette obligation de motivation vise à prévenir les abus liés aux détentions arbitraires, lesquelles peuvent s'étendre sur une durée allant d'un mois minimum à un maximum de douze mois, avec la possibilité pour l'inculpé de contester cette détention devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel.
L'objectif essentiel est de veiller à ce que demeure préservé le principe fondamental du droit selon lequel « la liberté est la règle, la détention l’exception ». Cet encadrement est soigneusement conçu pour éclairer le juge et lui permettre de respecter ce principe sacro-saint, essentiel à une justice équitable.
Nous avançons maintenant vers le sujet principal de cette analyse, à savoir le rôle précieux du Procureur de la République dans l'émission des mandats de dépôt. Les conditions auxquelles un procureur a la possibilité de délivrer un mandat de dépôt sont étroitement définies par le cadre juridique.
I- Conditions du décernement de mandat de dépôt par le Procureur de la République
Durant la phase d'enquête préliminaire, avant que débute le procès, le Procureur peut émettre un mandat de dépôt uniquement dans deux circonstances précises sans obligation de fournir une motivation : en cas de flagrant délit ou d'infraction correctionnelle passible d'emprisonnement.
1.1. En cas de flagrant délit
La loi le définit, dans l'article 79 du nouveau Code de procédure pénale, comme « le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre… [ou] lorsque dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé… au délit».
À titre d'exemple illustratif, lors d'un acte de vol, si les habitants d’une localité réussissent à appréhender le voleur au moment où il le commet et le conduisent directement auprès du Procureur de la République. Ce dernier est confronté à deux options bien distinctes : s'il choisit de transmettre l'affaire au juge d'instruction, il ne peut alors plus émettre un mandat de dépôt contre l'inculpé. En revanche, s'il prend la décision de citer directement l'individu concerné devant le tribunal, il est alors autorisé à émettre un mandat de dépôt après avoir interrogé le suspect sur son identité et les faits précis qui lui sont reprochés.
Ce mandat de dépôt est soumis à des conditions particulièrement strictes, décrites dans les articles 387 à 390 de l'ancien Code de procédure pénale :
- il doit le traduire immédiatement à l’audience du tribunal du jour ;
- s’il n’y a point d’audience, il doit citer le prévenu à l’audience du lendemain, avec au besoin convocation spéciale du tribunal.
Le Procureur se doit d'agir avec rapidité en traduisant l'inculpé à l'audience du tribunal le jour même, ou s'il n'y a pas d'audience prévue, en le citant à l'audience du jour suivant, avec la possibilité de convoquer une session spéciale du tribunal si cela s'avère nécessaire. Ces dispositions visent à garantir que le prévenu sera jugé rapidement, réduisant ainsi sa détention provisoire à deux jours au maximum avant de comparaître devant un juge qui déterminera ensuite son sort, avec toutes les implications légales qui en découlent. Ainsi, la liberté individuelle n'est pas indûment restreinte avant le procès, respectée dans une période maximale de deux jours, préservant les droits fondamentaux de l’accusé tout en veillant à l'application stricte des lois pour une justice équilibrée.
Il est aisé de remarquer qu’ici, il y a certitude pour le Procureur de la République que le prévenu est coupable du délit flagrant qui lui est imputé, du fait de la concordance des témoignages de ceux qui le lui ont conduit. Ensuite, il met le prévenu provisoirement en prison parce qu’il veut le faire juger immédiatement dans les deux jours qui suivent.
1.2. En cas d’une infraction correctionnelle établie
L’infraction correctionnelle, connue également sous le terme de délit, apparaît comme étant établie pour le Procureur de la République, notamment lorsqu'il y a des éléments probants comme décrits par l’article 83 alinéa 2 de l'ancien Code de Procédure Pénale :
- Soit ouverture d’une enquête préliminaire plus aveu du prévenu ;
- Soit ouverture d’une enquête préliminaire plus dépositions unanimes de plusieurs témoins.
Cette confirmation infractionnelle peut être réalisée soit par l’ouverture d’une enquête préliminaire qui est substantiellement renforcée par l’aveu du prévenu, soit par la même ouverture accompagnée de dépositions unanimes faites par plusieurs témoins crédibles. Seulement, dans ces circonstances spécifiques et dûment établies, le Procureur de la République se trouve en mesure de délivrer un mandat de dépôt contre l'individu prévenu. Ce mandat autorise une période maximale de détention provisoire de 3 mois, à condition que le prévenu soit présenté devant le tribunal par la suite. Le prévenu conserve néanmoins le droit de demander la levée de ce mandat à tout moment au cours des différentes étapes de la procédure judiciaire.
Prenons un exemple où le Procureur découvre dans des journaux le cas d'une personne, identifiée comme X, qui aurait été victime d'un acte de vandalisme et qui serait confiné chez son ami. Sur la base de cette information accablante, le Procureur prend la décision stratégique d'ouvrir une enquête préliminaire via la Brigade d’Investigation Judiciaire. L'enquête révèle que le voisin confesse le délit en question. Par conséquent, le dossier est transmis au Procureur qui, prenant en compte l'aveu, informe le voisin de la victime des charges retenues contre lui et décide de le placer sous mandat de dépôt, fixant la date du procès dans un délai de deux mois.
Il est important de noter que, même dans un tel contexte, le Procureur de la République est convaincu de la culpabilité du prévenu concernant le délit qui lui est reproché, de par son aveu. Il prend, par conséquent, la mesure de le soumettre à une période de détention provisoire qui ne doit en aucun cas dépasser 3 mois avant qu'il soit amené à comparaître devant le tribunal. Si cette période doit être prolongée, la mise en liberté du prévenu devient impérative.
Cependant, le Procureur peut aussi opter pour une procédure de poursuites sans détention, en saisissant le juge d'instruction qui aura alors la tâche de délibérer sur le cas. Cette décision repose sur les garanties que le Procureur jugera nécessaires, conformément à l’article 123 de l'ancien Code, pour assurer la préservation de l'équité de la justice lors du déroulement du procès. Le Procureur n'est pas tenu de fournir des justifications écrites pour son mandat à moins qu'il ne soit contesté devant la chambre d'instruction.
D'une manière générale, si l'une des conditions susmentionnées n'est pas remplie, le mandat de dépôt émis par le Procureur sera considéré illégal et peut être rapidement annulé par une juridiction supérieure. De plus, si la légalité de la détention provisoire est remise en question lors du procès et que le tribunal statue en faveur de cette contestation, il y a la possibilité que le Procureur soit poursuivi ultérieurement pour faute professionnelle devant la Cour suprême.
Dans la situation où le cas de X correspond à un flagrant délit, il est impératif de présenter la personne au tribunal dans les deux jours suivant l'arrestation. Si, en revanche, il s'agit d'un délit en général, il est essentiel que le prévenu ait confessé le crime ou qu'il y ait au moins trois témoins qui ont fourni des témoignages identiques et cohérents sur les faits. En l'absence de ces conditions, le Procureur se trouve en violation des lois établies.
Contrairement aux juges qui disposent d'une certaine flexibilité dans la recherche de différentes sources juridiques pour prendre leurs décisions, les Procureurs de la République doivent strictement s’en tenir aux lois en vigueur. Ils sont contraints de poursuivre les présumés délinquants en se conformant rigoureusement à la lettre et à l'esprit de la loi, sans dévier vers des interprétations alternatives. En matière pénale, la loi est sujette à une interprétation stricte, comme indiqué dans l’article 111-4 du nouveau Code de Procédure Pénale.
Il est également crucial de comprendre la raison (l'esprit) derrière les restrictions imposées au Procureur de la République concernant le pouvoir de décerner un mandat de dépôt. Ces restrictions sont dues au fait qu'il n'est pas obligé de fournir des motifs quand il prend sa décision, et en cas de doute, ou en l’absence d’un aveu ou de dépositions identiques de plusieurs témoins, il est indiqué par principe d'équité qu'un autre magistrat soit désigné pour lancer une autre enquête.
Cela est réalisé sous la forme d’une information judiciaire dirigée par le juge d'instruction, permettant la récolte de preuves tant à charge qu’à décharge contre le prévenu. Le temps réservé au réquisitoire devant le tribunal offre au Procureur, la possibilité d’exposer ses preuves, même si elles contredisent les conclusions de l’enquête judiciaire ainsi que les arguments défensifs.
Vu les abus excessifs observés en dehors de ce cadre, souvent décriés publiquement, le nouveau Code de Procédure Pénale a retiré au Procureur de la République le pouvoir de délivrer des mandats de dépôt et l’a confié à une équipe de trois juges composant le Collège spécialement mandaté pour cette fonction. Durant la transition vers ce système collégial, qui vise à restreindre l’octroi des mandats aux cas de stricte nécessité, les Procureurs de la République devraient exercer ce pouvoir temporaire dans cet esprit, avec la plus grande parcimonie et le respect dû à la liberté individuelle.
II- Le Procureur de la république, statut et mandat
Le rôle et la fonction du Procureur de la République ont évolué au fil des siècles, subissant des transformations profondes qui ont redéfini son statut et son mandat. À une époque révolue, la fonction de procureur se confondait avec celle de l'avocature ; il n'était pas rare que des particuliers tout comme des monarques aient leurs propres procureurs pour gérer leurs affaires légales. Ces procureurs pouvaient être des procureurs « aux causes », agissant pour le compte de particuliers, ou bien des procureurs du roi, dédiés aux intérêts royaux. C'est au XVe siècle que ces deux professions ont commencé à se distinguer clairement, avec d'un côté les avocats se concentrant sur le conseil et la plaidoirie, et de l'autre les procureurs devenant experts des procédures judiciaires (Hervé LEUWERS, La Justice dans la France moderne).
Au XIVe siècle, le paysage juridique avait déjà commencé à changer lorsque les procureurs choisis par le roi, exclusivement dévoués à ses intérêts, se virent interdire de travailler pour des particuliers. Puis au XVIIIe siècle, une législation importante abolit les "procureurs aux causes", redéfinissant le titre de "procureur" afin qu'il ne désigne plus que le représentant du roi ou du Ministère public. Avec l'avènement de la République française, le Président a progressivement remplacé le roi, bien que cette transition apparût sous la conception plus large de représentant de l'État ou du Ministère public.
Contrastant avec le régime juridique en France, la démocratie américaine du XIXe siècle permit l'élection des Procureurs de la République dans de nombreux États, donnant à ces fonctionnaires une légitimité et une indépendance renforcée. Par ailleurs, au niveau fédéral, le Procureur général doit obtenir son mandat de manière indirecte par une nécessaire confirmation législative du Congrès.
Dans un tel contexte, le Procureur de la République, doit être envisagé comme le représentant de la Société, fervent défenseur de ses lois, des droits et libertés individuels face à toute transgression, qu'elle provienne d'entités physiques ou morales.
Pour le reste, ils sont avant tout les avocats de l'État, engagés corps et âme dans la préservation de ses intérêts avant de se consacrer à la défense de ceux de la loi elle-même.
2.1. Statut du Procureur de la République
Le Procureur de la République occupe une position éminente parmi les Magistrats, étant nommé parmi ceux de grade exceptionnel, du 1er grade ou du 2ème grade, spécifiquement dans le 1er groupe 3ème échelon (Statut de la Magistrature). Ce processus de nomination dépend de la classe du tribunal de grande instance en question et repose sur un décret du Président de la République, émis suite à une proposition du Ministre de la Justice après avoir sollicité l'avis du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM). Cependant, cet avis du CSM n'est pas contraignant pour le Ministre de la Justice (qui est avant tout une personnalité politique, qu’il soit du corps de la magistrature ou pas).
Le Procureur, par son propre engagement ou par ses substituts, représente le Ministère public près la juridiction à laquelle il est associé. Il est le récipiendaire des instructions générales de politique pénale émises par le Ministre de la Justice. Ces directives sont ensuite spécifiées et harmonisées par le Procureur général, sous la responsabilité hiérarchique duquel il se trouve en vertu de l'article 62 du nouveau Code de Procédure Pénale. En suivant ces directives, son rôle devient intrinsèquement lié à la politique.
Par ailleurs, le Procureur reçoit des ordres de poursuite transmis par le Procureur général, soit de son propre chef, soit en réponse à une préconisation émanant du Ministre de la justice. Cela concerne chaque infraction au code pénal qu’ils parviennent à découvrir conformément à l'article 48. De plus, le Procureur est habilité à lancer lui-même des actions publiques en cas d’infractions au code pénal survenant dans son ressort et porté à sa connaissance. Ainsi, sa fonction s'étend au secteur judiciaire.
Il est doté de l'autorité et des prérogatives propres à la fonction d’Officier de Police judiciaire, lesquelles lui confèrent le pouvoir de gérer les activités des Officiers et Agents de Police judiciaire au sein du ressort de son Tribunal, conformément à l'article 60 du nouveau Code de Procédure Pénale.
Le Procureur de la République doit, cependant, naviguer dans un espace où il n’est ni indépendant ni inamovible. La dépendance qu'il a envers le Ministre de la Justice lui impose de respecter les instructions de poursuite et de réquisitions qu'il reçoit, faute de quoi il pourrait être démis de ses fonctions pour cause d’indiscipline. Cette situation amène certains, aspirant à être bien notés pour préserver leur poste et ses avantages, voire espérer une promotion lors du prochain mouvement, à suivre officieusement des instructions, malgré le silence de la loi sur ces pratiques (comme l'émission d’un mandat de dépôt qui est intrinsèquement lié à l'administration de la poursuite).
Ce manque d’indépendance, conjugué au biais d’intéressement, a amené la Cour européenne des droits de l’homme à affirmer, dans une décision du 10 juillet 2008, que le parquet français, dont notre système est la réplique au rabais, ne constitue pas une autorité judiciaire. Depuis, des progrès ont été réalisés en France, où une loi du 25 juillet 2013 dispose que la subordination du Procureur au Ministre de la justice ne peut pas se manifester à travers des instructions relatives à des affaires individuelles. Le Mali, pour sa part, pourrait aisément surpasser cette avancée juridique en France. Pourquoi, pas ?
2.2. Mandat du Procureur de la République
Le Procureur de la République se voit confier la tâche fondamentale de s’assurer du respect strict de la loi et de contribuer à l'application effective de la politique pénale prônée par les autorités. Il procède, ou fait en sorte que soient exécutés, tous les actes indispensables à la découverte et à la poursuite des délits contre le code pénal (art. 60 du nouveau Code de Procédure Pénale).
Il est responsable de recevoir les plaintes et les dénonciations, les évaluant pour décider de la suite à leur donner, sauf dans les cas relatifs à des faits exposés par des dénonciations provenant d'organismes publics qui sont mandatés pour lutter contre la corruption et d’autres formes de criminalité organisée, conformément à l'article 56 du nouveau Code de Procédure Pénale, où il est impératif d'engager l'action publique.
Avant de lancer ses poursuites dans les affaires régulières, il est possible pour le Procureur de s'accorder avec les parties impliquées sur l'opportunité d'employer la médiation pénale, laquelle peut conduire à une résolution à l’amiable et apaiser le trouble survenant consécutivement à l’infraction.
En allant de l'avant, le Procureur est habilité à inspecter les locaux de garde à vue, chaque fois qu'il juge cela nécessaire et au minimum une fois par mois, comme le préconise l'article 60 mentionné précédemment. Après chaque visite, il rend un rapport détaillé au Procureur général sur les conditions de garde à vue ainsi que sur l'état de ces locaux, lequel est ensuite transmis au Garde des Sceaux (art. 61 du nouveau Code de Procédure Pénale).
Le rôle du Procureur de la République inclut la mise en œuvre effective des décisions et des mandats de Justice, comprenant les verdicts des juridictions d’instruction et du Collège des Libertés et de la Détention, tel que précisé à l'article 50 du nouveau Code.
Ce mandat s'embrouille systématiquement quand les intérêts de l'État, sous l'accueil du Ministre de la Justice, s'opposent aux exigences de la société, lesquelles ne peuvent être protégées que par l’application rigide des lois en vigueur.
CONCLUSION
Le mandat de dépôt, bien qu'encadré par des règles strictes, reste entaché d'abus en raison de la dépendance des Procureurs et du retard dans la mise en œuvre des réformes. La transition vers un système collégial et une plus grande indépendance judiciaire sont essentielles pour garantir le respect du principe « la liberté est la règle, la détention l'exception » et restaurer la confiance dans la justice malienne.
Sous un régime militaire, où la situation politique est souvent instable et dominée par des contraintes autoritaires, il n'est guère surprenant que le système judiciaire se trouve dans un état très difficile et parfois dépouillé de ses principes fondamentaux.
Dans de telles circonstances, caractérisées par un manque de légitimité et de transparence, il serait peut-être préférable pour les détenteurs du pouvoir de suspendre les Constitutions et les Codes pénaux traditionnels, afin de les remplacer par des Ordonnances ou des textes légaux plus souples et adaptatifs, susceptibles d'être effectivement respectés et appliqués par tous les citoyens sans exception.
Dans la situation actuelle, leur négligence apparente et les multiples infractions qu'ils tolèrent ouvertement vis-à-vis de la loi ne font que renforcer la désobéissance du peuple envers les lois, lesquelles devraient pourtant servir de pilier et de stabilisateur unique de la société pour assurer son développement et sa prospérité.
Si le Mali, en quête d'une stabilité politique et sociale, aspire à revenir à un ordre constitutionnel normal, avec les mauvaises habitudes d'indiscipline et de non-respect des règles de conduite encouragées ça et là, sur quels citoyens pourrons-nous vraiment compter pour reconstruire et développer le pays de manière efficace et pérenne ?
Certainement pas sur un peuple balloté, à moins que l'on ne commence dès maintenant à le rééduquer, avec une détermination infaillible, par l'exemplarité des dirigeants et l'amour de la loi, en cultivant un profond respect pour les droits et les devoirs qui régulent la vie en société. Cela exige un engagement collectif des maîtres de son destin pour guider par l'exemple et ressusciter les valeurs essentielles délaissées.
Cette politique en cours, malheureusement, ne peut être considérée comme viable à long terme si l'objectif est de reconstruire un État solide et durable, car elle a pour effet déplorable de repousser ceux qui sont vertueux et bien intentionnés, les incitant à s'éloigner de l'appareil gouvernemental.
En substance, un environnement politique qui n'encourage pas la participation active intègre et bienveillante finit par se priver des talents et des perspectives des citoyens les plus engagés, compromettant ainsi la cohésion et la prospérité nationale dans son ensemble.
Dr. Mahamadou KONATÉ
Quelle est votre réaction ?
 Like
0
Like
0
 Je kiff pas
0
Je kiff pas
0
 Je kiff
0
Je kiff
0
 Drôle
1
Drôle
1
 Hmmm
0
Hmmm
0
 Triste
0
Triste
0
 Ouah
0
Ouah
0